Petite histoire de la naissance de la TVA

Genèse du concept
C’était il y a trente-cinq ans, déjà. Notre promo était encore loin d’avoir accompli la moitié de son parcours actuel.
Avide d’agir après une longue captivité en Allemagne, j’étais entré, trois ans auparavant, grâce au camarade Maurice Bourgès-Maunoury (35), ministre du Budget, au Cabinet de la rue de Rivoli. J’y étais devenu un certain temps une sorte de permanent fiscal, cependant que défilaient les ministres. J’avais suscité la création de la Direction générale des Impôts et fondé les brigades polyvalentes (horresco referens…). Poujade n’étant pas encore là, j’étais à l’affût d’autres réalisations fiscales.
C’est sur ces entrefaites que Paul Delouvrier, directeur général adjoint des Impôts, s’est déchargé sur moi du soin d’intervenir dans un séminaire auquel il avait eu l’imprudence d’accepter de participer. Organisé par Raoul Nordling (le consul de Suède qui avait sauvé Paris des flammes), ce séminaire avait pour sujet » Fiscalité et Productivité « .
Il n’y a rien de tel pour comprendre une matière que de devoir l’enseigner. Cherchant ce que j’allais bien pouvoir dire, j’ai passé en revue les diverses parties de notre système fiscal, sous l’angle de la productivité, et j’ai fini par trouver.
Je ne me suis pas cru obligé d’imaginer les incitations les plus succulentes à donner en prime aux entrepreneurs qui se conformeraient à des ratios de productivité, astucieusement fixés. Je me suis tout bêtement dit qu’il fallait s’efforcer de faire en sorte que la fiscalité ne fausse pas les calculs de prix de revient par rapport à ce qui se passerait s’il n’y avait pas d’impôts. Je pensais en effet que, s’il fallait bien que le fisc prélève sa livre de chair, il valait mieux faire en sorte que, auparavant, cette chair se soit accrue avec le maximum d’exubérance… On se donne du mal, de nos jours, pour en revenir à ce point de vue simpliste.
Animé, donc, de simplisme, je me suis attaché en particulier à étudier le sort fait aux investissements. En effet, me disais-je, ce n’est pas pour le plaisir, mais pour économiser du temps et de l’argent, qu’un entrepreneur investit. Il faut bien que cela en vaille la peine, car investir c’est se détourner, dans l’immédiat, de la production que l’on s’est assignée, afin de fabriquer un outil. Il faut donc que cet outil fasse beaucoup gagner de temps pour que le temps passé à le fabriquer soit plus que rattrapé… L’investissement est donc l’une des voies royales de la productivité.
Or, à l’époque, la taxe à la production frappait les investissements comme s’ils avaient été des objets de consommation finale, acquis par les consommateurs pour dépenser leurs revenus, et, par conséquent, bons à imposer pour qui veut appréhender une partie du revenu des citoyens.
En bons serviteurs de l’État, les juristes, qui dominaient alors – et je crains que cela n’ait pas beaucoup changé – l’élaboration de la fiscalité, avaient conçu une théorie maximaliste des biens taxables à la taxe à la production : ils y avaient inclus les investissements. Les usines qui produisent les investissements, disaient-ils, bénéficient autant que les autres des services de la collectivité : il faut donc que les biens qu’elles fabriquent soient frappés des mêmes impôts que les marchandises fabriquées par les autres usines.
Au nom de cette théorie, le fisc se donnait beaucoup de mal – et causait encore davantage de mal aux assujettis – afin de pourchasser les investissements à imposer. Il n’y a pas, en effet, comme investissements que les investissements bien visibles que l’on achète à autrui : il y a aussi ceux que l’on fabrique soi-même : les outillages pour machines-outils, les machines bricolées maison… Il fallait donc calculer en pareil cas la valeur de l’investissement, bien qu’elle ne soit pas apparue dans une transaction. Une couturière qui taillait un » patron » dans du papier aurait théoriquement dû isoler le coût du papier et le temps passé à le tailler pour y appliquer spécialement la taxe à la production, comme si c’était une robe supplémentaire.
Il n’y avait pas, non plus, que les investissements consistants et massifs. Il y en avait de plus subtils. Par exemple fallait-il considérer une électrode en graphite, dans un four électrométallurgique, comme un investissement, puisqu’elle servait à véhiculer le courant, ou comme une matière première, puisqu’elle fondait en servant et s’incorporait au produit fini ? Tel Salomon, le fisc avait coupé la poire en deux en bâtissant la théorie des » produits de consommation rapide » en considération de laquelle les électrodes étaient taxées pour moitié en tant qu’investissements. J’en passe, et des meilleures, comme la théorie des » produits qui perdent leur qualité spécifique par le premier usage » (les liquides à décaper par exemple).
Bien que je fusse, moi aussi, maximaliste à mes heures, je me tenais un raisonnement différent.
Pourquoi, me disais-je, isole-t-on, parmi tous les processus capables d’être suivis pour la fabrication d’un objet, ceux d’entre eux dans lesquels on prend, pour des raisons d’efficacité, le temps de se détourner de l’objectif final de la production afin de réaliser un outil qui permet, ensuite, de rattraper davantage que le temps passé à l’élaborer ? C’est pénaliser systématiquement la productivité… Et puisque la taxe à la production avait pour taux 15,35 %, c’était interdire tous les investissements qui économisaient moins que 15,35 % de travail (et même davantage, en raison de la marge de sécurité qu’il faut toujours prendre avant d’assumer un risque).
La logique de cette réflexion m’attirait d’autant plus que l’exonération des investissements aurait considérablement simplifié l’application de la taxe à la production : au lieu de sélectionner ce qu’il fallait déduire, et au lieu de rechercher, du côté des investissements créés par l’entreprise, des sujets fictifs de réintégration, il aurait suffi, désormais, de tout déduire…
C’était trop beau pour être vrai, et il fallait que j’y regarde à deux fois, car les investissements interviennent en moyenne pour plus de 15 % dans la valeur de la production industrielle, de telle sorte que ma suggestion productivo-simplificatrice mettait en cause 15 % du rendement de l’impôt le plus productif de notre système fiscal.
Je me suis donc obligé à me contrôler moi-même par le calcul, et je me suis bâti un schéma simplifié de la formation des prix de revient dans le cycle de la fabrication. Mon objectif était de savoir quel était le système de taxe indirecte qui conduirait à des prix homothétiques de ceux qui existeraient en l’absence d’impôt : le système sans déduction des investissements, ou le système avec déduction des investissements ? J’eus la satisfaction de constater que c’était le système avec déduction des investissements, et je pris la résolution de faire campagne pour la réforme que j’entrevoyais.
J’ouvre ici une parenthèse pour dire que je n’ai jamais pu communiquer à d’autres économistes les raisons fondamentales qui ont fait ma conviction pour m’attaquer à une réforme qui ferait perdre à l’État – sauf relèvement des taux – 6 % de ses recettes. Chaque fois que j’ai voulu exposer à des économistes de formation juridique mon calcul simple, mais qui exigeait le maniement un peu mathématique de symboles, je n’ai pas été compris.
Chaque fois, inversement, que j’ai voulu l’exposer à des économistes de formation mathématique, je tombais sur des économètres qui n’avaient de cesse que de vouloir me faire utiliser leurs courbes et leurs coefficients d’élasticité. Là où, en fait, j’avais raisonné à l’aide de fonctions que j’analysais par un développement linéaire dont les coefficients étaient des dérivées partielles, mes interlocuteurs voulaient m’obliger à raisonner dans le cas le plus complexe.
J’avais eu la bonne fortune de raisonner » toutes choses égales d’ailleurs « , comme les bons vieux économistes. Ce n’est plus possible, à l’ère des modèles et de l’informatique : on se doit de raisonner » aucune chose n’étant égale par ailleurs « . Moyennant quoi on transporte dans un futur qui devrait être neuf et unique les vieilles habitudes dont sont imprégnés les modèles…
Je referme ma parenthèse pour dire que, faute de justifications communicables, j’ai utilisé des apologues. Je décrivais, par exemple, le cas d’un Robinson Crusoë entreprenant tantôt avec investissement, tantôt sans investissement, des fabrications utiles à sa survie, et je décrivais ce qui se passerait selon qu’une divinité exigerait de Robinson un prélèvement établi sur le produit fini ou, au contraire, sur l’investissement…
Péripéties politico-administratives
J’avais bien besoin d’apologues. En effet, le Service de la législation de la Direction générale des impôts avait immédiatement pris parti contre ma suggestion, pour la bonne raison que, par rapport au système existant, j’introduisais un énorme dégrèvement… le fisc a horreur du dégrèvement de la même manière que la nature a horreur du vide.
Il m’a donc fallu passer par l’extérieur… L’une des voies qui s’ouvraient était le commissariat à la Productivité, qui, à l’image du commissariat au Plan, fonctionnait au moyen de commissions : je devins rapporteur de la commission » Fiscalité » de ce Commissariat.
Je tâchai aussi d’intéresser l’Université à mes théories. Comme mes fonctions m’avaient fait connaître le professeur Henry Laufenburger, car sa profession l’autorisait à donner des consultations fiscales, je le persuadai de présider une thèse de droit que je consacrerais à ma nouvelle forme d’impôt, que j’avais choisi d’appeler » taxe sur la valeur ajoutée « .
Et c’est ainsi que j’ai obtenu, par ma soutenance, six mois avant le vote de la réforme, une sorte de brevet d’invention de la TVA (sans droit à royalties, malheureusement). Je fus même fait lauréat de la faculté de Droit de Paris. Mon jury de soutenance avait cependant émis une critique à l’égard de mon travail : il me reprochait de ne pas avoir accompagné mon ouvrage d’une bibliographie. Mais où diable serais-je allé prendre une bibliographie, pour appuyer des raisonnements de ma propre invention ?
Encore mieux que l’Université, je sautais sur les occasions d’intéresser les syndicats patronaux à mes théories. À vrai dire, la taxe à la production n’était pas le centre des préoccupations fiscales du patronat, car les entreprises avaient largement le sentiment de répercuter cet impôt sur les consommateurs et elles préféraient batailler pour la conquête de déductions (provisions ou amortissements) à l’impôt sur les bénéfices.
Toutefois nombreuses étaient les professions qui souffraient, pour l’application de procédés nouveaux, de la surtaxation que la taxe à la production infligeait aux investissements. Chaque profession venait alors rue de Rivoli pour demander une exception correspondant à son cas spécifique. Je pris alors pour règle – en continuant, comme d’habitude, de refuser les exceptions – d’expliquer que le mal dont se plaignaient légitimement les intervenants n’était qu’un aspect particulier d’un défaut général, la double taxation des investissements, il était impossible, disais-je, de s’en tirer par des milliers d’exceptions : il fallait une réforme générale.
Quel que soit le scepticisme, bien compréhensible, des praticiens par rapport aux théoriciens, je finis par être entendu, et certaines fédérations patronales épousèrent mes thèses, qu’elles propageaient auprès des parlementaires et appuyèrent même, pour certains, par l’édition de brochures.
Encore fallait-il obtenir le dépôt d’un projet de loi, c’est-à-dire convaincre le ministre des Finances. Celui-ci avait bien d’autres chats à fouetter que de procéder à une réforme fiscale entièrement basée sur 1’exonération d’une catégorie importante de biens industriels… C’est là que le hasard me servit (je l’aidais, il est vrai, en me manifestant dans tous les azimuts possibles).
La réforme fiscale était à l’ordre du jour (déjà !). La taxe à la production, en particulier, commençait à devenir la cible des critiques du monde de la production. Un industriel, M. Schueller, le fondateur de L’Oréal, faisait campagne pour un impôt sur l’énergie, qui aurait remplacé toutes les autres formes d’impôts. Pour ma part je faisais campagne pour la TVA. Il arrivait que M. Schueller et moi nous nous succédions dans certaines joutes oratoires, à Paris ou en province, où l’on nous faisait venir à la manière d’un plateau d’artistes.
Je me souviens en particulier d’un soir, à la Chambre de commerce de Limoges, où je venais de prôner la TVA et où M. Schueller avait ensuite vanté les mérites de l’impôt sur l’énergie. Ce sera merveilleux, disait-il : non seulement il n’y aura plus d’impôt sur le revenu, mais encore on économisera l’énergie ; tout le monde roulera en 2 CV…
Là dessus, après des applaudissements équitablement répartis, la séance avait pris fin. Prenant ma valise à la main pour gagner à pied la gare, je croisai, à la sortie, M. Schueller qui montait dans une sorte de Rolls… C’était un excellent homme, auquel une sorte de complicité, comme il en naît entre adversaires politiques, a fini par me lier.
La réforme fiscale, donc, était à l’ordre du jour, et M. Antoine Pinay, qui venait de stabiliser le franc, a fait en matière fiscale comme beaucoup de ses prédécesseurs : il créa une commission, dont il donna la présidence à M. Loriot, président de la section des Finances au Conseil d’État.
Cette commission entreprit d’auditionner : les fédérations professionnelles, les centrales ouvrières, les administrations, et tous ceux qui se manifestaient en matière fiscale. Il y eut, bien entendu, M. Schueller, pour l’impôt sur l’énergie. Mon tour vint. Ce n’était pas au titre de la Direction générale des impôts, puisque celle-ci, de toutes ses fibres, répudiait mes thèses : c’était en tant que rapporteur de la Commission fiscalité du commissariat à la Productivité.
Je plaidai donc, devant M. Loriot, l’adoption d’une taxe sur la valeur ajoutée. Quand j’eus fini, le président Loriot, qui savait que j’appartenais à la Direction générale des impôts, se tourna vers le directeur général, Pierre Allix, qui, par fonction, assistait à toutes les auditions, et lui dit : » Voyons, Monsieur le directeur général, je ne comprends pas : voici M. Lauré, qui appartient à votre direction générale et qui est pour la TVA ; or j’ai entendu tout à l’heure votre chef du Service de la législation, qui est intervenu contre la TVA. Quelle est donc la position de la Direction générale des impôts ? « .
Pierre Allix prit une bonne minute de réflexion, et il dit finalement : » La Direction générale des impôts est pour la TVA « . Je n’avais qu’un soutien, à la DGI, mais il était de taille…
Dès lors les choses suivirent leur cours. Le président Loriot fit figurer l’instauration de la TVA parmi les conclusions de la commission. Pierre Abelin, secrétaire d’État aux Finances, s’intéressa à la proposition et en fit un projet de loi. Malheureusement, le Gouvernement auquel appartenait M. Pinay avait alors trop de mois d’existence pour être encore solide et pour jouer son sort sur une réforme fiscale, et le projet fut repoussé.
Fort heureusement, la venue d’un nouveau gouvernement fut l’occasion de remettre sur le chantier la réforme fiscale. La chance intervint une seconde fois : la stabilisation Pinay avait engendré une certaine récession, contre laquelle le gouvernement voulait réagir. M. Edgar Faure, ministre des Finances, cherchait des mesures de relance, et il se tourna vers l’exonération des investissements.
Toutefois, homme de compromis s’il en fut, il n’opta pas pour réformer carrément l’impôt, comme cela aurait été le cas en instituant la TVA. Il opta pour une exonération temporaire des investissements à la taxe à la production, et ce à hauteur de la moitié seulement de la taxe.
Il se produisit alors un phénomène que j’ai vu se répéter depuis dans d’autres cas d’application de demi-mesures : au lieu de se précipiter sur cette exonération de moitié et d’investir, les entreprises, qui savaient qu’il y avait de la TVA dans l’air, s’arrêtèrent d’investir, attendant l’autre moitié. Il fallut en passer par la totalité de la déduction, toujours à titre provisoire bien entendu.
Pour sortir de cette situation, le secrétaire d’État au Budget, M. Henri Ulver, chaud partisan de la TVA, me demanda de préparer un texte instituant cette réforme, afin de l’inclure dans la loi de Finances pour 1953. Tout allait bien, et il ne restait plus qu’à envoyer le projet de loi à l’Imprimerie nationale, ce qui impliquait, pour la bonne règle, l’autorisation du ministre des Finances lui-même.
Au lieu d’une autorisation, ce fut un refus dont j’attribue l’origine au fait que le Ministre avait pour directeur de Cabinet un éminent fiscaliste malheureusement imprégné des traditions des services de la Direction générale des impôts. Il était onze heures du soir, et l’Imprimerie nationale attendait. C’est alors que M. Henri Ulver, qui appartenait au groupe gaulliste, indispensable à la formation de la majorité, mit en jeu son appartenance au gouvernement à propos de l’inclusion de la TVA dans le projet de loi de Finances.
Le président du Conseil, M. Laniel, consulté sur l’heure, reçut le Ministre et son Secrétaire d’État. Il ne balança pas et choisit, sinon la TVA, du moins le maintien de sa majorité… et c’est ainsi que je pus envoyer le texte à l’Imprimerie nationale et qu’il fut déposé, une nouvelle fois, sur le bureau de l’Assemblée.
Je ne m’étendrai pas sur les péripéties du vote du projet de loi, à l’Assemblée nationale. Pendant des jours et des nuits, comme il était d’usage, je suivis pas à pas, en commission, en séance publique, en entretiens particuliers, le vote du projet.
Sous la quatrième république, l’on était loin de disposer de » godillots » pour le vote des lois, et je dus consentir bien des concessions, qui apparurent ensuite comme des verrues du système. Dans la plupart des débats, ce n’était pas la logique qui était à l’honneur.
C’est ainsi que j’ai été beaucoup servi par le titre de » taxe sur la valeur ajoutée » que j’avais repris à un système proposé plusieurs années auparavant par la CGT. Cela me valut de voir un certain nombre d’orateurs de gauche monter à la tribune pour expliquer qu’ils étaient favorables à la TVA à l’exception de la déduction des investissements.
Celle-ci, qui était pourtant la clé de la réforme, n’avait pas la faveur d’un grand nombre d’orateurs : j’ai entendu des orateurs de droite l’attaquer… Les investissements sont évidemment un sujet électoral moins appétissant que les asperges en botte (du Vaucluse) ou les conserves de sardines (bretonnes), sujets sur lesquels j’entendis alors, au cours des heures passées dans les hémicycles, des développements lyriques.
En fait, heureusement, les votes dépendaient finalement de la position de quelques leaders. Parmi les leaders favorables à la TVA, l’un des moindres n’était pas Pierre Mendès France, qui présidait la Commission des finances de l’Assemblée nationale. Dirigiste par instinct, l’exonération des investissements lui paraissait une bonne forme d’intervention dans l’économie (pour moi, au contraire, c’était le moyen de respecter la formation naturelle des prix, mais je me gardais bien d’y insister devant lui).
M. Mendès France, cependant, était un dirigiste passionné et quelque peu puritain. Pour lui, il y avait les bons et les mauvais investissements. » Voyons, M. Lauré, me dit-il quand la Commission des finances m’auditionna sous sa présidence, voyons, M. Lauré, vous n’allez quand même pas détaxer les machines à fabriquer le chewing-gum ! » » Mais si, Monsieur le Président, lui répondis-je. Si le chewing-gum est un produit nocif, je ne demande pas mieux qu’on le taxe très fort, voire qu’on l’interdise. Mais s’il est admis que l’on puisse fabriquer du chewing-gum, c’est une perte sèche pour la collectivité que d’établir un régime fiscal qui handicape les progrès techniques dans la fabrication du chewing-gum, et qui fasse perdre du temps.
En effet, le temps parti en fumée ne profite à personne. Ce qu’il faut, au contraire, c’est fabriquer le chewing-gum dans le moindre temps global possible, c’est-à-dire au moindre coût, puis mettre un gros impôt de consommation sur le chewing-gum : ainsi le temps gagné dans la fabrication du chewing-gum sera récupéré et profitera à la collectivité, au lieu de partir en fumée. »
Je ne suis pas sûr d’avoir convaincu le président Mendès France, tant il est vrai qu’il est difficile, en matière fiscale, de faire taire les passions, au bénéfice de raisonnements objectifs. Heureusement, néanmoins, le président Mendès France entraîna la commission qu’il présidait à émettre un vote favorable au projet de TVA.
La TVA hors de France
Trente-trois ans après le vote de la TVA par le Parlement français, cette taxe a essaimé. Il est significatif que tous les autres pays de la Communauté européenne aient abandonné leurs propres systèmes de taxes indirectes pour adopter le système français : les particularismes fiscaux, pourtant, sont bien ancrés, en général. Mais il a été reconnu qu’aux frontières comme à l’intérieur des territoires, la TVA était le seul impôt capable de ne pas altérer la vérité des prix… La TVA existe maintenant pratiquement dans toutes les parties du monde, et elle est appliquée dans trente-cinq pays.
Je ne suis pas sûr, pour autant, que la véritable nature de la TVA ait été bien assimilée. Beaucoup de professionnels, d’hommes politiques, et même de fiscalistes s’imaginent que la TVA est assise sur la valeur ajoutée de chaque entreprise. C’est faux. La TVA est assise sur la valeur ajoutée de la Nation et les entreprises servent seulement de percepteurs, avec la certitude qu’elles ne supportent pas l’impôt tant que le produit est chez elles, pourvu qu’elles le perçoivent dès qu’il les quitte.
C’est pourquoi, du reste, elles s’accommodent tellement bien de cette forme de taxe : c’est, au niveau des entreprises, un prélèvement latéral aux mouvements de trésorerie et pour le compte (ou, plus exactement, à la charge) de tiers. Ce prélèvement n’est pas sans rapport avec une valeur ajoutée au niveau de l’entreprise, mais une valeur ajoutée en trésorerie plutôt qu’en droits patrimoniaux… et de toute manière, ce n’est pas un impôt sur les entreprises (encore qu’elles s’en glorifient souvent dans les brochures qu’elles consacrent aux prélèvements fiscaux qu’elles supportent).
L’incompréhension sur la véritable assiette de la TVA est allée jusqu’à susciter une loi : ce fut, dans les années 1970, l’institution de la » Serizette » qui était un impôt prétendant prendre en considération la valeur ajoutée de chaque entreprise. Cet impôt n’a pas pu être appliqué, et il a été rapporté. De nos jours, les propositions qui tendent à remplacer, au niveau des collectivités locales, la taxe professionnelle par une imposition de la valeur ajoutée des entreprises participent de la même illusion. Ces tentatives sont la rançon de l’intitulé exact mais abstrait que j’ai donné à la TVA en adoptant la dénomination du projet de la CGT.
Il serait concevable, certes, d’élaborer une définition de la valeur ajoutée de chaque entreprise, un peu comme on a élaboré une définition du bénéfice net. Le total des déclarations égalerait alors, par définition, la valeur ajoutée de la Nation. Mais au prix de quelles complexités ! C’est pourquoi toutes les tentatives d’imposer la valeur ajoutée en déterminant celle-ci par la voie additive (alors que nous pratiquons la voie soustractive) ont échoué.
La plus spectaculaire a été, dans les années cinquante, avant même la TVA française, la tentative du professeur Carl Shoup de la Columbia University, que le Gouvernement fédéral avait chargé de mettre au point un système de TVA pour le Japon : le professeur Shoup remplit son contrat et rédigea une loi dans laquelle la valeur ajoutée était définie par voie additive. La Diète japonaise vota cette loi… mais elle ne fut jamais appliquée, et l’on n’en parla plus une fois que le Japon eut recouvré son indépendance.
À l’automne 1984, une délégation de la Chambre des représentants américains, et à l’automne 1985 une mission gouvernementale japonaise se sont rendues à Paris pour étudier le système français de TVA, cependant que le Gouvernement de Pékin a demandé officiellement, en cette matière, l’assistance de la DGI française.

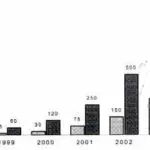

Commentaire
Ajouter un commentaire
Toute la ruse qu’il a fallu
Toute la ruse qu’il a fallu déployer pour faire passer une réforme majeure et simplissime… Article passionnant et d’une incroyable actualité, sur les difficultés des Français et plus encore de l’administration à comprendre les rouages de la fiscalité.