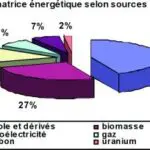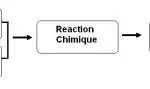São Paulo : les fractures de la modernité
São Paulo est résolument moderne. Moderne au sens baudelairien du terme : non pas opposé à un quelconque passé (aurait-il seulement eu le temps de s’écrire), mais chaos créateur. Lorsque Zweig écrit sur São Paulo, il décrit une ville tournée vers le futur, qui en tire son énergie et son dynamisme spectaculaire.
São Paulo est résolument moderne. Moderne au sens baudelairien du terme : non pas opposé à un quelconque passé (aurait-il seulement eu le temps de s’écrire), mais chaos créateur. Lorsque Zweig écrit sur São Paulo, il décrit une ville tournée vers le futur, qui en tire son énergie et son dynamisme spectaculaire1. Une ville de migrants, terre d’élection d’une population de pionniers conquérants2, construite sur du provisoire auquel il a fallu donner un aspect définitif, dans laquelle on a soudain tracé avenues et parcs – et bientôt voies rapides et ponts routiers – parce qu’elle avait les devoirs d’urbanisme d’une grande ville. Elle en tire son caractère hétérogène, sans centre, anarchique. Pour s’assurer sa place par rapport à la belle et culturelle Rio, São Paulo « sait qu’elle doit enfin prendre un visage » écrit Zweig. Ville surdimensionnée, saturée, jetée dans la modernité en l’espace de quelques décennies, typique de ces villes du Nouveau Monde (…) qui « vont de la fraîcheur à la décrépitude sans s’arrêter à l’ancienneté »3.
le Brésil moderne, vue aérienne de São Paulo
Il est frappant de trouver dans la description de Zweig (1941) comme dans celle de Lévi-Strauss qui rentre du Brésil en 1939, une extraordinaire actualité. Comme si l’élan de São Paulo n’avait pas changé, comme si cette ville gardait ce tempérament impatient, toujours en construction – et en soixante ans, elle est passée du million à plus de 10 millions d’habitants4, mais aussi comme si elle n’avait pas encore pris son visage définitif.
Capitale économique du Brésil et de l’Amérique latine São Paulo compte parmi les cinq premières mégapoles mondiales. C’est une ville moderne et mondialisée, avec de quoi narguer la vieille Europe : sièges sociaux des plus grandes multinationales, services bancaires informatisés depuis longue date, médecine de pointe, excellence universitaire, autoroutes sous concession en parfait état.
Et pourtant cette modernité qui enivre la ville ne concerne que la moitié de ses habitants : l’autre partie s’entasse dans les favelas5, dans les interstices ou dans une zone périurbaine d’habitats précaires sans infrastructure décente. Là, grandit une jeunesse de laissés-pour-compte avec peu d’autres échappatoires que la drogue.
Deux villes cohabitent donc : l’une tournée vers l’extérieur, celle des élites, de l’économie et du tourisme, des complexes ultramodernes, au paysage urbain spectaculaire, forêt de gratte-ciel traversée de voies rapides ; et l’autre, gigantesque ensemble insalubre de maisonnettes précaires, au quotidien difficile sinon désespéré.
Cette dualité guette probablement toutes les villes du Sud, grandies trop vite et jetées dans la modernité, sujettes aux restructurations productives, et incapables de faire face à la demande d’accueil que leur expansion a suscité, dans un état de délitement social que semble vouloir ignorer l’élite.
« L’écart entre l’excès de luxe et l’excès de misère fait éclater la dimension humaine »6 écrit Lévi-Strauss à propos de Mumbai, et cela vaut pour son homologue brésilienne. À croire, le développement des mégapoles du Sud ne se fait qu’au prix de l’exclusion ? S’il n’y a pas lieu dans le présent article de répondre à une telle question, le cas de São Paulo permet toutefois de comprendre comment et pourquoi le « fossé » des inégalités se creuse malgré une apparente « modernisation », et ce, bien sûr, en tenant compte des particularités historiques et culturelles du Brésil.
Les paradoxes de la croissance urbaine : l’exclusion territorialisée
À l’instar de nombreuses autres villes du Sud, de l’Amérique latine à l’Asie du Sud et du Sud-Est, la croissance spectaculaire de São Paulo s’est faite au prix de l’exclusion. Son décollage industriel dans les années cinquante-soixante porté par une activité industrielle dynamique (métallurgie, mécanique, électricité, communications, textile, chimie) a attiré une large population de migrants candidats à l’emploi et a stimulé son processus de mégapolisation.

L’élan se brise à la fin des années soixante-dix : la crise industrielle se profile, il faut rationaliser la production. Puis, dans les années quatre-vingt-dix, deuxième choc avec l’abrupte ouverture économique de F. Collor, et un grand nombre d’usines ferment ; la pression de la compétition impose de recourir à la sous-traitance. La base industrielle s’effrite, fuit les syndicats trop puissants, la ville entre dans la phase de « restructuration productive » qui se traduit par le passage à une économie fondée sur la haute technologie et les services7, tandis que le marché de l’emploi se dégrade et que se développe le secteur informel. S’en suit un accroissement des inégalités socio-économiques avec enrichissement d’une élite et précarisation des plus pauvres.
Ainsi, depuis les deux dernières décennies, São Paulo expérimente une détérioration sensible des conditions de vie de ses habitants, qui s’exprime entre autres par l’explosion du problème du logement. Pourtant, le mythe d’une vie meilleure et des opportunités d’emploi perdure, et la ville continue d’attirer des milliers de migrants, toutefois dans une proportion moindre que dans les décennies précédentes. Ce flux est de plus en plus gonflé (à 60 %) par les Nordestins, des États les plus pauvres du Brésil8. Ils viennent s’entasser dans les favelas qui abritent aujourd’hui entre 15 % et 20 % des habitants de São Paulo. Selon le SEHAB – Secrétariat municipal de l’habitat – il y aurait 2,2 millions de personnes dans les favelas et logements précaires dans la capitale en 2003. Tandis que la population de São Paulo a cru de 8 % entre 1991 et 2000, la seule catégorie des favelados a cru de cinq fois plus.
Favelisation et périphérisation
Alors que São Paulo avait longtemps entretenu la réputation, à l’inverse de ses consœurs de Rio ou de Recife, de ne pas posséder de favelas, ces dernières se développent de manière spectaculaire, à la fin des années soixante-dix. Avec la crise et la pression migratoire, le phénomène « d’invasion collective » de terrains privés et publics se développe sous la forme « d’occupations » illégales parfois organisées et politisées, le plus souvent anarchiques. Un des clivages des métropoles brésiliennes est donc celui qui oppose la ville légale, régulière, à la ville illégale, irrégulière.
Dans le cas de São Paulo, la population de bas revenus se voit rejetée depuis vingt ans dans une périphérie de plus en plus lointaine, là également où les migrants continuent d’affluer. La ville est donc passée d’un modèle d’expansion horizontale à un modèle d’occupation intensive de l’hyperpériphérie. Tandis que la favelisation des villes s’accélère, des « cidade dos muros9 » se sont édifiées. Les poches de pauvreté peuvent être « internes » à la municipalité, même si en l’occurrence elles sont majoritairement externes à São Paulo, contrairement à Rio où elles grandissent aux interstices des quartiers riches. En outre on retrouve dans la périphérie pauvre des enclaves plus aisées sous la forme de résidences sécurisées de luxe (condominios fechados). La dichotomie « centre-périphérie » qui a bien exprimé le modèle de ségrégation sociospatiale de São Paulo jusque dans les années quatre-vingt ne caractérise donc plus l’évolution actuelle, que Caldeira qualifie d’enclaves fortifiées (enclaves fortificados) d’un côté et des zones d’occupation misérables de l’autre, modèle qui creuserait le fossé dans l’espace de la citoyenneté.
La pauvreté, une question politique
Les pouvoirs publics ont-ils pris assez tôt la mesure du problème ? Il s’agit d’intégrer des centaines de milliers de personnes, ce qui ne suppose pas seulement de créer massivement des infrastructures mais aussi de favoriser l’accès aux services urbains, à cette ville dont elles sont exclues.
La politique de destruction (remoção) des favelas et de relogement éventuel, en vogue sous la dictature (1964−1988) s’achève sur un échec : les zones de relogement sont déficitaires en infrastructures et surtout en opportunités de travail. Cet échec ouvre le champ aux politiques participatives d’urbanisation (urbanização) des favelas, c’est-à-dire à leur réhabilitation et à leur incorporation dans la trame urbaine. L’un des premiers programmes participatifs est les mutirões, « self-help programs » qui permettent aux communautés locales de construire elles-mêmes leur logement.
Aujourd’hui ces programmes continuent, citons l’actuel Programa Bairro Legal, mis en place en 2002 par la municipalité sous la gestion de Marta Suplicy (2001−2004. Parti des travailleurs), qui a pour but l’urbanisation et la régularisation des favelas, l’objectif étant de les transformer en quartier, et de garantir aux habitants un accès à la ville, des rues asphaltées, un système sanitaire, l’éclairage public, etc. Urbanisation et régularisation, les deux volets de cette politique, devraient se poursuivre sous la nouvelle administration du PSDB, principal parti de centre droit. Malgré toute la difficulté de mise en place effective, São Paulo échappe aux destructions massives (buldozerisation) qui sont de mise dans les mégapoles indiennes ou chinoises.
Renforcement des inégalités et précarisation
Le développement de São Paulo ne semble pas avoir donné beaucoup plus d’opportunité à sa société, déjà largement fracturée. Pire, il semble que de nouvelles formes d’exclusion sociale, au-delà des formes territoriales, se cumulent aux anciens facteurs d’exclusion liés à l’histoire du colonialisme et à la discrimination raciale.
Nouvelles et anciennes formes d’exclusion
La concentration de pouvoir et de richesse dans les mains d’une minorité privilégiée est incontestable.
La société brésilienne se positionne comme un champion mondial des inégalités (PNUD 1999) avec un ratio de 28 entre les 40 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches (en France 6,5). Les 20 % les plus pauvres partagent 2 % du revenu (3 % en 1991, chute de 32 %), tandis que les 10 % les plus riches partagent 49,2 % de la richesse (44,5 % en 1991, soit une hausse de 10,6 %).
Il est difficile de ne pas être étonné de la relative acceptation par les Brésiliens de cette inégalité, en particulier chez une élite se dédouanant de toute responsabilité en mettant en avant le mérite personnel et l’existence d’une (pseudo) échelle de mobilité.
Malgré des droits formellement reconnus par l’État10, l’inégalité sur la base de la race en fait une variable fondamentale aussi bien en ce qui concerne le niveau de revenu que les opportunités d’emploi ou le niveau d’éducation : par exemple, 41 % des Blancs ont un emploi « formel » (employés avec carte de travail ou fonctionnaires publics) et seuls 33 % des Noirs (IBGE, 2001). Les Noirs sont concentrés dans les tâches les moins qualifiées et les moins bien rémunérées.
Les taux de chômage montrent que les Blancs sont moins affectés que les non-Blancs (negros et pardos principalement). Dans la région métropolitaine, en 2002, le taux de chômage est de 17 % chez les non-Blancs et de 11,7 % chez les Blancs. Le taux de chômage a cru chez les premiers de 40 % en dix ans, et de 19,5 % chez les Blancs11.
Ceci est non seulement le fait de la qualification mais peut être également attribué à la discrimination raciale qui grève la mobilité sociale des Noirs dans son ensemble.
Pourtant, au Brésil, la plupart des études traitent de la ségrégation économique, donc en termes de classe, occultant la race, pour des raisons fortement idéologiques12. L’absence de conflits raciaux semble en effet une norme de comportement. Les manifestations d’intolérance sont considérées comme contraires à l’esprit brésilien qui porte l’idéal de la « démocratie raciale ». À ce titre, on y parle difficilement de racisme, et la pauvreté est codifiée comme un problème de classe plus que de race. Mais en plus des vestiges du passé esclavagiste encore présent dans l’imaginaire et l’inconscient collectif du peuple brésilien, le racisme actuel est le produit de la société contemporaine et repose sur d’autres antagonismes : riche-pauvre, éduqué-illettré.
Une combinaison de facteurs d’exclusion
Dans les années cinquante puis soixante-dix, les favelas se peuplent de Nordestins qui constituent les « nouveaux migrants », appelés de manière indifférenciée et péjorative « Nordestinos » ou « Baianos ». Jouent ici deux dynamiques de stigmatisation, l’une ancienne, fondée sur le mépris pour le Noir, l’autre plus récente, liée aux problématiques économiques et urbaines actuelles qui rejettent « l’émigré », celui qui vient manger le pain des locaux. Ce dernier phénomène est plus violent que le premier : ce sont les Nordestins actuels qui cristallisent tous les préjugés.
Puis, à partir des années quatre-vingt, se dessinent de nouveaux mécanismes sociaux d’exclusion, entre autres engendrés par les migrations de populations pauvres. Dans la construction du statut, la position sur l’échelle de classe – et de richesse – gagne une importance considérable.
La ségrégation des immigrés passe par leur exclusion de l’accès aux ascenseurs de mobilité sociale. Ne trouvant place que dans les favelas de la périphérie, ils n’ont accès qu’à un enseignement public dégradé, à l’opposé de l’élite qui s’offre un enseignement fondamental privé de qualité. À cet égard, on notera que les premières mesures de la récente politique de discrimination positive (2004) concernent les quotas dans les universités : la race est perçue comme la variable centrale, et l’éducation comme le secteur clef.
Autre facteur d’exclusion : la difficulté à accéder au marché du travail formel. Comme on l’a dit, un double coup a été porté aux travailleurs peu qualifiés au cours des années quatre-vingt. Ils se sont vu rejetés dans le secteur informel13 pour une grande partie, ou directement confrontés au chômage. Ainsi l’activité informelle (petits métiers de revente de produits de consommation, petits services tels que livreurs en moto ou domestiques, marché informel de la construction, vente de drogue, etc.), lié au manque chronique d’emploi, font grandir le fossé avec la ville formelle. Du manque d’activité économique formelle in situ dans la favela découlent des pathologies (jeunes désœuvrés, violence, sentiment de ghettoïsation, etc.).
Vers l’anomie urbaine ? Violence et drogue
Comment le développement de cette ville duale, l’une verticale, l’autre horizontale, l’une légale, l’autre illégale, peut-il ne pas déboucher sur l’anomie ?
Un état parallèle : le monde de la drogue et de la violence
Le trafic de drogue s’est imbriqué étroitement dans la vie de la favela, et y tient maintenant un rôle majeur. Il a pris possession des territoires pauvres et y décide de la vie sociale. Dans ces espaces où l’État est absent et où la police se montre très ambivalente face au réseau de drogue, le gang protège et fait le médiateur : intermédiaire avec la police, il protège également le territoire de la favela contre l’invasion d’un autre gang qui viendrait y étendre son marché. Il rend une justice locale, comblant le vide laissé par l’État, et a bien sûr un poids économique important.
Pourquoi ce développement spectaculaire de la drogue ? La première raison est la très grande proportion de jeunes en âge de travailler et sans emploi, pour lesquels la narco-économie est quasiment une question de survie. Si le taux de chômage en 2003 est de 9,7 %, il est de 18 % chez les jeunes, car ce groupe d’âge, le plus nombreux dans la population, est celui qui exerce la pression la plus forte sur le marché de l’emploi. Pour ces jeunes nés dans la violence, à quelques centaines de mètres d’un marché de biens de consommation auquel ils n’ont pas accès, l’incompréhension et le sentiment d’injustice sont destructeurs, et la comparaison salariale en bas de l’échelle est simple : le salaire d’un livreur en moto est de l’ordre de 400 reals par mois (150 euros) alors que celui d’un vendeur dans une « boca » (point de vente) y est d’environ 1 000 reals, avec des possibilités plus prometteuses en termes de revenus. Une seconde raison nous semble être la dissolution croissante du modèle de la famille nucléaire traditionnelle.
La violence est un corollaire inévitable du trafic de drogue. La facilité de l’accès aux armes à feu vient la renforcer14. Ainsi São Paulo est mondialement réputée pour sa violence, qui touche les quartiers les plus déshérités, et surtout les hommes jeunes c’est-à-dire la tranche d’âge 15–24 ans. De cette mortalité découle un sex-ratio révélateur : la ville compte 52,34 % de femmes et 47,66 % d’hommes (2002). Certes, la tendance récente montre une amélioration du taux d’homicides, tombé de 64 pour 100 000 en 1999 à 36 pour 100 000 en 200415, accusant donc une chute de 40 % en cinq ans. Ces homicides, pour plus de 90 % à l’arme à feu.
Resistances civiles, résistances culturelles ?
Il n’y a pas lieu de considérer toutes les formes de « résistance » de la population à ces formes d’anomie urbaine : on notera toutefois la multiplication des associations de résidents ou de quartiers de São Paulo qui forcent les autorités locales à mettre en place un minimum de services publics, ou encore des modes de gestion coopératifs participatifs et autres palliatifs à l’inefficacité de l’État dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Au Brésil, l’apparition d’associations et la participation de la société civile est particulièrement tributaire du contexte politique. Lors de la transition de la dictature à la démocratie (1970−1980), on a assisté à l’émergence de nouvelles organisations, de nouveaux partis (comme le PT), à la vigueur de l’église catholique et à la véhémence de mouvements indépendants. D’aucuns voient, avec l’institutionnalisation de ces mouvements au début des années quatre-vingt-dix, le passage des manifestations à la négociation, tout cela dans un climat politique plutôt libéral de réduction d’emplois, de flexibilisation du droit du travail, de réduction des investissements sociaux, de privatisation et d’appauvrissement des classes moyennes et basses.
Il y aurait eu un regain d’activisme avec l’élection PT de Marta Supplicy en 2001 : des actions sociales marquantes ont impulsé de vraies nouveautés dans les régions les plus pauvres, comme la conception d’un nouveau programme de la santé sur la base d’un système unique (SUS) ; le Movimento pro Moradia (inscription pour des terrains et des maisons populaires) et la régularisation retrouvent plus d’efficience. L’extension du budget participatif (Orçamento Participativo), et surtout la mise en place de programmes sociaux (renda minima, etc.) trouvent un écho important chez les favelados.
C’est sans compter l’action sociale des ONG, des hommes politiques, des églises. Le plus spectaculaire est le relais pris par les églises évangéliques dans les milieux populaires. De 3 % dans les années cinquante, les évangéliques représentent aujourd’hui 15 % des fidèles, dont 4 % de protestants « traditionnels » et 10,5 % de pentecôtistes (Assembleia de Deus, la plus importante des églises pentecôtistes avec 8,5 millions de fidèles au Brésil) et de la Congrégation (Congregacão Cristã do Brasil), tandis que les catholiques passent de 93,5 % à 73,7 %.
D’une part l’urbanisation fulgurante a permis l’anonymat et la liberté de culte, avec un contrôle social moindre ; la démocratisation du pays a permis la prolifération des cultes : autant de facteurs qui expliquent la vague des églises évangéliques. Mais surtout le succès de leur implantation repose sur un recrutement systématique dans les couches les moins éduquées de la société, et une logique de proximité qui explique la multiplication des temples dans des locaux extrêmement modestes aux quatre coins des favelas. Elles dispensent à la fois « une énergie communautaire » et des règles qui permettent de structurer un espace quotidien déstructuré.
Enfin les nouvelles cultures urbaines très revendicatives que l’on peut observer sont une autre modalité de cette « résistance ». C’est dans un contexte urbain qui accentue la dissolution des identités culturelles pour des migrants déterritorialisés et pour une jeune génération sans racine, qu’une culture alternative a pris forme, qui adapte et instrumentalise une certaine esthétique noire. Le mouvement hip-hop, né des jeunes de la périphérie, est aussi vecteur de revendication d’une certaine négritude, profondément inspirée de l’urbanité américaine. Il inclut en premier lieu les musiques hip-hop et funk mais aussi diverses manifestations culturelles comme la danse capoeira-rap et les graffitis, élément fondamental du paysage visuel pauliste. Ce nouveau véhicule des messages sociaux propose des modèles alternatifs, et questionne dans son langage musical et visuel la violence, l’exclusion et les inégalités.
Cri étonnant dans le chaos de cette ville hybride, dont la fracture guette bien d’autres de ses homologues du Sud, et dont le modèle de développement dont elle est issue semble inéluctablement voué à l’impasse sociale. Qui des associations, des hommes politiques, des églises ou de sa population excédée saura trouver de nouveaux chemins ?
__________________________________________________
1. Zweig S., Brésil, Terre d’avenir, éditions de L’Aube et Livre de poche, trad. de l’allemand (Autriche).
2. Les bandeirantes du XVIIe et XVIIIe siècles font de São Paulo le point de départ pour l’exploration de terres inconnues.
3. Lévi-Strauss C., Tristes Tropiques, Plon, 1933, 1955, p. 78.
4. La ville est en effet passée de 1 million d’habitants dans les années trente, époque à laquelle elle commence à s’industrialiser et attirer des migrants, pour décoller dans les années cinquante et soixante. Elle en possède 10,6 millions aujourd’hui et compte parmi les cinq premières mégapoles mondiales. À la ville même, il convient de rajouter 8, 2 millions de personnes pour appréhender la Région métropolitaine de São Paulo (RMSP, soit 39 municipalités en incluant São Paulo).
5. Par favela (version brésilienne du bidonville) la littérature sociologique entend un ensemble d’habitations se caractérisant par son illégalité, son insalubrité et sa culture spécifique. L’IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, homologue brésilien de l’INSEE, privilégie cette notion d’illégalité en répertoriant les favelas sous la nomenclature « habitat hors norme ».
6. Lévi-Strauss C., Op. Cit., p. 116.
7. Pour une description des mécanismes de restructuration productive de São Paulo, voir par exemple Pochmann, M. (dir.), Reestruturação Produtiva, Vozes, 2004.
8. États de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia.
9. Caldeira Teresa Pires do Rio, Cidade dos Muros – Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo, Edusp, 2000.
10. L’État reconnaît l’égalité de tous, la Constitution de 1988 fait du racisme un crime, le paragraphe VIII sur le pluralisme ethnique engage la protection de l’État des populations indigènes et afro-brésiliennes, la loi Caó de 1989 définit les crimes résultant de préjugés de race et couleur (amendée en 1990, elle approfondit la notion d’ethnie).
11. Cf. étude du IETS (Instituto de estudos Do Trabalho e Sociedade) sur São Paulo à partir des données IBGE 1991–2000. Cf. également Jaccoud L. & Beghin N. Desigualidades Raciais no Brasil, IPEA, 2002.
12. Sur l’histoire du racisme au Brésil, profondément liée à la question de l’identité nationale, voir en particulier d’Adesky J. Racismos e anti-racismos no Brasil, RJ, Pallas, 2001 et Ianni O. Pensamento Social no Brasil, Edusc, 2004.
Avant les années 1950, un courant de pensée s’appuie sur l’infériorité raciale et physique du Noir, qui doit disparaître grâce au blanchissement (branqueamento) progressif par miscégénation (souvent traduit par métissage). La construction de l’identité nationale va s’appuyer à partir des années cinquante sur l’idée que l’héritage culturel brésilien est enraciné dans le mélange des races (S. Buarque de Holanda e G. Freyre reconnaissant le mélange historiquement nécessaire à l’adaptation des Blancs sous les Tropiques) et que le « nègre » est un élément fondateur de la société brésilienne. On voit le biais idéologique d’un tel système : sous couvert de faire l’éloge du métissage, c’est la disparition à terme du Noir et la dominance des Blancs qu’on promeut.
Le racisme larvé qui parcourt le Brésil actuel est tout aussi ambigu : un univers antiraciste vante une société plurielle, mais nie dans les faits la présence intégrale des Noirs, l’idée étant que, par l’éducation et la mixité, ces groupes peuvent sortir de l’infériorité. Au mieux donc, on est face à un discours assimilationniste influencé par la construction d’une identité commune, qui déprécie les particularismes et privilégie la matrice culturelle dominante.
13. Sous l’expression de secteur informel, on désigne l’ensemble des petites unités de travail familiales ou non, qui produisent pour l’autoconsommation et le marché, échappent à l’enregistrement administratif et la fiscalisation : ce sont les unités en compte propre, domestiques, les micro-entreprises (etc.).
Ces unités de production ont un certain nombre de caractéristiques : elles génèrent peu de revenus, fonctionne avec un taux de productivité très bas, et des travailleurs peu qualifiés. La dimension sociale précaire est étroitement liée à la dimension économique.
14. Le débat est lancé à l’occasion du référendum sur la prohibition de la vente libre d’armes à feu et de munitions le 23 octobre 2005. La victoire massive du « non » à la prohibition fait réfléchir sur la conception qu’ont les Brésiliens de la citoyenneté urbaine et du « droit » à se défendre. Du reste, cette victoire a également été analysée comme un vote sanction contre l’actuel gouvernement, sachant qu’interdire le commerce des armes ne résout pas le problème économique et social gravississime au fondement de la violence.
15. Chiffres du SEADE et du NEV. Pour comparaison, les chiffres de Paris sont de 2 pour 100 000.