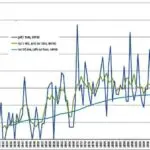Louis André (X 1857) le ministre qui mit fin à l’affaire Dreyfus
En mettant un terme à l’affaire Dreyfus au sein de l’armée, le général Louis André, ministre de la Guerre de 1900 à 1904, fit preuve d’une détermination et d’un courage peu ordinaires. Itinéraire d’un grand polytechnicien, mal connu.
Répondant à un fameux discours de Jean Jaurès à la Chambre des députés (6 et 7 avril 1903), tout en affirmant qu’il ne pouvait que respecter le verdict de Rennes, qui avait de nouveau condamné le capitaine Alfred Dreyfus, mais avec circonstances atténuantes – décision absolument incompréhensible s’agissant d’une accusation de trahison – au nom de la « chose jugée », Louis André va cependant proposer de mener, au sein de son ministère de la Guerre, une « enquête personnelle » pour savoir dans quelles conditions, et sur quelles pièces, Alfred Dreyfus avait été condamné à la déportation à perpétuité en décembre 1894. Si incroyable que cela puisse paraître, cela n’avait pas été fait. Louis André était pourtant le 6e ministre de la Guerre (à ne compter que ceux qui auront tenu le poste plus de deux mois…) depuis le déclenchement de l’Affaire.
Des preuves irréfutables
Aidé de son officier d’ordonnance, le capitaine Antoine Targe (X 1885), le général André va découvrir en quelques mois que Dreyfus avait été condamné au vu de pièces inventées ou falsifiées et que des documents favorables à l’accusé n’avaient pas été fournis au Conseil de guerre. Il démontrera aussi que les « aveux » de sa culpabilité qu’aurait faits le capitaine Dreyfus le jour de sa dégradation (5 janvier 1895) avaient été purement et simplement inventés par l’officier qui commandait, ce jour-là, le détachement de la Garde républicaine chargé de veiller sur le condamné, ces « aveux » étant validés par écrit avec la signature du général Charles-Arthur Gonse, sous-chef d’état-major de l’armée.
Saisie de la Cour de cassation
Fort de ces découvertes, le ministre de la Guerre va demander et obtenir du gouvernement d’Émile Combes que ces éléments nouveaux soient transmis à la Cour de cassation, non sans quelques difficultés : il fit rapport de son enquête au président du Conseil le 19 octobre 1903, mais il dut attendre plus d’un mois, malgré ses demandes pressantes réitérées à chaque conseil des ministres, pour voir la demande de révision qu’il préconisait être transmise au ministère de la Justice, ce qui fut fait le 22 novembre 1903. Le garde des Sceaux attendra le jour de Noël 1903 pour saisir officiellement la Cour de cassation. L’enquête du ministre de la Guerre avait duré un peu plus de six mois, du 7 avril 1903 au 19 octobre 1903. Pour lui, l’honneur de l’armée nécessitait qu’elle reconnaisse ses erreurs dans l’Affaire.
La Cour de cassation, après une enquête complète et rigoureuse de plus de deux ans, va définitivement innocenter le capitaine Dreyfus le 12 juillet 1906. Louis André tentera, en vain, dès sa nomination, de faire réintégrer dans l’armée – dont il avait été chassé de manière ignominieuse – le colonel Georges Picquart, l’un des dreyfusards de la première heure.
“La tâche que je me suis imposée
est de maintenir la discipline militaire
la plus absolue”
Un parcours polytechnicien brillant
Né à Nuits-Saint-Georges le 29 mars 1838 dans une famille de tonneliers aisés et pieux (cinq de ses membres sont dans les ordres), Louis André entre à l’École polytechnique en 1857, à 19 ans. Il est le premier de sa famille à quitter Nuits. Il poursuit sa formation militaire à l’école d’application de l’artillerie et du génie à Metz, dont il sort major, et devient un artilleur très brillant. Durant la Commune de Paris, après la défaite de Sedan, il servira dans l’artillerie de la Garde impériale. Colonel en 1888, il est nommé général de brigade et commandant l’École polytechnique en 1894, jusqu’en 1896.
L’amitié d’un camarade de promotion, Sadi Carnot (X 1857), petit-fils du « grand » Carnot (Lazare), devenu président de la République en 1887, n’a sans doute pas été étrangère à cette nomination. Le général Louis André a l’honneur de présider les cérémonies du centenaire de l’École, en mai 1894, en présence de Sadi Carnot, qui mourra assassiné par un anarchiste italien, d’un coup de poignard, le mois suivant, en juin 1894. Il rénove l’enseignement de l’École, appuyé par Henri Becquerel et d’autres professeurs, qui le considèrent comme l’un des leurs en raison de ses capacités scientifiques reconnues.
Un ministre de la Guerre réformateur
Nommé général de division en 1899, il est appelé l’année suivante au ministère de la Guerre par le président du Conseil, Pierre Waldeck-Rousseau. Louis André se fixe alors pour tâche de démocratiser l’armée et de « rapprocher le corps des officiers de la nation républicaine ». Il supprime l’exigence d’une dot importante pour les épouses d’officiers, disposition qui contribuait à faire vivre l’armée dans un milieu fermé.
Il obtient que le ministre ait ès qualités un avis sur les nominations aux postes d’importance, mettant fin aux prérogatives du seul état-major, qui procédait par cooptation et ne rendait compte qu’à lui-même. Les bureaux du ministère de la Guerre sont autant de petites Bastilles pour qui l’obéissance au pouvoir civil ne va pas de soi. Louis André réforme également l’artillerie, imparfaitement équipée. Il est enfin à l’origine de la loi du 21 mars 1905 qui abaisse la durée du service militaire de trois à deux ans.
Les difficultés de l’autorité
En accord avec le président du Conseil, le général André s’attache à rétablir la discipline dans l’armée où nombre d’officiers avaient pris position publiquement contre Dreyfus. Son premier acte sera de décider du remplacement de trois responsables de bureaux à l’état-major, ce qui va déclencher une vive réaction des généraux Jamont, vice-président du Conseil supérieur de la guerre, et Delanne, chef d’état-major de l’armée, qui l’accuseront de « désorganiser l’armée ».
Devant cette manifestation publique de désaccord, le général André va mettre immédiatement fin aux fonctions de ces deux généraux (4 juillet 1900), qui occupaient alors les deux principaux postes de l’armée. Cette décision était destinée à montrer que tous les actes d’indiscipline, y compris dans les plus hauts grades, seraient désormais sanctionnés sans faiblesse, et qu’il conviendrait maintenant d’obéir au ministre. Le général André déclarera ce jour-là à la Chambre des députés : « Soyez certains, Messieurs, que la tâche que je me suis imposée est de maintenir à tous les degrés de l’échelle, et de rétablir, s’il en était besoin, la discipline militaire la plus absolue. »
Vindicte militaire
Parmi les militaires ostracisés, Hubert Lévy-Lambert (53) cite notamment, in http://www.annales.org/archives/x/dreyfus95.html : « Le colonel Georges Picquart, le commandant Ferdinand Forzinetti, directeur de la prison du Cherche-Midi, révoqué pour avoir témoigné de son intime conviction de l’innocence de son prisonnier, le colonel Jouaust (X 1858), mis à la retraite après avoir osé voter pour Dreyfus à Rennes, ou encore le général Messimy, poussé à la démission. » On peut citer aussi Édouard Grimaux, membre de l’Institut, professeur à l’École polytechnique, mis à la retraite d’office par le général Billot, ministre de la Guerre, pour avoir osé déposer au procès Zola
le 15 février 1898 en faveur de Dreyfus.
L’affaire « des fiches »
À ses yeux, l’une des tâches du ministre de la Guerre était de prendre la défense des officiers républicains, dont la carrière avait souffert du fait de leur républicanisme et de leur prise de position dans l’affaire Dreyfus, et de les prémunir contre les attaques des éléments réactionnaires.
C’est pourquoi il confia à son chef de cabinet et à l’un de ses officiers d’ordonnance la poursuite d’un recueil de renseignements sur les officiers, fournis, au départ, par le ministère de l’Intérieur. 25 000 dossiers, nommés fiches, furent ainsi enrichis ou constitués, à l’aide d’informations transmises par la hiérarchie militaire, quelquefois aidée par les francs-maçons, qui disposaient de loges dans toutes les villes de garnison. Le chef de cabinet et l’officier d’ordonnance du ministre étaient membres du Grand Orient de France.
Poussé à la démission
Interpellé à ce sujet à la Chambre des députés, le ministre tomba des nues, ignorant, non point ce concours, mais les formes qu’il revêtait, inadmissibles, et arrêtées à son insu. Un député extrémiste, Gabriel Syveton, se permit de le gifler publiquement à deux reprises. Ulcéré, épuisé, quoiqu’il fût une force de la nature, Louis André démissionna en novembre 1904. Il adressa une lettre au président du Conseil, Émile Combes, qui dit les ravages du harcèlement dont il avait été victime pendant plus de quatre ans :
« (…) Je ne vis plus. À toute minute, je m’attends à apprendre que les membres du Conseil supérieur de la Guerre, dont l’animosité contre ma personne et mon œuvre républicaine m’est connue, ont fait auprès de M. Loubet (le Président de la République) quelque démarche me visant. Si pareil acte se produisait, je ne suis pas homme à le supporter. » Son ministère avait été l’un des plus longs de la IIIe République.
Jusqu’en 1910, il demeura conseiller général de Gevrey-Chambertin, en Côte‑d’Or. Il mourut à Dijon le 18 mars 1913, un an avant le déclenchement de la Grande Guerre, d’artériosclérose : grand fumeur, il avait fait, durant sa scolarité à l’École polytechnique, douze jours de salle de police pour avoir fumé dans des locaux où c’était interdit.
Une personnalité hors du commun
La personnalité du général André était aussi peu banale que son républicanisme était sans concession. Il épousa en 1876 une jeune cantatrice promise à un grand avenir professionnel, déjà reconnue en France et en Grande-Bretagne, Marguerite Chopis. Il a 38 ans, elle 24. Leur mariage fut heureux, comme celui de Winston Churchill avec Clémentine Hozier. Mais c’était complètement atypique dans l’armée de l’époque et, au début, la bonne société refusa de les recevoir.
Libre penseur, disciple d’Émile Littré, qui lui a demandé des articles, adepte de la philosophie positiviste d’Auguste Comte, Louis André est l’un des rares officiers de haut rang à être républicain, au sein d’une armée devenue, après la défaite de 1870, monarchiste, cléricale et, très souvent, d’un antisémitisme fanatique. Louis André n’était pas franc-maçon, contrairement à une légende tenace et, s’il bénéficia, à un certain moment, de l’intervention de cette Fraternité, ce fut sous une forme qu’il n’eût pas tolérée s’il l’avait sue.
Un chef très respecté
Au physique, il était de grande taille, maigre, élégant, excellent cavalier – il ne videra les étriers qu’une seule fois dans sa vie –, peu militaire d’apparence, notamment dans son habillement, et pourtant viscéralement attaché à la chose militaire. Son comportement intransigeant sur les fondamentaux républicains le faisait parfois paraître rêche ou rigide, dans un ministère accoutumé aux passe-droits, aux « aberrations » ou aux « monstruosités », mais les soldats l’adoraient, de même que le personnel de l’École polytechnique, qui lui offrit un présent lors de son départ en 1896. La vindicte extrémiste qui prétendait lui dicter son comportement de ministre s’acharna contre lui, le disant vendu à des forces occultes, l’accusant de détruire l’armée, le caricaturant en ivrogne alors qu’il ne buvait pas et allant jusqu’à le qualifier de « laid ».
Il convient de rappeler que l’affaire Dreyfus continua de produire des effets de haine après le verdict de la Cour de cassation en 1906 : en 1910, deux coups de feu sont tirés sur Alfred Dreyfus, lors du transfert au Panthéon de la dépouille d’Émile Zola. L’auteur de l’attentat, immédiatement appréhendé, est un journaliste du nom de Grégori, qui se présente comme un « fervent patriote » et déclare n’avoir pu supporter l’humiliation infligée à l’armée française. Son geste fait écho aux cris des manifestants nationalistes qui, au même moment, entourent le Panthéon et, depuis la veille, tentent par tous les moyens d’empêcher la cérémonie.
Avec le concours d’Alain Galonnier et de Vincent Raude. Des remerciements particuliers vont à Édouard Bouyé et Jean-Baptiste Dor, des Archives départementales de Côte‑d’Or.
Pour aller plus loin :
André (Louis), Cinq ans de ministère, Hachette, Paris, 1909, opus cité.
Doessant (Serge), Le général André, éditions Glyphe, Paris, 2009.
Bredin (Jean-Denis), de l’Académie française, L’Affaire, Fayard-Julliard, Paris, 1993.