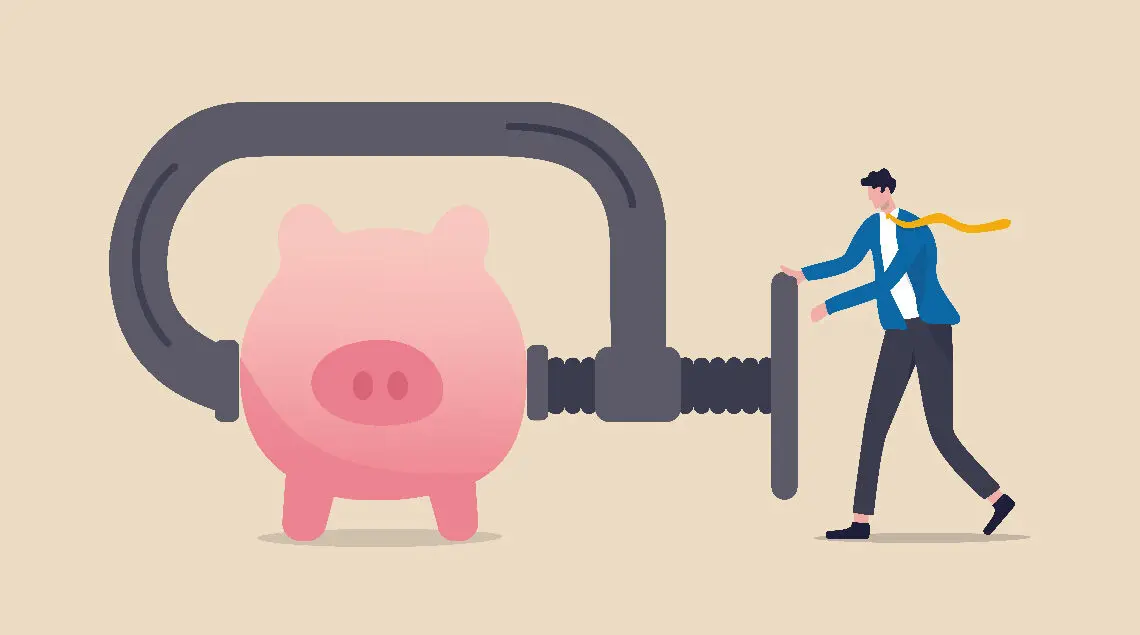Maîtriser la dette : contrôle du crédit et régulation bancaire

Le système bancaire joue un double rôle de matrice et de soupape du crédit : la soutenabilité des endettements et l’appréciation du risque dépendent au premier chef de son efficace régulation.
Pourquoi les banques jouent-elles, en Europe, un rôle beaucoup plus important qu’aux États-Unis dans l’accès au crédit ?
En Europe, aux États-Unis et partout ailleurs, le secteur bancaire joue un rôle clé dans le financement de l’économie. Il n’en existe pas moins des différences significatives entre régions. Aux États-Unis, l’accès au crédit des entreprises est majoritairement lié aux marchés de capitaux, puisque deux tiers du volume des emprunts, environ, prennent la forme d’émissions obligataires.
En Europe, a contrario, les banques sont les principaux fournisseurs de crédit aux entreprises, dans des proportions à peu près inverses à celles des États-Unis. Plusieurs facteurs expliquent ces différences. Premièrement, les entreprises européennes sont en moyenne plus petites et présentent donc des besoins de financement plus limités. Deuxièmement, les horizons d’investissement sont plus longs aux États-Unis. Cela correspond notamment aux besoins des fonds de pension et des assureurs, dont le poids est nettement plus important outre-Atlantique.
Repères
Jean-Pierre Mustier s’est imposé comme une figure majeure de la finance internationale en sa triple qualité de dirigeant de grandes institutions de la place, d’autorité sans égale dans la maîtrise technique des rouages du crédit et de vigie clairvoyante des tendances macroéconomiques de long terme. Il a débuté sa carrière en 1987 à la Société générale, où il a travaillé essentiellement dans la banque de financement et d’investissement.
Début 2011, il rejoint UniCredit en tant que responsable de la banque de financement et d’investissement. En janvier 2015, il est devenu un associé basé à Londres de Tikehau Capital, un groupe de gestion d’investissement alternatif. Il a rejoint UniCredit en juillet 2016 en tant que directeur général, et a également été président de la Fédération bancaire de l’Union européenne entre 2019 et 2021. Il est actuellement sponsor et partenaire opérationnel de Pegasus Europe, une société d’acquisition spécialisée, focalisée sur les financières européennes.
D’importants changements de régulation sont intervenus depuis 2008 pour mieux contrôler le levier bancaire. Ces mécanismes dits macroprudentiels ont-ils joué leur rôle ?
La prépondérance des banques dans le cycle du crédit européen pose nécessairement la question de leur régulation. À la suite de la crise de 2008, les autorités ont fixé dans ce domaine des normes claires qui doivent à présent être revues et adaptées pour rester efficaces. L’accent a été mis, historiquement, sur le niveau des fonds propres des banques pour s’assurer qu’elles ont bien la capacité d’absorber d’éventuels chocs.
L’objectif est de trouver un juste équilibre entre la précaution et la souplesse : imposer aux banques un niveau de fonds propres élevé est louable, mais il ne s’agit pas non plus de leur ôter toute rentabilité, ce qui les empêcherait de financer les entreprises et les ménages. Certaines normes comptables, en associant le niveau de capitalisation à celui des provisions sur prêts douteux, ont par exemple un effet procyclique potentiellement dangereux : plus une crise est grave, moins les banques sont en mesure de jouer leur rôle…
“Gagner en transparence pour éviter
de nouvelles dérives.”
À l’heure où les bilans bancaires sont de plus en plus complexes, il est souhaitable que la régularisation attache davantage d’importance à la lisibilité des fonds propres et à leur disponibilité qu’à leur niveau. De plus, il faut à tout prix éviter les distorsions de concurrence que pourraient induire, au sein du marché unique européen, de trop nettes disparités géographiques dans les outils de mesure : les nouvelles normes de Bâle IV, à cet égard, devraient utilement agir dans le sens d’une homogénéisation.
Enfin, au-delà des règles applicables individuellement, un autre écueil à éviter, peut-être encore plus menaçant, est celui de la procyclicité en matière d’offre et de demande de crédit. C’est hélas une tâche autrement plus ardue, qui touche à un aspect fondamental de nos économies : des taux faibles encouragent la hausse des endettements et une baisse du coût du risque, mais pourraient durement pénaliser prêteurs et emprunteurs en cas d’inflexion des politiques monétaires. C’est ce que les marchés semblent craindre depuis le début de cette année.
Des volumes considérables de prêts garantis ont été mis en place par les États en 2020, notamment en Europe. La distinction entre dette publique et dette privée est-elle en train de s’estomper ?
Elles sont bien distinctes mais souvent intimement liées : dans certains pays d’Europe, notamment en Italie, la dette publique est largement détenue par les banques domestiques, lesquelles sont déstabilisées par toute forte hausse du spread, le différentiel de taux d’intérêt des bons du Trésor italiens (BTP) par rapport à une référence donnée (le Bund allemand, par exemple). Pis encore, un affaiblissement des bilans bancaires freine leurs achats de dette publique, au risque de réduire la demande pour les titres émis par l’État – et de peser sur le spread, etc.
Cette spirale de la catastrophe ou doom loop est un effet pervers que seule la Banque centrale européenne a les moyens de corriger, par des programmes d’achat de dette souveraine. C’est ce qu’elle fait depuis déjà plusieurs années. Cette solution n’est hélas pas parfaite : en plus d’être fragile du point de vue des traités, comme le rappellent régulièrement les autorités politiques de certains pays membres, des contraintes de parité l’empêchent d’investir sans restriction et de porter secours aux États perçus comme étant les plus à risque. Pour régler ce problème, les banques devraient pouvoir comptabiliser différemment, sur leur bilan, les dettes publiques de différents pays. Au sein de la zone euro c’est hélas impossible, en tout cas à l’heure actuelle : il faut attendre une évolution des textes.
Les banques centrales ont répondu à la crise financière en adoptant des politiques non conventionnelles mixtes d’injection de liquidités sur les marchés et de taux directeurs faibles voire nuls ou négatifs. Quel est l’impact de long terme pour les banques de ces mesures inédites ?
Paradoxalement, l’impact de premier ordre a été plutôt positif pour les banques, qui ont enregistré d’importantes reprises sur provisions : logiquement, des taux plus faibles solvabilisent les emprunteurs financièrement les moins solides. À plus long terme, en revanche, cela entraîne évidemment de sérieuses difficultés, d’autant plus que le phénomène s’aggrave en se prolongeant : les dépôts ne peuvent pas être rémunérés à des taux négatifs, ce qui fragilise les banques et limite donc leur capacité à financer l’économie. L’efficacité d’un système monétaire tient à sa capacité de modifier le comportement des agents. En dévitalisant les banques commerciales, les banques centrales ont brisé ce mécanisme de transmission. Bien sûr il faut en priorité répondre aux urgences, mais la question de la sortie de cette situation reste entière.
La réponse à la crise sanitaire actuelle a principalement pris la forme de prêts garantis par l’État : n’est-ce pas soigner la dette par plus de dette encore, concentrée cette fois dans les bilans publics ?
La survie financière d’entreprises frappées de plein fouet par la pandémie était un impératif catégorique : dans l’urgence, les États ont agi avec clairvoyance et pragmatisme. Toujours est-il que ces décisions ne seront pas sans conséquence, notamment dans l’hypothèse d’une reprise moins forte que prévu. Dans ce cas, les soutiens publics n’auraient permis que la mutation d’une crise de liquidité en une crise de solvabilité. Même les acteurs qui, par chance, verraient leur activité reprendre rapidement n’en afficheront pas moins des ratios d’endettement dégradés et un potentiel d’investissement amoindri.
Cette situation, quoique préoccupante, n’est pas nécessairement une impasse. Des remèdes existent, consistant notamment à transformer les financements garantis en prêts subordonnés. Cette mesure aurait d’ailleurs un autre effet vertueux, puisqu’elle pallierait la faiblesse des quasi fonds propres dont souffrent depuis longtemps nombre d’entreprises européennes.
Les États comme les banques centrales insistent sur le fait que les conditions économiques et les politiques actuelles sont exceptionnelles. Personne, pourtant, n’ose encore sérieusement envisager la sortie du statu quo. Quand et comment pourrait s’effectuer la normalisation ?
Le chemin, pour ce faire, est sans balise. Non seulement les taux nuls ou négatifs nuisent à la bonne transmission monétaire, mais les injections de liquidités, au demeurant nécessaires, favorisent l’apparition de disparités dans l’octroi de financement : crédit sans réserve pour les plus grands groupes mais beaucoup moins généreux pour les PME, qui constituent néanmoins l’essentiel du tissu économique en Europe. De deux choses l’une : en cas de retour rapide d’une croissance stable, la sortie se fera graduellement, vraisemblablement sans dommage, et les effets pervers disparaîtront peu à peu ; dans le cas contraire, leur maintien pourrait s’envisager à beaucoup plus long terme, au point de laisser les dommages collatéraux changer durablement la donne économique.
Dans ce contexte de renforcement réglementaire et de taux zéro, les acteurs numériques des services financiers constituent-ils une réelle menace pour les banques ?
Les fintechs font en effet les gros titres de la presse depuis quelque temps. Leur arrivée se traduira certainement par de réels bienfaits pour le consommateur, mais il est peu probable que ces acteurs constituent une réelle menace pour le secteur bancaire : ils s’adressent généralement à des segments de marché différents, peu couverts par les établissements de crédit, et dans des volumes généralement faibles.
C’est surtout dans le domaine de la dette privée, désintermédiée, que de réels changements sont à attendre : ces outils s’ajoutent à la palette des financements existants, mais ils pourraient bien poursuivre leur montée en puissance et accroître leurs parts de marché au détriment de concurrents traditionnels moins réactifs dans le secteur bancaire. Or le crédit privé est encore relativement opaque et peu réglementé : la question du contrôle du risque se pose à nouveau, tout l’enjeu est de vite gagner en transparence pour éviter de nouvelles dérives.
Propos recueillis par Frederic Bonnevay (M2006) et Jean-Baptiste Michau (M2006)