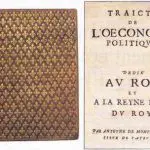Fonctionnement de l’économie et gestion des « ressources humaines » ; une cohérence à trouver

La capacité insolente des États-Unis à créer de l’emploi et à contenir le chômage, tout en étant quasiment dépourvus de chômeurs de longue durée, a quelque chose de surprenant et même vexant. Pendant longtemps c’est l’Europe, France comprise, qui a pu se targuer de montrer l’exemple, en ayant quasiment éradiqué le chômage, pendant que les États-Unis paraissaient, en la matière, le mauvais élève de la classe. Que s’est-il passé pour que la roue tourne, et semble-t-il de manière durable, et que pouvons-nous faire ? Les experts s’interrogent.
Les rigidités du marché du travail en Europe, le niveau, déclaré excessif, des salaires qui y prévaut, spécialement pour les moins qualifiés, le poids des prélèvements publics sont souvent mis en accusation, spécialement par les Américains, mais sans que cette vision emporte toujours la conviction1. Bien des choses incitent à penser que les interférences entre le fonctionnement de l’économie et la manière dont sont gérées les « ressources humaines » dans le quotidien de la vie des entreprises sont largement en question, mais les modèles des économistes ne prennent en compte ces interférences que de manière extrêmement fruste.
Prêtant dans ce domaine un début d’attention au cadre institutionnel et réglementaire, ils ignorent encore totalement ce qui relève des usages et des mœurs. Pourtant, à considérer de plus près, et dans toutes leurs dimensions, pareilles interférences, on est mis sur la voie d’une compréhension plus grande de nos maux porteuse d’une action plus efficace.
Une transformation radicale de la gestion des « ressources humaines »
Depuis trente ans, le fonctionnement de l’économie a bien changé. Le poids de plus en plus lourd de la concurrence dans un contexte de mondialisation et de dérégulation, le rôle croissant des actionnaires et la montée de leurs exigences en matière de rentabilité ont progressivement transformé la manière de gérer les entreprises. Et cette transformation ne laisse pas inentamée la gestion de leurs « ressources humaines ».
Longtemps, les restes d’une manière « archaïque » de conduire les entreprises ont contribué à amortir les chocs provoqués par les bouleversements de l’économie. Si, dans les années 50 et 60, les modernisateurs, qui parlaient haut et fort, n’avaient à la bouche que concurrence et élimination des formes économiques dépassées, ces formes subsistaient dans une large mesure. Bien des entreprises, qui restaient largement à l’abri à la fois d’une concurrence trop rude sur leurs marchés (comme cela apparaît bien a contrario par contraste avec la situation actuelle) et d’exigences trop sévères de leurs actionnaires, continuaient à entretenir des installations dépassées, des sièges sociaux pléthoriques, des activités annexes (des cantines à l’entretien des pelouses) à l’efficacité problématique. À tout cela s’associait chez beaucoup une gestion hautement paternaliste du personnel, qui voulait que l’on conserve les vieux serviteurs, ou ceux qui pour une raison ou une autre étaient en difficulté, même si leur contribution à l’efficacité productive devenait temporairement ou définitivement douteuse. Les intéressés trouvaient tout naturellement leur place dans les activités dont on attendait peu. De même les recrutements de jeunes n’étaient pas toujours très regardants en matière d’efficacité immédiate. Ces pratiques, qui n’avaient rien de légalement obligatoire, relevaient largement des mœurs. Convergeant avec les protections statutaires propres aux entreprises publiques, elles fondaient des sortes de politiques sociales invisibles auxquelles on ne prêtait guère attention, mais dont on commence à voir quelle place elles tenaient maintenant qu’elles tendent à disparaître. Elles étaient loin d’être le propre des entreprises françaises et, en particulier, on les retrouvait dans les entreprises américaines2.
Le contexte économique a profondément changé. Au fur et à mesure que l’intensification de la concurrence et la pression des actionnaires sont devenues réalité, les entreprises ont changé leur manière de gérer leurs « ressources humaines » et ce mouvement se poursuit. Avec des comptes en rouge, ou menaçant de le devenir, il s’est agi de plus en plus de pourchasser ce que les gourous du management ont appelé « l’usine fantôme » : toutes les activités qui occupent des gens, mais qui ne contribuent guère à la production finale. On s’est mis à « dégraisser » les sièges sociaux, on s’est livré de plus en plus à d’impitoyables « analyses de la valeur ». Il est clair qu’il y avait de quoi faire. L’intensification de la concurrence a bien joué le rôle qui lui était dévolu par les modernisateurs, de pression en faveur d’augmentations de productivité. Mais, du même coup, les politiques sociales invisibles associées à l’existence de ces activités fantômes se sont vues mises en cause.
Les entreprises ont changé leur manière de gérer leurs ressources humaines.
Dans cette évolution, qui est sans doute encore loin d’être achevée, car elle implique une évolution des mœurs, de la frontière entre le « normal », le tolérable et le scandaleux, qui prend du temps, ceux qui ne sont pas, ou plus, pleinement compétitifs ont vu progressivement leur destin se modifier. Les entreprises se sont montrées de plus en plus promptes à se séparer de leurs éléments les moins performants. Ce mouvement a affecté ceux qui, appartenant depuis plus ou moins longtemps à une entreprise, ont perdu de leur compétitivité. Naguère mis simplement sur la touche, tout en conservant un emploi, ils ont été de plus en plus remis sur le marché de l’emploi (ou préretraités), soit qu’ils aient été pris indistinctement dans de vastes opérations de « dégraissage », soit que de telles opérations aient représenté une occasion de les cibler afin de s’en séparer. Parallèlement les politiques de recrutement sont devenues beaucoup plus sélectives. Chacun est scruté, pesé avant d’être éventuellement élu ; CDD et intérim jouent le rôle de filtre à l’embauche, un recrutement ferme n’étant en fin de compte proposé qu’à ceux qui sont jugés les meilleurs. La sélection ainsi opérée est d’autant plus stricte que les formes d’organisation dites tayloriennes tendent à être remplacées par d’autres formes beaucoup plus exigeantes quant aux compétences et au « savoir-être » de chacun. De plus, à travers le développement de sous-traitances en chaîne, un nombre croissant de postes situés dans de grandes entreprises, notamment publiques, dont la gestion des hommes reste encore relativement traditionnelle, se trouvent transférés dans de petites structures qui, particulièrement soumises à la pression du marché, gèrent leur personnel sans trop d’états d’âme.
Les activités de tous niveaux ont été affectées par ce mouvement. La remise en cause des politiques sociales invisibles, sous l’effet de l’augmentation de la pression concurrentielle et des exigences des actionnaires, ne concerne pas seulement les activités « bas de gamme » et les travailleurs les moins qualifiés. Elle affecte tous ceux qui, quelle que soit leur qualification (fussent-ils ingénieurs hautement diplômés), offrent à leurs employeurs, à un moment ou à un autre, un rapport qualité-prix peu favorable.
Certes, les reconversions massives auxquelles conduit ce mouvement ne sont pas sans précédent. Dans la période de très faible chômage qui a marqué les « trente glorieuses », la contraction de l’agriculture a conduit à pareilles reconversions. Mais ceux qui ont alors quitté le monde agricole n’ont pas eu de mal à trouver place dans une industrie en expansion qui leur ouvrait les bras, sans trop faire de tri. Et ceux pour qui pareille reconversion était problématique ont pu continuer à « bricoler » dans des exploitations archaïques, ou dans des restes archaïques d’exploitations modernisées. Chacun trouvait plus facilement sa place.
Des réactions diverses selon les pays
Partout, du fait de cette évolution des pratiques des entreprises, ce qu’il est convenu d’appeler le marché de l’emploi se rapproche de plus en plus d’un véritable marché, régi par la loi de l’offre et de la demande, où chacun de ceux qui désirent trouver ou garder un emploi est amené à ne devoir compter que sur son potentiel marchand tel qu’il est évalué à chaque instant (situation qui marque traditionnellement les mondes du sport ou du spectacle). Mais ce mouvement est plus ou moins prononcé selon les lieux ; gérer les hommes comme un facteur de production ordinaire ne manque pas de poser quelques questions humaines, et les réponses que les divers pays tentent d’apporter à ces questions n’ont rien d’uniforme ; en particulier, la France a réagi très différemment des États-Unis.
La réaction américaine, et dans une bonne mesure anglaise, est largement de tirer toutes les conséquences, dans la gestion des hommes, de cette évolution du fonctionnement de l’économie. Les pouvoirs publics comme les offreurs et demandeurs d’emploi acceptent sans guère de réticences que le marché règne de plus en plus en matière de gestion des « ressources humaines » comme en matière de gestion des biens et services. Chacun, de plus en plus payé « à son prix », est invité à devenir « entrepreneur de lui-même » et à faire ce qu’il faut pour être « employable ». Une entreprise peut afficher sans complexes qu’elle ne veut recruter et garder que les meilleurs3. Pendant que les mieux armés voient leurs gains s’envoler, ceux des moins armés baissent et les inégalités s’accroissent4. De multiples emplois se créent dans les services marchands, avec des salaires à la hauteur de ce que le marché est prêt à payer, c’est-à-dire faibles.
Est-ce à dire que toute préoccupation sociale, tout désir d’aider ceux que le jeu pur et dur du marché met en difficulté, disparaît alors ? Pas forcément, mais que, lorsqu’elles sont présentes, ces préoccupations elles-mêmes se coulent dans cette logique ; on le voit bien en particulier chez Tony Blair, lorsqu’il veut amender la politique de l’ère Thatcher. Il ne s’agit pas d’entraver le libre jeu du marché du travail mais, grâce à de la formation et du coaching, d’armer ceux qu’il a tendance à écraser pour qu’ils puissent s’y montrer plus performants5. Cela doit permettre d’aider à améliorer la situation de ceux qui disposent de peu d’atouts ainsi que de remettre au travail ceux que le marché a rejetés et qui sont tentés de se réfugier dans une « culture de l’assistance ».
La réaction française, variable selon les secteurs d’activité6, est bien différente
Certes la détermination du sort qui échoit à chacun, et en particulier du niveau du poste qu’il occupe et de son salaire, est là aussi régie de plus en plus par une logique de marché. Ainsi les conditions d’insertion de ceux qui sortent de l’appareil éducatif, jadis fortement régies par des facteurs purement statutaires, telles la correspondance entre un niveau de diplôme et une position dans une grille d’une convention collective, le sont de plus en plus par des facteurs de performances personnelles telles que les employeurs les apprécient. Les écarts se creusent entre ceux qui ont en principe la même « qualification ». Ceci est spectaculaire par exemple pour les formations tertiaires de niveau intermédiaire : dans une même promotion issue d’un BTS de secrétariat de direction, quelques diplômées dotées par ailleurs de solides atouts vont occuper effectivement un tel poste pendant que bien d’autres seront vendeuses. Le MEDEF incite à s’écarter, dans la gestion du personnel, d’une logique de qualifications accordant une grande place au statut lié à un parcours scolaire, au profit d’une logique de « compétences » liées à des performances dans l’entreprise. La part variable du salaire tend à croître, pendant que la rémunération des dirigeants donne une place croissante aux stock-options. Pendant ce temps la privatisation des entreprises publiques s’accompagne d’une remise en cause des statuts traditionnels. Mais l’acceptation de cette évolution rencontre de sérieuses limites.
On voit subsister, tant de la part des pouvoirs publics que de celle de la population, de multiples manifestations d’un refus de voir le marché déterminer la valeur de chacun. Les politiques sociales cherchent à mettre en place des barrières capables de protéger ceux que son libre jeu conduirait à des situations qui paraissent inacceptables. Le niveau du SMIC est vivement défendu, même si certains s’inquiètent de ses effets sur l’emploi. Ainsi lorsque, avec le CIP (Contrat d’insertion professionnelle), il a été question de mettre en place une sorte de « SMIC jeunes » de niveau plus faible que le SMIC ordinaire, l’ampleur du mécontentement populaire a fait reculer le gouvernement. L’utilisation du travail temporaire est limitée et on parle de le taxer. Même quand l’entreprise est en difficulté, les baisses de salaire, devenues monnaie courante aux États-Unis, sont difficiles à obtenir ; on l’a bien vu à Air France. Partout les « droits acquis » sont énergiquement défendus.
Le coût d’un manque de cohérence entre la gestion de l’économie et celle du social
Cette rencontre d’une gestion des entreprises de plus en plus inspirée par une fidélité sans faille à une logique marchande et d’une approche du social marquée par la défense des statuts et des droits acquis est lourde de conséquences. Certes, tous ceux à qui la coutume, les luttes sociales ou l’existence de minima réglementaires permettent, s’ils ont un emploi et le gardent, de bénéficier d’un salaire supérieur à leur stricte valeur marchande sont à certains égards mis à l’abri d’une logique pure et dure de la marchandise. Mais la condition restrictive s’ils ont un emploi et le gardent est en la matière essentielle. Car, protégés sur le plan du salaire (et plus largement de leur position), ils sont mis en péril sur celui de l’emploi7.
Certes le secteur public est là, qui offre la protection d’un statut. Et les concours administratifs de niveau modeste, qui permettent d’accéder à une situation (facteur, agent des douanes, pompier) qui met à l’abri des pressions du marché, sont l’objet d’un engouement sans précédent, avec une multiplication des candidatures de surdiplômés (tels des bac + 5 pour des concours niveau bac). Mais cette concurrence fait justement qu’il est difficile d’y rentrer.
L’existence de ce type de situation voue certains à un chômage de longue durée, voire définitif. De plus, ce qui est en question n’est pas seulement la répartition d’un volume d’emplois qui ne serait pas affecté par ces phénomènes. La construction même de l’appareil productif et à travers elle le nombre d’emplois qui sont offerts sont concernés8.
Si les activités marchandes à faible qualification sont loin de se développer en France comme elles le font aux États-Unis, cela n’est pas sans rapport tant avec le coût du travail peu qualifié qu’avec la signification sociale de ces activités dans un contexte français9. On ne trouve pas sur le marché du travail un personnel qui permettrait de les développer dans des conditions de productivité et de coût en rapport avec l’état de la demande.
En fin de compte, les pratiques, qu’elles relèvent des politiques sociales ou des mœurs qui ont pour objet d’édifier des barrières empêchant les employeurs de ramener chacun à sa valeur marchande, ont des effets bien différents de celles qui ont pour objet de l’aider à augmenter cette valeur. Interdisant d’être employés dans des conditions indignes, elles tendent, dans une économie hautement concurrentielle, à abandonner à l’abstention des employeurs potentiels ceux qui ne seraient employables qu’à de telles conditions.
Tout cela veut-il dire qu’il faut imiter les Américains ou les Anglais, et en particulier qu’il n’est pas de salut pour la gauche française en dehors d’une conversion à un certain « blairisme » ? Nullement. Même « à visage humain », une société construite autour d’une économie vouée à une version pure et dure d’une économie de marché peut difficilement éviter d’être sans merci pour les faibles.
Mais cela veut dire qu’il faut savoir ce que l’on veut et ne pas se masquer le prix de politiques incohérentes. Si, à l’expérience, les Français persistent et signent dans leur conversion à une gestion de l’économie radicalement vouée à la concurrence et au pouvoir des actionnaires, il faut qu’ils soient conscients des effets que cela a sur la gestion des entreprises, et des conséquences douloureuses qu’il faut en tirer sur le plan des politiques sociales si l’on veut sortir d’une situation de chômage massif. S’ils étaient effectivement conscients de tout cela, l’allégeance au marché de la majorité d’entre eux résisterait-elle ? L’histoire permet d’en douter10.
______________________________________
1. EC/DGV – OECD/DEELSA seminar : Wages and employment, European Commission, 1999. Perspectives de l’emploi de l’OCDE, juin 1999.
2. Marina v. N. Whitman, « Global competition and the changing rôle of the American corporation », The Washington quarterly, Spring 1999.
3. Cf., par exemple, les propos de Jacques Welch, président de General Electric, rapportés dans Business Week, 24 mars 1997.
4. Aux États-Unis, l’écart entre les revenus des 10 % les plus payés et des 10 % les moins payés a plus que doublé depuis 1977, International Herald Tribune, 6 septembre 1999.
5. Cf. le manifeste publié le 8 juin 1999 par MM. Blair et Schröder, où il est dit notamment : « Les sociaux-démocrates modernes veulent transformer le filet de sécurité composé par les acquis sociaux en un tremplin pour la responsabilité individuelle. »
6. Jean-Louis Beffa, Robert Boyer, Jean-Philippe Touffut, Les relations salariales en France ; État, entreprises, marchés financiers, Notes de la Fondation Saint-Simon, juin 1999.
7. Philippe d’Iribarne, Le chômage paradoxal, PUF, 1990.
8. Phénomène qu’appréhendent mal les études économétriques classiques portant sur les effets sur l’emploi de l’existence d’un salaire minimum. D’une part ces études ne prennent en compte que les effets de la réglementation, non ceux des mœurs. D’autre part il faut bien distinguer en la matière des effets à court terme et des effets à long terme, qui intègrent l’adaptation des pratiques de consommation, voire des modes de vie, dans leurs effets réciproques avec le développement de l’offre de biens et services.
9. Cf. les travaux de Thomas Piketty. Il n’existe pas de consensus sur la part, dans l’existence de cette situation, d’explications que l’on qualifie parfois de purement économiques (coût du travail ; en fait celui-ci n’est pas indépendant de facteurs sociaux et culturels) et de facteurs directement sociaux et culturels.
10. L’histoire a déjà connu des moments de mise en œuvre radicale d’une économie de marché, mise en œuvre qui, à l’expérience, a conduit à des retours en arrière ; Karl Polanyi, La grande transformation, Gallimard, 1983.