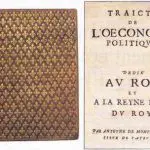Les polytechniciens : ferment d’une mutation ou nouveaux dignitaires d’un Ancien Régime ?

En cette année 2000, dernière d’un millénaire qui a vu le triomphe de la modernité occidentale et son extension au monde par la force et par la séduction, par l’efficacité aussi, nos modèles de développement et nos systèmes de pensée sont dans une profonde impasse. Alors que 20 % seulement de l’humanité tout entière accède aux modes de vie que nous avons rendus désirables à tous et que nous avons promus au rang de références universelles, l’humanité utilise chaque année une fois et demie les ressources que la biosphère est capable de reproduire. Et nous voilà comme un âne au bord d’un précipice, ne sachant plus ni avancer sans tomber dans le gouffre des déséquilibres écologiques, ni reculer sans briser un outil économique et social qui ne carbure qu’à la croissance des biens matériels.
On peut bien inventer des oxymores, marier la glace et le feu en disant que notre développement va devenir durable, l’impasse est là. Le monde est devenu un village. Belle figure de style. Belle réalité aussi, tant il est vrai que les interdépendances entre les êtres humains se sont consolidées, amplifiées d’une année à l’autre. Circulation de l’information, diffusion des sciences et des techniques, internationalisation des marchés ; interdépendance entre l’humanité et la biosphère.
Réalité certes, mais quelle hypocrisie aussi. Dans ce village, tous les hommes sont égaux mais il y en a de plus égaux que d’autres. La gouvernance mondiale est en retard sur les nécessités de la régulation planétaire. Quand on se massacre à la machette au Rwanda, le Conseil de Sécurité de l’ONU n’arrive pas à conclure sur un mode d’intervention. Et au Kosovo, pour assurer la guerre propre – propre pour les pays de l’OTAN s’entend – un bombardier B 52 vaut à lui seul la totalité du produit national brut de l’Albanie.
Un nouvel élan implique une vision claire des ruptures nécessaires. J’en proposerai sept.
► De l’économie des biens à l’écologie de l’intelligence
Fondé depuis trois siècles sur l’art de produire, avec un minimum de main-d’œuvre, un nombre croissant de biens matériels toujours plus sophistiqués, notre développement s’est montré extraordinairement efficace, grâce à l’alliance du marché et de la technologie. Et la révolution de l’information, après la Seconde Guerre mondiale, en a encore accéléré la progression. Mais les caractéristiques du « mode de vie occidental » – accumulation de biens matériels et débauche de consommation énergétique – sont mises en question sous une double pression : celle de la démographie mondiale, celle des ressources disponibles.
Nos modes de pensée en prêtant attention aux seuls biens qui se divisent en se partageant – ceux qui justifient la concurrence et la fixation d’un prix – sont inadaptés à la mutation radicale qui paraît inévitable. Or il existe deux autres catégories de biens ; ceux qui se détruisent en se partageant (les écosystèmes et, de façon générale, ce qui touche à la vie et aux biens communs), et ceux qui se multiplient en se partageant : l’information, le savoir, l’expérience, la beauté, la musique, la joie, le bonheur, la foi, l’amour et la fête…
Ces deux catégories de biens sont connues des entreprises aussi bien que des organisations humanitaires : appelons-les écologie de la vie et écologie de l’intelligence. Elles domineront au siècle prochain : il est impératif de les placer au centre de notre système de pensée.
► De Descartes aux systèmes
Le principe fondamental de Descartes – diviser pour comprendre – s’est avéré extrêmement opératoire pendant les trois derniers siècles ; il a permis d’impressionnantes découvertes. Mais les défis et les crises du monde d’aujourd’hui sont tout, sauf des problèmes de compréhension de l’infiniment petit : nos crises actuelles sont des crises de relations. Relations des hommes entre eux, relations entre les sociétés, relations entre l’humanité et la biosphère.
Voilà le premier défi à relever ; on en mesure la gravité en constatant les contre-performances que sont la décomposition des services publics en départements séparés ou l’entêtement des politiques publiques à traiter des individus isolés sans considérer l’unité de leur propre vie.
L’urgence est au remembrement de la pensée. L’urgence est à l’humanisme, c’est-à-dire à la capacité d’aborder les êtres humains, les sociétés et les écosystèmes comme des totalités où les relations entre les parties importent plus que ces parties elles-mêmes. Ce devraient être les axes majeurs d’une réforme de l’enseignement, et tout particulièrement de la formation des ingénieurs, pour qu’ils cessent d’être des barbares et des autistes sociaux.
► De la monnaie unique aux monnaies plurielles et à la monnaie vectorielle
À Sumer, aux premiers temps de la monnaie, les pièces ne représentaient pas un prix mais un objet : un cochon, des briques. Les échanges ont pu s’élargir sans la présence physique des objets, mais ils gardaient en mémoire la matrice des flux physiques, alors que nous n’y voyons plus que des flux de valeurs. Mais qui perçoit encore les aspects fondamentaux de cette monnaie que nous utilisons couramment ? En voici quelques-uns.
- Les chefs d’entreprises sont très ignorants des flux physiques. Ils sont bien informés de ce qui rentre (du moins de ce qui a un coût), mais connaissent très mal ce qui sort. Et, dans un avenir proche, la dégradation entropique et la dissipation de matière sont appelées à prendre une importance déterminante. Le prix ne suffira plus à qualifier nos échanges ; il faudra y ajouter un ensemble de données caractérisant les flux physiques.
C’est, en matière industrielle, le fondement de l’écologie industrielle, c’est-à-dire de l’insertion de chaque activité économique dans des cycles écologiques, comme les systèmes naturels eux-mêmes, le déchet de l’un devenant la matière première de l’autre. Nous aurons besoin d’une monnaie à deux dimensions au moins, la première mesurant la valeur ajoutée du travail humain, et la seconde – nécessairement contingentée et sans doute taxée – la consommation de matière et d’énergie.
- À Valenciennes, dans les années 70, j’ai bien connu – comme tant d’autres – la crise sidérurgique et l’absurdité d’une situation où besoins non satisfaits et bras ballants se côtoyaient dans la même rue, voire sous un même toit. L’idée d’une monnaie locale était alors jugée utopique et même dangereuse. Or, depuis les années 80 et surtout 90, les SEL – systèmes d’échanges locaux – se développent. Encore timides en France, et limités à de petites communautés ou à des militants de l’alternatif, ils prennent ailleurs une tout autre ampleur.
En Argentine, par exemple, le système de troc global associe en réseau des clubs de 80 personnes, concerne plus de 150 000 personnes, et commence à s’étendre aux pays voisins. Les monnaies privées des entreprises suisses ou les bons de kilomètres offerts par les compagnies aériennes répondent à une approche similaire. Nul doute que les avancées de l’informatique permettront bientôt de gérer simultanément les flux d’échanges entre de multiples communautés, localisées ou virtuelles.
- Enfin, l’émergence d’outils non monétaires de comptabilité des flux reposera la question des fonctions de la monnaie. En effet, la monnaie actuelle sert tout à la fois de moyen de paiement, d’unité de compte et de réserve de valeur.
On peut dans l’avenir imaginer de séparer ces trois fonctions, la réserve de valeur étant par exemple une fraction des capacités de production, tandis que les moyens de paiement seront électroniques et les unités de compte à plusieurs dimensions.
En ce qui concerne la réserve de valeur, le développement très rapide des « fonds indiciels », qui regroupent un vaste panier de valeurs boursières, en constitue déjà les prémisses.
► De la Déclaration des droits de l’homme à la Charte des droits et responsabilités de l’humanité
La citoyenneté s’entendait autrefois comme une combinaison de droits et de responsabilités, qui faisait de chacun le membre d’une communauté humaine. Cette représentation reste très vivante dans les pays pauvres, pourtant qualifiés de non démocratiques parce qu’ils ne pratiquent pas notre forme de démocratie.
Chez nous s’est peu à peu formée une citoyenneté « consumériste », fondée sur des papiers d’état civil qui nous donnent accès à un certain nombre de droits. Sans vouloir en revenir au service militaire obligatoire, ni aux « ateliers de la sueur », il ne faut pas se cacher qu’un discours entièrement centré sur les droits nourrit aussi bien l’incivisme des « bénéficiaires » que le mépris de certains chefs d’entreprises à l’égard de leurs responsabilités sociales.
L’élaboration juridique et sociale qui, en cinquante ans, a mis au point des droits de deuxième et troisième générations (citons, parmi les plus récents, le droit au logement, à l’environnement…) est l’une des constructions les plus remarquables de l’humanité. Mais la Charte de l’ONU et la Déclaration universelle des droits de l’homme ne suffisent plus pour gérer, demain, la planète.
De multiples initiatives témoignent d’une salutaire prise de conscience : l’Interaction Council créé par Helmut Schmidt, l’ancien chancelier d’Allemagne, et Hans Küng, le théologien allemand, et regroupant un ensemble de chefs d’État ; l’initiative conjointe de Maurice Strong, organisateur du Sommet de la planète de Rio en 1992, et de Mikhaïl Gorbatchev ; l’initiative de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire dans laquelle je suis directement impliqué.
À l’affirmation des droits doit correspondre l’affirmation des responsabilités, et celles-ci, maintenant, concernent l’humanité et la biosphère tout entières.
La crise du monde actuel est une crise des relations. La citoyenneté fonde la relation aux autres membres de la communauté. La responsabilité met en jeu le rapport à l’autre. C’est tout cela que nous voulons promouvoir.
► Du droit au contrat
Le passage du droit à la responsabilité en induit un autre, le passage du droit au contrat. Selon moi, la notion de contrat social, tombée en désuétude, redeviendra centrale.
La science en fournit un bon exemple. Du temps de Galilée, le droit à chercher était le corollaire immédiat des droits de l’homme, et la Charte fondamentale de l’Unesco l’entend ainsi. C’est devenu aujourd’hui une gigantesque hypocrisie, car il n’y a plus de distinction entre science et technique.
L’ensemble des sciences et des techniques constitue une technoscience aux investissements considérables, gouvernée par des enjeux de puissance économique ou de puissance militaire. La science n’est pas faite actuellement par des aventuriers de l’esprit, mais par des fonctionnaires de l’intelligence. Inévitablement, la dimension de responsabilité et de contrat social l’emportera désormais sur la dimension du droit à chercher.
J’ai participé, au mois de juin 1999, à la Conférence mondiale sur la science de Budapest, organisée conjointement par l’Unesco et par l’International Coalition of Scientific Union (ICSU). Il est évident que nous assistons à un changement de référentiel avec toutes les contradictions d’une mutation aussi radicale.
Dans un article publié par la presse suisse, j’ai résumé abruptement mon sentiment sur les participants ; des fous, des hypocrites et quelques sages. Les fous ne veulent pas savoir que le monde a changé, et tant pis pour les conséquences. Les hypocrites (la majorité) voient bien qu’il faut proposer de nouveaux horizons à la science et à la technique, mais revendiquent, pour exercer leurs propres activités, le maintien des règles actuelles. La petite minorité de sages reconnaît que la question de la maîtrise sociale et démocratique est devenue centrale.
► De l’armée à l’alliance
En 1789, les pères de la Révolution n’avaient pas pensé l’entreprise. Aussi n’est-il pas étonnant que celle-ci, au xixe siècle, se soit développée à partir des deux modèles d’organisation sociale à sa disposition : la famille et l’armée. Beaucoup de nos entreprises et de nos organisations restent imprégnées par ce modèle, même si l’on voit progresser les systèmes en réseau, la décentralisation, les projets collectifs en dehors de la chaîne de commandement.
Pour gérer la planète et sa diversité, nous devons aller beaucoup plus loin : tisser des systèmes de relations au sein des grandes organisations et entre elles. Ayant participé personnellement à la naissance et au développement de l’Alliance pour un monde responsable et solidaire, et dirigeant une fondation amenée à soutenir le développement de réseaux internationaux sur un certain nombre de grands défis de l’humanité, j’ai pris conscience de ce que l’alliance, prise dans son sens générique, est un modèle mental capital pour concevoir les organisations de demain.
Très sommairement – je me tiens, bien entendu, à la disposition des lecteurs pour toute précision – les alliances se définissent par un certain nombre de caractères : un minimum de valeurs et de perspectives communes ; des méthodes de travail, non plus hiérarchiques mais claires et partagées par tous (« la loi remplace le roi ») ; un calendrier pour structurer le processus ; un pouvoir conçu comme le résultat de l’action commune et non comme un objet à partager (« le pouvoir ne se prend pas, il se crée ») ; pas d’organigramme rigide ; un pilotage collectif par consensus, sans nécessairement créer une institution ; un système performant de communication interne et externe.
► Du gouvernement à la gouvernance
Dans nos têtes, les grands États démocratiques sont le modèle le plus achevé de gouvernement, fondé sur deux piliers : l’organisation des pouvoirs publics, l’organisation du marché. Ceci s’avère insuffisant devant une mondialisation économique sans frein, car la régulation sociale et politique n’a pas suivi le rythme de l’expansion vertigineuse des marchés, et les hommes sont en plein désarroi.
Faudrait-il, à défaut d’un gouvernement mondial qui n’est pas pour demain, se résigner au chaos ? Ou prédire l’apocalypse, comme l’a fait, après Hiroshima, la première génération de citoyens du monde ? Dieu merci, une multitude d’autres régulations émerge progressivement, nous obligeant à élargir considérablement notre vision des régulations.
Nous avons besoin d’un mot spécifique pour désigner l’ensemble des régulations dont se dote, de manière volontaire, une société : appelons-le gouvernance. Celle-ci présente deux composantes essentielles : l’articulation des échelles, l’irruption de nouveaux acteurs.
Concernant la première, nous en sommes encore à penser l’exercice de l’autorité publique selon le modèle de la cité grecque : une communauté installée sur un territoire, face au monde extérieur. Ce principe des « blocs de compétence » a fondé la pensée, relativement archaïque, de la décentralisation à la française : comme si chaque question sociale, économique ou écologique pouvait être traitée à un niveau et un seul.
Toutes les grandes questions de demain supposent la combinaison d’actions à différentes échelles. Cette inversion de la pensée est appelée à devenir une question centrale.
En second lieu, de nouveaux acteurs sont entrés dans le champ de la régulation, en particulier les Organisations non gouvernementales (ONG) internationales. D’une certaine manière, les ONG répondent au déficit de sens et de lien qui résulte de l’implosion des idéologies et des institutions. Dès lors, elles assurent des fonctions aussi diverses que se substituer aux pouvoirs publics, servir d’intermédiaires entre ceux-ci et les citoyens, ou chercher de nouveaux projets de société. À l’échelle internationale, c’est encore plus évident.
On s’habituait à assimiler le non-gouvernemental à l’action au niveau local, et le gouvernemental au global. Peut-être faut-il changer de perspective et reconnaître dans les États nations une structure par essence locale, le global étant investi par des structures non gouvernementales : entreprises et ONG.
Mais l’action actuelle des ONG comporte aussi de sérieuses limites. Leur slogan habituel « penser globalement, agir localement » ne tient pas à l’analyse : le changement du monde implique aussi de changer les règles du jeu et les institutions. De plus, les ONG ont de la peine à passer d’une culture de résistance, de dénonciation, à une culture de dialogue et de proposition.
Le monde bouge, les têtes changent. La question est de savoir si nous allons assez vite, si les présumées élites qui courent le monde d’un hôtel à l’autre, d’une capitale à l’autre assument la responsabilité qui devrait être la leur, du fait de leurs pouvoirs matériels et des savoirs qu’elles gèrent, ou si elles continuent sur leurs rails, sans voir que les cinquante prochaines années seront des années d’une mutation très profonde, de même ampleur que celle que nous avons connue pour passer du Moyen Âge au monde moderne. Seront-elles capables de mettre leurs compétences au service des ruptures nécessaires ?
Seront-elles capables de concevoir, de formaliser et d’organiser ces ruptures ?
Or, ce qui manque fondamentalement aujourd’hui, là où la crise des idéologies ou des institutions a laissé un trou béant, c’est la construction de perspectives intégratrices. De telles perspectives supposent le lien entre le local et le global, le lien entre les milieux, la gestion de la durée, la mise en place de stratégies de changement à long terme, l’insertion de projets ponctuels dans une perspective commune, le dépassement de l’identité de chacun au profit d’une perspective d’ensemble. Si les ONG veulent relever ce défi, elles doivent apprendre à entrer en alliance.
C’est en aidant à faire émerger de telles alliances, en faisant en sorte qu’elles organisent leur propre agenda à long terme et qu’elles proposent des alternatives ambitieuses que l’on contribuera le mieux, selon moi, à faire émerger de nouvelles formes de régulation et de civilité mondiales.
Que ferons-nous maintenant ?
C’est le défi historique de groupes humains comme les polytechniciens qui ont été, lors de la création de l’École et pendant le siècle qui a suivi, les ferments de la mobilisation de la science au service de la société, qui ont été les fers de lance du développement des capacités de production et sont maintenant invités à choisir : nouvel élan ou dinosaures, ferments d’une mutation ou nouveaux dignitaires d’un Ancien Régime.