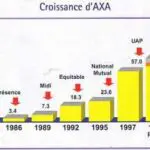L’agrément

Depuis la signature du traité de Rome, les grands principes de cette réglementation ont été fixés par des directives de la Communauté européenne, dans le but de créer un marché unique respectant les mêmes règles prudentielles, et notamment celle de la » marge de solvabilité » ; après un long cheminement, il suffit, depuis quelques années, à une entreprise d’assurance dont le siège social se trouve sur le territoire de l’Union européenne, de la seule autorisation de son pays d’origine pour opérer dans l’ensemble de l’Espace économique européen.
Avant d’examiner comment est accordée aujourd’hui en France cette autorisation, l’agrément, un rapide retour en arrière me permettra de mettre le sujet en situation.
La préhistoire
Si le besoin, aussi naturel que celui de manger ou de dormir, de se protéger contre les aléas de l’existence, a conduit très tôt des collectivités, familiales ou tribales, notamment en Mésopotamie, où l’on a retrouvé des traces de cette activité, à chercher à compenser, par la solidarité, les risques nés de la fatalité, en mutualisant la charge des sinistres survenus, les mêmes ont également mis en place les premières protections contre les risques inhérents à l’activité économique, et notamment au transport de marchandises, par terre ou par mer, la tarification prenant en compte, au cas par cas, l’évaluation de ces risques.
Et, comme la chance a voulu que la Méditerranée ait des dimensions suffisamment restreintes pour que le commerce puisse s’y développer, l’assurance maritime, par les prêts et contrats à la grosse aventure, y connut un essor parallèle, notamment dans les ports d’Espagne et d’Italie, relayés par Londres après les grandes découvertes. En France, où ce fut longtemps la seule forme d’assurance pratiquée, Colbert la codifia en 1681 dans sa célèbre Ordonnance sur la Marine.
En revanche, la mise en œuvre organisée de mécanismes de solidarité ne semble pas avoir été de règle dans le monde gréco-latin, et il fallut attendre les premiers siècles du Moyen-Âge, pour voir renaître, dans le nord de l’Europe, des associations charitables, connues sous le nom de guildes, qui furent sans doute les premières à mutualiser la charge des sinistres à venir ; sans pour autant les perdre de vue, les guildes dépassèrent peu à peu leurs objectifs initiaux, pour devenir de véritables organisations professionnelles, et parce qu’elles étaient bien gérées, comme on le dirait aujourd’hui, et qu’elles ignoraient les frontières, elles firent ombrage à l’Église, à qui elles faisaient concurrence, et aux États, qui ont craint la puissance de leurs associations, les hanses… si bien que l’une des premières manifestations du pouvoir réglementaire en matière d’assurance a consisté à brider, au point de les faire disparaître, des organismes qui rendaient à leurs adhérents des services conformes à leur objet.
Après le grand incendie de Londres, en 1666, se constituèrent, lentement en Grande-Bretagne, plus lentement encore sur le continent, des mutuelles d’assurance contre les incendies, qui commencèrent à maîtriser le calcul des probabilités dans les dernières années du XVIIIe siècle.
L’arrêt du 3 novembre 1787
En France, la première manifestation d’une réglementation propre à l’activité d’assurance semble se trouver dans la concession accordée le 6 novembre 1786 à une Compagnie créée à cet effet, du privilège d’offrir au public des assurances contre les incendies, puis, un an plus tard, des assurances sur la vie, ces autorisations étant assorties, dans les deux cas, d’un monopole de quinze ans.
L’arrêt du Conseil d’État du 3 novembre 1787 explique, dans son exposé des motifs, que ces sortes d’assurances modérées et équitablement arbitrées affranchiraient (les souscripteurs) de l’usure trop commune, et que leurs combinaisons variées, liant utilement le présent et l’avenir, ranimeraient ces sentiments d’affection et d’intérêt réciproques qui font le bonheur de la société et en augmentent la force. La création du monopole et celle des deux fonds de garantie, dont la souscription est imposée aux promoteurs du projet, sont justifiées par des raisons techniques, car le succès ne peut être plus efficacement assuré que par la réunion d’une multitude de chances, mais, quoique ces assurances doivent être calculées de manière à tirer leur solidité complète de la réunion des chances, (Sa Majesté) a cru qu’il serait utile de soumettre ceux qui seraient chargés de cet établissement à une finance considérable, dans laquelle chacun des assurés ait un gage authentique des engagements pris avec lui.
Les fonds de garantie requis sont en effet fort importants, huit millions pour chacune des deux branches, ce qui correspond à une centaine de millions de francs d’aujourd’hui, au prix du louis, et à deux fois plus si l’on évalue à 3 000 livres par an le SMIC de l’époque.
Ils devront être reconstitués en cas de perte d’exploitation, de façon à permettre de répondre de l’exécution desdites assurances, jusqu’à parfait accomplissement des engagements pris par la Compagnie, dont il est précisé que la durée peut dépasser les quinze ans du monopole.
Le texte précise enfin que Sa Majesté n’a pas cru non plus devoir négliger l’intérêt qu’elle pourrait retirer de cet établissement, dès à présent et dans l’avenir, pour ses finances et que les fonds de garantie seront donc placés en effets du Trésor.
Les statuts de la Compagnie doivent être approuvés par le Roi, comme le prospectus contenant les détails et les conditions de l’établissement des assurances sur la vie, les tables et les calculs des primes pour les cas généraux, les modèles des polices d’assurance et des engagements respectifs des assureurs et des assurés ; le taux de l’impôt sur les bénéfices est de 25 %.
Les préoccupations essentielles des futures autorités de tutelle se trouvent déjà dans ce texte de trois pages : il s’agit, d’une part, de protéger les assurés, par l’institution du » visa » imposé aux termes et tarifs des contrats, et par la création des fonds de garantie, et, d’autre part, de faire participer la nouvelle Compagnie au financement de l’économie.
À peine celle-ci avait-elle eu le temps de commencer ses opérations qu’elle fut emportée par la Révolution, qui bannit les associations, et interdit l’assurance sur la vie, considérée comme immorale.
Les temps modernes
La révolution industrielle, le développement du chemin de fer, la croissance de la population urbaine, l’arrivée de l’automobile, les découvertes de la médecine, la nécessité de protéger l’environnement, etc., font apparaître de nouveaux risques, que prennent en charge les compagnies d’assurance modernes, dont les premières ont été créées dans les années 1820.
Une part sans cesse croissante de la population doit faire face à ces risques nouveaux, dont la plupart sont plus ou moins directement la rançon du progrès, tandis que seules les catastrophes naturelles sont aujourd’hui l’expression de la fatalité ; dans le même temps, la généralisation de ces risques, dans la mesure où chaque individu s’imagine en victime potentielle, donne de plus en plus de force au concept de » droit à réparation « , qui conduit le législateur à créer des assurances obligatoires, notamment en matière de responsabilité, ou même à socialiser des garanties.
Les pouvoirs publics seront amenés, au fil du temps, à prendre en compte l’apparition de ces nouveaux risques et le rapide développement des opérations d’assurance, dont la surveillance se met progressivement en place, par l’adoption successive de textes, en 1868, sur les conditions de constitution des sociétés d’assurance, en 1898, après l’Allemagne, sur le contrôle des sociétés assurant les accidents du travail, en 1905, sur la protection des assurés sur la vie, en 1935, sur l’assurance automobile, et enfin des véritables textes fondateurs que sont la loi de 1930 sur le contrat d’assurance et le décret-loi du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l’État sur les entreprises d’assurance de toute nature ; le Code des assurances est aujourd’hui très volumineux.
La tutelle, confiée depuis 1940 au ministère des Finances, n’est pas universelle, puisque le contrôle des organismes à gestion paritaire est confié au ministère des Affaires sociales, où il est exercé sur d’autres bases, non seulement pour la Sécurité sociale, mais aussi pour les organismes relevant du Code de la mutualité, ou pour les institutions de prévoyance et les caisses de retraite par répartition, dont les engagements sont cependant à long terme, et dont chacun sait aujourd’hui qu’elles gèrent des régimes dont la pérennité n’est assurée que par la garantie que leur donne la collectivité nationale, d’une manière qui, longtemps implicite, est récemment devenue quasi explicite.
Le contrôle de l’État
L’article L.310–1 du Code des assurances, » Le contrôle de l’État s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation « , est sans doute repris aujourd’hui dans les législations de tous les pays où existe un marché. Les modalités d’application se sont peu à peu mises en place dans les différents États de l’Union européenne, sans pour autant être totalement harmonisées, les traditions nationales conduisant à privilégier le contrôle des tarifs, en Allemagne, celui des personnes en contact avec le public, en Grande-Bretagne, celui des entreprises en France et en Italie.
Le contrôle est exercé ici par une administration centrale, là par une autorité dotée d’une large indépendance, même si elle est le plus souvent placée elle-même sous la tutelle d’un ministre.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, la Grande-Bretagne a choisi la première solution, et la France la seconde, depuis la loi du 31 décembre 1989, qui a créé la Commission de contrôle des assurances.
L’article L.310–12 du Code, qui définit sa mission, stipule, en effet, que la Commission, d’une part, veille au respect par les entreprises d’assurance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’assurance, et d’autre part, s’assure qu’elles sont toujours en mesure de tenir les engagements qu’elles ont contractés à l’égard des assurés, et présentent la marge de solvabilité prescrite.
Ce texte traduit bien la préoccupation de sens commun, » mieux vaut prévenir que guérir « , et la surveillance permanente des conditions d’exploitation des entreprises d’assurance doit, dans son principe, permettre, en anticipant les dérapages, de prescrire à temps les éventuelles mesures de redressement.
Composée de cinq membres, nommés pour cinq ans, la Commission est présidée par un conseiller d’État ; un Commissaire du gouvernement représente auprès d’elle la direction du Trésor, autorité de tutelle de la profession.
Les commissaires contrôleurs des assurances, qui constituent l’efficace bras armé de la Commission, disposent de très larges pouvoirs d’investigation dans les entreprises, mais n’ont pas celui de sanctionner, et c’est donc sur leur rapport que la Commission peut, après avoir constaté l’infraction, imposer des mesures de sauvegarde ou de redressement.
Cependant dans la mesure où le contrôle se veut préventif, et où, le plus souvent, un dérapage précède l’infraction, la connaissance détaillée, presque intime, qu’ils ont des entreprises dont ils sont les interlocuteurs permanents, donne aux membres du corps de contrôle une certaine capacité d’appréciation, et leur permet, tant qu’aucune infraction caractérisée n’a été commise, d’utiliser leur pouvoir d’influence, dans l’espoir de voir se rétablir une situation qui se dégrade, avant de devoir proposer à la Commission de décider du choix d’une sanction, dans une gamme assez large, et dont la plus grave est le retrait d’agrément.
Le chef du service et du corps de contrôle assure le secrétariat général de la Commission ; bien que le cas ne se soit sans doute pas encore présenté, il est permis de se demander comment serait résolu le problème posé par une divergence de fond entre la position soutenue par le service du contrôle et la décision de la Commission, sauf à faire appel, pour trancher le débat, au Commissaire du gouvernement.
L’agrément
Toute l’action des autorités de tutelle est orientée vers la prévention, comme il a été souligné ci-dessus ; le droit de présenter des opérations d’assurances au public doit donc être régi par des dispositions d’une particulière vigilance, de manière à ne pas laisser se créer des situations propices à l’apparition ultérieure d’infractions. C’est, en France, l’article L.321–1 du Code qui impose l’agrément, lequel est accordé par le ministre de l’Économie et des Finances, et dont le refus est susceptible de recours.
Parmi les 26 » branches » d’assurance devant faire l’objet d’un agrément spécifique ne figure pas la réassurance, l’assurance des assureurs, sans doute en raison du caractère international de ses opérations, bien que, depuis 1994, les entreprises de réassurance soient assujetties au contrôle de l’État ; il existe sur ce point une différence, qu’il faudra bien faire disparaître, avec la Grande-Bretagne, chez qui les réassureurs doivent être agréés.
L’article L.321–10 du Code stipule que :
Pour accorder ou refuser l’agrément le ministre prend en compte :
- les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur adéquation au programme d’activités de l’entreprise,
- l’honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire,
- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires après avoir recueilli l’avis de la Commission des entreprises du Conseil national des assurances, qu’il préside, avis qui ne l’engage pas, mais auquel il ne lui est arrivé que très rarement de passer outre.
Les éléments constitutifs du dossier à fournir en appui d’une demande d’agrément sont décrits par les articles A.321–1 du Code, pour les entreprises, et A.321–2 pour leurs dirigeants ; pour ceux-ci, les informations demandées sont si détaillées, qu’il paraît sans doute difficile aux fonctionnaires chargés d’instruire le dossier de pousser leurs investigations plus loin encore, d’autant que le refus d’agrément est susceptible de recours ; le législateur a cependant introduit en 1999 dans l’article L.321–10 une clause permettant au ministre de refuser l’agrément, après avis, cette fois, de la Commission de contrôle, lorsque l’exercice de la mission de surveillance risque d’être entravé, par l’existence, soit de liens en capital difficiles à apprécier, soit de dispositions législatives ou autres d’un État qui ne fait pas partie de l’Espace économique européen.
Il est permis de se dire aujourd’hui que, si ce texte avait été voté et mis en application plus tôt, quelques-unes des défaillances d’entreprises d’assurance, au demeurant assez rares, qu’a supportées le marché français au cours des quarante dernières années auraient pu être évitées.
Le principe du fit and proper
Quoi qu’il en soit, notre cartésianisme et notre respect des textes induisent, sans aucun doute, chez nous un comportement plus formaliste que celui, par exemple, de l’administration britannique, qui applique avec une grande indépendance d’esprit le principe du fit and proper, et j’ai le souvenir personnel de discussions au Department of Trade and Industry, où, avec un sourire désarmant, un haut fonctionnaire très compétent et parfaitement courtois n’a autorisé l’UAP à procéder à une acquisition qu’il n’avait pas le pouvoir de refuser qu’en nous imposant des contraintes nullement prévues par les textes.
Les questionnaires auxquels sont soumis, sans aucune discrimination, les assureurs qui souhaitent opérer à Hong-Kong ou à Singapour, ont un caractère presque inquisitorial et permettent aux autorités de contrôle de ces pays, elles aussi tout à fait compétentes, d’introduire, avec un coefficient fort, la » cote de gueule » parmi leurs critères d’acceptation.
Et, parmi mes souvenirs de même nature, figure en bonne place celui, qui remonte au tout début des années soixante-dix, du séjour d’une semaine que fit, à nos frais, dans un grand hôtel de la place de la Concorde, un fonctionnaire de la Direction des assurances de l’État de New York, où l’UAP avait des filiales de réassurance, afin de recueillir les empreintes des dix doigts de chacun des administrateurs du beneficial owner.
Cette anecdote permet, en passant, de souligner qu’aux États-Unis, dont le marché reste le plus important du monde, l’assurance n’est pas régie par une législation fédérale ; le pouvoir réglementaire détenu par les États y est exercé par des insurance commissioners, dont la moitié environ sont des élus, ce qui ne va pas sans favoriser certaines dérives des textes, notamment de caractère protectionniste ; si la NAIC, l’association des commissioners, consacre beaucoup d’efforts à l’harmonisation des législations, il n’est pas aujourd’hui envisageable qu’elle propose de se saborder, et de confier l’ensemble au gouvernement fédéral.
Le capital minimum
Pour revenir en France, il existe, parmi les conditions mises à l’obtention de l’agrément, une clause qui ne peut pas faire reculer grand monde, puisqu’elle fixe à 5 millions de francs le niveau du capital minimum des sociétés anonymes (article R.322–5 du Code), et à la moitié de ce montant celui du fonds d’établissement minimum des sociétés mutuelles (article R.322–44). Ces chiffres, qui n’ont pas été modifiés depuis près de quarante ans, sont ridicules et devraient être rapidement l’objet d’un relèvement substantiel, et pourquoi pas jusqu’à un niveau voisin de celui qu’avait fixé le Conseil d’État en 1787, soit environ 15 millions d’euros.
Les fonds de garantie
Plusieurs fonds de garantie ont été institués au fil des années, qui ont pour mission d’indemniser des victimes, d’accidents dont les auteurs n’ont pas respecté l’obligation d’assurer leur responsabilité, ou sont introuvables, d’actes de terrorisme, dont on peut, en effet, se demander si la garantie relève ou non des techniques de l’assurance, ou, plus récemment, au nom d’un droit à réparation qui s’installe dans nos esprits et dans nos textes, de dommages résultant d’une infraction.
Le fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes, institué par la loi du 25 juin 1999, est d’une nature différente, puisqu’il vise à protéger les assurés, et non plus des tiers, contre la défaillance d’une entreprise, ce qui ne devrait être qu’un cas d’école, dès lors que l’agrément ministériel a été donné à bon escient, et que le contrôle a bien fonctionné, éventuellement dans la durée, en raison de la nature même des opérations d’assurance sur la vie, où les engagements sont pris à long terme.
Tel qu’il a été créé, le fonds de garantie, qui est alimenté par les cotisations des sociétés agréées, protège au moins autant l’administration, dont cependant la responsabilité est difficile à mettre en cause, et même lorsque les commissaires contrôleurs ont usé de leur pouvoir d’appréciation, qu’il protège les assurés au bénéfice desquels il a été créé.
Il ne me semble pas que l’on aurait pris de grands risques, lors de sa création, en revoyant la procédure d’agrément, de manière à donner, d’une part, aux fonctionnaires chargés d’instruire les dossiers une plus grande marge d’appréciation, en particulier pour ce qui concerne la qualification et les antécédents professionnels des dirigeants proposés, et, d’autre part, aux instances organisées de la profession une meilleure représentation au sein de la commission chargée de donner au ministre son avis sur les candidatures.
En tout état de cause, si, ainsi qu’il semble en être question, un nouveau fonds de protection des assurés devait être créé pour les assurances non-vie (dommages et responsabilité), la question ne pourrait plus être éludée, car les cas de défaillance sont ici moins rares qu’en assurance vie ; et l’examen des demandes d’agrément devrait être effectué conjointement par les représentants de l’administration et par ceux de la profession puisque celle-ci aurait, en cas de défaillance ultérieure, à en payer la facture, ou, plus précisément, à en faire supporter le coût par ses assurés.
La création d’une telle instance de concertation permettrait à la Fédération française des sociétés d’assurance de mettre fin à sa propre procédure d’admission, qu’elle a justement maintenue, bien que l’administration n’ait jamais tenu compte de sa position, dans les cas, très peu nombreux, de défaillance d’entreprises qui avaient reçu l’agrément, et dont elle avait écarté la candidature.
Spéculations
Les pouvoirs publics ont examiné, pendant quelques mois, l’opportunité de confier à une même autorité administrative le contrôle des banques et celui des compagnies d’assurance ; si la mise en œuvre d’une réglementation commune serait sans doute justifiée pour les gammes de produits financiers diffusées, sans différence notable entre elles, par les deux catégories d’institutions, il n’en est pas moins vrai que les compagnies d’assurance sur la vie continuent à prendre des engagements à long terme, auxquels les banques répugnent.
Il est, par ailleurs, difficile d’imaginer ce que les normes prudentielles de l’assurance non-vie peuvent avoir de commun avec celles que doit respecter le secteur bancaire. Enfin, s’il peut y avoir une crise de solvabilité dans une entreprise d’assurance, elle ne fera en aucun cas courir le risque systémique qui pourrait naître d’une crise de liquidités dans une grande banque.
Et comme je me suis longtemps demandé quelle réflexion avait conduit les banquiers, qui, sous la Restauration, ont créé les sociétés qui allaient devenir les grandes compagnies d’assurance françaises, à confier le pouvoir d’engager ces compagnies à de nombreux agents, pour la plupart non connus d’eux, alors que, dans leur banque, ils n’avaient donné la signature qu’à un ou deux fondés de pouvoir installés dans leur propre bureau, il me paraît aujourd’hui évident que ces grands ancêtres avaient compris qu’inscrire ses risques au passif de son bilan, comme les assureurs, était d’une autre nature que de les avoir à l’actif, comme c’était, à l’époque, le cas pour les banquiers.
Ce sont, aux dernières nouvelles, les conclusions auxquelles sont arrivés également les experts chargés d’éclairer le ministre sur l’intérêt de la proposition.
Pour conclure, sans doute les autorités de tutelle pourraient-elles entreprendre d’unifier, en France, le contrôle des organismes qui relèvent, au sein de l’Union européenne, des directives sur l’assurance, et donc des entreprises d’assurance, des mutuelles régies par le Code de la mutualité et des institutions de retraite et de prévoyance.
Peut-être pourrions-nous, par ailleurs, nous contraindre à ne plus introduire dans notre réglementation de nouveaux textes qui ne soient pas » européens « .
Il est enfin permis de rêver, et d’espérer que l’Union européenne mettra prochainement1 en place un contrôle totalement unifié, sinon unique, des activités d’assurance.
_______________________________
1. Je veux croire que cela prendra moins de temps qu’il n’en a fallu pour prendre position sur le permis de conduire à points, qui a été lancé le 1er juillet 1992, plus de trente ans après ma présentation à nos camarades dans La Jaune et la Rouge d’octobre 1961.