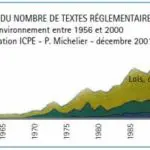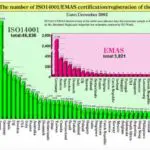Le secteur financier face à l’écologie

À première vue, la finance et l’écologie semblent appartenir à des univers différents, pour ne pas dire incompatibles : d’un côté, la circulation des flux financiers avec son rythme trépidant et ses multiples mouvements browniens qui peuvent rétracter ou élargir le stock de capital financier au gré des fluctuations boursières ; de l’autre, le capital des ressources naturelles exposé aux multiples prélèvements et restitutions de l’activité humaine, et dont les risques d’épuisement ou les opportunités de régénérescence renvoient à des cycles de très long terme.
Des zones d’intersection entre ces deux univers sont néanmoins apparues ces dernières années.
Elles concernent l’utilisation de techniques de marché pour la lutte contre les pollutions atmosphériques, l’apparition de nouvelles règles dans l’allocation des portefeuilles financiers et l’inclusion de l’écologie dans l’analyse du risque par les établissements financiers.
Vertus et limites des marchés de permis d’émission
Après les transactions sur actions, obligations, devises et dérivés en tous genres, la finance a encore élargi son champ d’intervention avec l’arrivée des marchés de permis d’émission improprement qualifiés de marchés de « droits à polluer ». Comme souvent en matière financière, le vent a soufflé depuis l’Amérique du Nord où a été installé, dès 1994, le premier marché des permis d’émission, destiné à lutter contre les rejets de SO2 à l’origine des pluies acides. Mais l’Europe prend rapidement le train : on peut d’ores et déjà traiter le dioxyde de carbone sur les places de Londres et de Copenhague, et l’Union européenne a prévu de mettre en place un marché européen des permis d’émission de gaz à effet de serre dès 2005, avec deux ans d’avance sur le calendrier prévu par le protocole de Kyoto.
L’intérêt du recours au marché est de faciliter l’atteinte d’un objectif global, fixé par la collectivité, de réduction de rejets de substances toxiques1. Les acteurs pouvant aller au-delà de cet objectif de réduction seront économiquement incités à le faire en valorisant leurs efforts sous forme de crédits d’émission. Les acteurs qui rencontreront plus de difficultés pourront acheter de tels crédits sur le marché pour respecter leurs engagements. Le marché des permis d’émission ne confère donc pas le moindre « droit à polluer » à qui que ce soit. Il fixe simplement un prix de marché à la pollution évitée, ce que les économistes appellent le « coût marginal » de la tonne évitée. Ce faisant, il permet d’atteindre à moindre coût l’objectif initial de réduction des émissions en permettant un transfert depuis les acteurs les plus innovants ou les mieux placés vers les acteurs rencontrant les plus grandes difficultés. Dans ce nouveau contexte, le droit d’émission va ainsi devenir une nouvelle classe d’actifs sur le marché financier.
Dans le cadre du protocole de Kyoto, qui assigne au monde industrialisé un objectif de réduction globale des émissions de gaz à effet de serre de 5,8 %, cette classe d’actifs va en premier lieu circuler entre acteurs de pays industrialisés ayant chacun des engagements quantifiés de réduction des rejets atmosphériques de gaz à effet de serre. Dans ce cas, le rôle des acteurs financiers sera limité à celui, très classique, d’intermédiaires de marché. Par ailleurs, ils devront mettre en place une infrastructure permettant la circulation et la transparence de l’information, sous forme d’un registre des droits d’émission.
Le protocole de Kyoto prévoit également, via le mécanisme dit de « développement propre », de faire circuler ces permis d’émission entre pays industrialisés et pays en développement qui n’ont pas pris d’engagement de réduction : dans ce cas de figure, une entreprise pourra par exemple se constituer des crédits d’émission en investissant dans des projets définis comme économes en carbone dans les pays en développement. Ce type de transfert a peu de chance de s’opérer de façon spontanée. L’industrie financière a donc ici un rôle plus important à jouer d’ingénierie financière pour localiser les projets éligibles, les mutualiser lorsqu’ils sont de petite dimension unitaire, et les sécuriser pour attirer les investisseurs.
Via la constitution de ses deux fonds carbones (Prototype Carbon Fund, Bio Carbon Fund), la Banque Mondiale s’est déjà engagée dans cette voie. L’effet de levier pourra être multiplié si d’autres acteurs financiers s’engagent dans la construction de tels fonds de co-investissement, en apportant notamment toute la gamme désormais très sophistiquée de gestion du risque.
Les différentes simulations économiques suggèrent que l’utilisation du marché des permis d’émission pourrait permettre de diviser de moitié le coût des mesures à prendre pour atteindre les objectifs de réduction des émissions fixés à Kyoto. Si la réalité confirme ce diagnostic, ce sera une bonne illustration de la contribution possible du monde financier à l’amélioration de l’environnement écologique.
Dans son organisation actuelle, le marché des permis d’émission ne permettra cependant que de lutter contre les émissions concentrées qui ne représentent qu’un peu moins de la moitié des rejets atmosphériques de gaz à effet de serre. Il sera inopérant face aux pollutions diffuses qui résultent de l’accumulation de comportements individuels : ni l’automobiliste ni le locataire n’auront à l’évidence la faculté d’accéder au marché des permis pour compenser par un achat de crédits d’émission les rejets provoqués par leur comportement. Face à de telles situations, il faut trouver d’autres instruments, dont certains peuvent répondre aux nouvelles attentes des investisseurs de long terme.
De nouveaux champs ouverts par « l’Investissement socialement responsable »
La montée en régime de « l’Investissement socialement responsable » (ISR) marque une rupture liée au rôle croissant des investisseurs institutionnels qui ont des préoccupations de rendement et de sécurité des portefeuilles à long terme, puisqu’il s’agit de gérer des droits à la retraite, des réserves d’assurance-vie ou encore de l’épargne collective de salariés. Pour respecter ses engagements, l’investisseur ne peut plus se contenter d’une vision à quelques trimestres des rendements attendus de la firme. Il doit élargir les méthodes classiques de l’analyse financière en intégrant notamment les critères de protection de l’environnement et de recherche d’équité sociale suivant les principes du « développement durable ».
Porté en Europe par une poignée d’acteurs pionniers, l’assureur et gestionnaire d’actifs Storebrand en Scandinavie, la banque Triodos aux Pays-Bas, le gestionnaire d’actif suisse SAM, et quelques autres, ce mouvement est en train de s’élargir rapidement.
Dans ses formes actuelles, l’Investissement socialement responsable contribue essentiellement à exercer une pression nouvelle sur les grandes firmes cotées, qui doivent – et devront – rendre davantage compte des retombées de leurs activités sur l’environnement. Son potentiel de développement est désormais tributaire de la capacité des acteurs financiers à élargir cet univers d’investissement encore bien trop étroit2. Dans cette perspective, trois types de développements sont susceptibles de drainer de nouvelles ressources vers la protection de l’environnement.
Le capital investissement permet de stimuler l’innovation et le développement dans le tissu des petites et moyennes entreprises. D’après une étude de l’Insead, il a permis de drainer 100 millions d’euros en 2000 (33 en Europe et 67 aux États-Unis) sur des projets « verts », ce qui a représenté environ 0,1 % du marché total. Même si cette proportion a significativement augmenté depuis, elle souligne le caractère très jeune de ce marché qui se heurte au niveau élevé des risques à prendre. C’est pourquoi l’un des leviers de son développement passe par la constitution de fonds de co-investissement, du type de celui mis en place en France par l’Ademe et la Caisse des Dépôts, dans lesquels les capitaux privés sont attirés et sécurisés par la présence d’acteurs publics qui amortissent les risques.
Une deuxième voie de diversification concerne les investissements dans les infrastructures locales qui conditionnent l’organisation de la ville, et en particulier leurs bilans écologiques. D’une façon générale ces investissements combinent, avec de multiples variantes, des financements publics, des opérateurs et apporteurs de capitaux privés. Dans certains cas, ces partenariats public-privé permettent de financer à conditions privilégiées des infrastructures « vertes », par exemple celui opéré en Allemagne par la KFW qui refinance les projets d’investissement dans les panneaux solaires. Mais l’effet de levier le plus important pour le renforcement de l’écologie consistera à introduire une évaluation systématique sous forme de notation écologique de tous les projets d’investissement et de rénovation urbaine.
La systématisation d’une telle démarche de notation permettrait, via la titrisation des portefeuilles liés aux projets, de créer un nouveau compartiment sur le marché obligataire, labellisé développement durable. Un tel compartiment rendrait bien service aux investisseurs et gestionnaires qui ne disposent pas aujourd’hui d’outils pour pratiquer l’Investissement socialement responsable sur les marchés de taux. Il serait susceptible de générer liquidité et allégement du coût de la dette pour les projets innovants des acteurs locaux.
Vous avez dit « risque » ?
À peu près toutes les innovations introduites par les acteurs financiers depuis vingt ans ont tourné autour de la gestion du risque. Mais à quelques exceptions près, comme par exemple celle de la Caisse alsacienne des Banques Populaires qui a développé un outil performant d’évaluation des retombées écologiques dans le financement des PME, ces innovations sont restées circonscrites aux risques financiers stricto sensu. Aussi les méthodes d’appréhension des risques écologiques par les établissements financiers ont-elles de nombreux progrès à effectuer.
Les choses pourraient cependant rapidement évoluer car, du fait de la montée de la pression en provenance de la société civile, ces établissements se mettent eux-mêmes en risque de réputation s’ils continuent à sous-estimer cette dimension.
La pression environnementale s’est d’abord exercée sur les activités économiques pratiquant le plus directement l’extraction et la transformation de la matière première. De par leur nature, ces activités sont susceptibles de directement perturber les équilibres écologiques. Elle s’est ensuite propagée vers les activités manufacturières dont les modes de production et de distribution sont également susceptibles de perturber les cycles de reconstitution du capital de ressources naturelles. Elle a enfin touché les secteurs de service dont la finalité n’est plus de produire des marchandises mais de fournir des prestations dématérialisées.
Au sein du secteur tertiaire, l’industrie des services financiers est l’une des activités les plus éloignées de la matière : son principal intrant est en effet l’information dont l’accessibilité, la transparence et la fluidité constituent les conditions nécessaires au fonctionnement des marchés financiers. C’est pourquoi pendant longtemps, les institutions financières ont pu se considérer comme non concernées par les problématiques du renouvellement du patrimoine naturel et plus généralement du développement durable.
Cette ère est révolue. Du fait de leur contribution à la globalisation des marchés de capitaux, vecteur privilégié de la mondialisation, les institutions financières sont désormais sous les projecteurs de la société civile. Celle-ci considère que la responsabilité des acteurs financiers est non seulement d’assurer le bon fonctionnement des circuits financiers, mais qu’elle est également engagée par leurs impacts sur le fonctionnement de l’économie. Il y a du reste fort à parier que cette pression ira croissant pour une raison très simple : parmi l’ensemble des secteurs de l’activité économique, l’industrie financière est celle qui a, sans doute possible, l’impact le plus structurant sur l’organisation et le fonctionnement de l’ensemble du système productif. Pour tous ceux qui ont le souci de faire évoluer l’ensemble du système vers plus de sécurité environnementale et d’équité de long terme, le monde de la finance représente par conséquent un formidable levier potentiel de changement.
C’est pourquoi les points d’intersection apparus entre finance et environnement sont loin d’être circonstanciels. Ils marquent les prémisses d’une nouvelle ère durant laquelle l’industrie financière sera jugée, non seulement sur l’efficacité de ses méthodes, mais aussi sur l’utilité sociale et environnementale de ses finalités. Pour se mettre au diapason de ces nouvelles dimensions, il lui reste pas mal de progrès à effectuer.
________________________________
1. Les permis négociables se sont déjà appliqués aux rejets de SO2, à la pêche (voir l’article de Jean-Paul Troadec dans La Jaune et la Rouge de mai 2002), à la pollution des rivières…
2. Voir l’excellent article du vice-président de Storebrand : Carlos Joly, Les défis de l’investissement durable, Rapport moral sur l’argent dans le monde en 2002, Association d’Économie financière, 2003.