Management public, où est le problème ?

Cet article s’efforce de donner un éclairage sur le caractère pérenne des difficultés que l’on rencontre pour réformer en profondeur la gestion publique. Il part de l’idée que le métamodèle de gestion publique plus ou moins adopté par l’ensemble des pays industrialisés se heurte à des caractéristiques robustes de l’action publique dans ces mêmes États et que le dépassement de cette antinomie ne peut s’effectuer que par deux voies, difficiles l’une et l’autre.
La réforme de la gestion publique est inscrite à l’agenda depuis des dizaines d’années. En France, le mouvement Organisation et Méthode, la Rationalisation des choix budgétaires (RCB), le renouveau du service public ont constitué dans le passé quelques-unes des tentatives pour changer le mode de gestion de nos administrations. À l’étranger la succession des réformes n’a pas été moindre. Aux États-Unis par exemple, les administrations et agences fédérales ont connu le Planning, Programming, Budgeting, System (PPBS), la direction par objectif (MBO), le budget à base zéro (ZBB) avant le Government Performance Review Act (GPRA) de 1993 toujours en vigueur.
Il est difficile, même avec le recul des ans, de discerner dans ces réformes ce qui était une volonté authentique de changement de ce qui ne constituait qu’un tribut rendu à l’air du temps. D’autant que la volonté de changement réelle de quelques innovateurs hauts fonctionnaires ou même responsables politiques a pu, au moment même où elle se manifestait, se diluer dans un océan de scepticisme du reste des dirigeants des administrations publiques.
Sans nier des avancées réelles on ne peut que constater que la grande mutation de la gestion publique est, dans un pays comme le nôtre, encore pour demain.
Le fait que la réforme a été pratiquement depuis trente ans toujours à l’agenda, que la nécessité d’une » nouvelle » gestion publique est considérée comme allant de soi par les organismes internationaux (OCDE en particulier) et que les résultats aient été pour l’instant relativement mitigés nous paraissent soulever deux questions fondamentales : existe-t-il un modèle de management public auquel la réforme réitérée devrait tendre ? Quels sont les obstacles qui se seraient opposés, jusqu’ici, à une véritable réussite de la réforme ?
Un métamodèle de gestion publique
Le modèle vers lequel il s’agirait de tendre n’a jamais été à notre connaissance véritablement explicité ni par les académiques pour qui être normatif est pratiquement un déshonneur, ni par les praticiens innovateurs qui se contentent souvent de règles apparaissant comme de bon sens. On peut cependant noter quelques valeurs constantes qui définiraient les grands principes de la réforme.
Déjà à l’époque de la RCB il était question de substituer à une » nomocratie » ou gouvernement par les règles, une » téléocratie » ou gouvernement par les objectifs. Depuis la même idée est réapparue sous les formes de gouverner pour des résultats (governing for results) ou encore de management de la performance. La nouvelle loi organique sur les lois de finances (LOLF) met explicitement l’accent sur cette valeur en exigeant de chaque ministère la mise sur pied d’objectifs et d’indicateurs de performance. On est dans une logique mettant l’accent sur la fonctionnalité de l’action publique et insistant sur la légitimation de celle-ci par le fait qu’elle atteint les objectifs prévus (efficacité) et sans consommation excessive de moyens (efficience). Efficacité et efficience constituant les deux vecteurs de la performance.
Liée à la recherche de la performance est celle de la cohérence. La performance demande en effet une irrigation suffisante de chaque administration par les objectifs stratégiques de celle-ci et donc une déclinaison des objectifs stratégiques en une série d’objectifs opérationnels susceptibles de permettre à tous les niveaux une mobilisation des efforts du personnel. Cette recherche de la cohérence, formalisée dans les entreprises par les différentes formes de management ou directions par objectifs, a été transposée au niveau des administrations sous la forme de structures d’objectifs et de programmes à l’époque de la RCB, de direction par objectifs en diverses occasions, elle s’incarne aujourd’hui dans l’architecture mission, programme, action, sous-action, requise par la loi organique…
Associée aussi à la recherche de performance est l’idée d’une délégation renforcée – le postulat étant que » la centralisation ça ne marche pas « . Cette délégation pouvant être une délégation de facto au profit par exemple des bureaux d’administration centrale comme une délégation de jure au profit de services déconcentrés de l’État.
Recherche de la cohérence et volonté de déléguer amènent à une formalisation des attentes. Dans le passé les centres de responsabilité et les contrats locaux, aujourd’hui les diverses formes de contractualisation, demain les Projets d’amélioration de la performance (PAP) exigés des ministères traduisent cette idée de formalisation des attentes à l’égard des différents niveaux de la sphère administrative ou des engagements pris par eux.
Performance, cohérence, délégation, formalisation, le tout n’a de sens que si des informations pertinentes et fiables sur les résultats et les coûts auxquels ils ont été obtenus existent d’où l’insistance mise sur les systèmes de contrôle de gestion et leurs composantes comptabilité analytique, indicateurs de reporting.
Ce programme de modernisation que l’on peut considérer comme un métamodèle incarne une forme de rationalité dominante dans nos sociétés et supposée s’imposer à un haut degré dans la grande entreprise contemporaine rencontre en tant que tel peu d’oppositions de principe. Tout juste certains cercles syndicalistes assez hostiles à toute forme de changement de l’administration y voient-ils une forme de privatisation – précisément en raison de sa parenté intellectuelle avec la gestion privée -, mais ils se révèlent, en la matière, assez minoritaires. Le problème vient de ce que la multiplicité des vagues de réformes révèle la difficulté de la mise en œuvre d’un véritable changement dans le management de nos administrations.
Cette difficulté vient pour nous du fait que l’hypothèse fonctionnaliste plus ou moins implicite de l’action publique sur laquelle se fondent les mouvements de réforme est trop pauvre, trop réductrice de la réalité de l’action publique.
Une action publique qui ne vise pas seulement à des résultats au regard d’objectifs préétablis
L’action publique, dans les pays démocratiques, paraît structurée par trois catégories d’exigence que la vie politique impose à nos décideurs.
- La première est d’opérer une réduction d’attentes, c’est-à-dire de ne retenir qu’une partie des demandes – innombrables, changeantes et pour partie contradictoires – qu’émettent les différents groupes du corps social. Il s’agit d’opérer des choix parmi ces demandes et d’obtenir des résultats concrets au regard des problèmes auxquels on a choisi d’apporter une solution.
Le métamodèle managérial qui inspire les réformes apporte sans doute une contribution de principe importante à la réponse à cette exigence. - La deuxième exigence est de ne pas pousser au désespoir des groupes sociaux dont les attentes n’ont pas été privilégiées, de ne pas » désespérer Billancourt « . Cette deuxième exigence n’est pas simplement éthique, ne traduit pas seulement une sorte de respect de minorités par la majorité, elle est également et de façon plus triviale une forme d’évitement du risque, risque d’explosion sociale, de paralysie plus ou moins importante de secteurs économiques, risque électoral. Pour les politistes elle se traduit par l’élaboration de politiques dont les principes, les référentiels vont à l’encontre des référentiels dominants. Elle peut se traduire également par un certain flou dans l’énoncé des choix opérés, par une certaine dilution de ces choix (saupoudrage de crédits plutôt que centrage de ceux-ci)…
Le travail d’explicitation, de clarification, d’expression de la rationalité – au sens d’insistances sur les liens de cause à effet entre ce que l’administration fait et ce qu’elle vise comme résultat – de l’action publique inhérente au modèle métamanagérial va directement à l’encontre de certaines formes répandues de réponses à cette deuxième exigence. - La troisième exigence est, pour retourner l’expression de Max Weber, l’enchantement du réel.
Le responsable politique ne peut se contenter de faire, il faut qu’il fasse adhérer à un projet, un dessein, une façon de penser comportant obligatoirement une part d’utopie, une part de rêve. Cette part doit être susceptible de sortir de temps en temps chacun des strictes contraintes de son univers quotidien. On notera, a contrario, que l’homme politique pragmatique est facilement critiqué » parce qu’il ne nous fait pas rêver « .
De cette troisième exigence découle l’importance du discours, du verbe dans la vie publique. Ce n’est pas un hasard si la communication moderne est l’aspect du management qui a été le plus vite et le plus complètement adopté par les décideurs – et si les services de communication sont souvent sortis de l’administration proprement dite pour être rattachés au cabinet, au politique.
Quant à notre métamodèle managérial il se révèle peu pertinent comme réponse à cette troisième exigence, puisqu’il est par nature terriblement pragmatique et qu’il oppose la neutralité voire la froideur des chiffres – qui sous le nom d’indicateurs et d’objectifs cibles constituent sa véritable charpente – au lyrisme et à toutes les formes d’approximations et d’arrangement que permet le discours. Le métamodèle managérial désacralise, démythifie, là où la sacralisation et là où la création et l’entretien des mythes font partie de la règle du jeu.
Discipliner le pouvoir ou réussir le découplage ?
Pour faire court énonçons donc qu’il existe une antinomie au moins partielle entre la » rationalité » politique se manifestant par les trois exigences que l’on vient succinctement de décrire et la » rationalité » managériale que s’efforce de véhiculer le métamodèle brièvement présenté plus haut. La question est alors » comment le métamodèle peut-il être mis en œuvre avec succès ? » et la réponse première apparaît comme » par la discipline du pouvoir » !
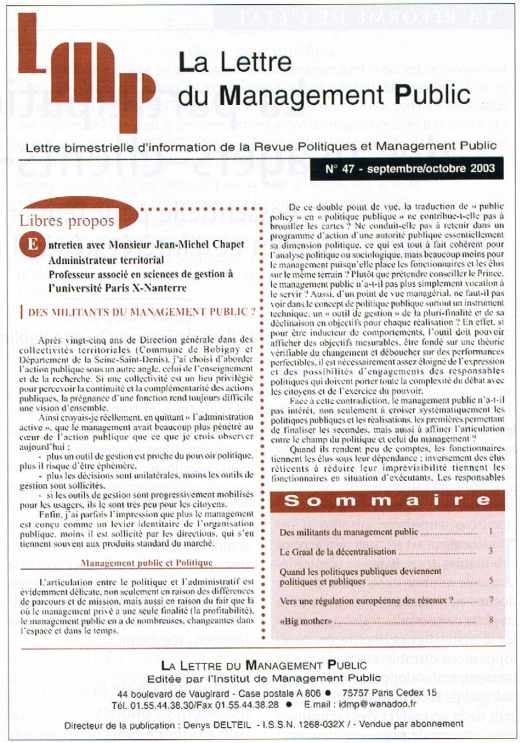 Cette réponse est en apparence provocatrice autant que paradoxale puisqu’elle paraît faire fi de la légitimité et elle va à l’encontre de l’idée assez répandue que la modernisation de la gestion publique est un problème en grande partie technique et consistant par ailleurs à convertir la masse des fonctionnaires à une culture de gestion.
Cette réponse est en apparence provocatrice autant que paradoxale puisqu’elle paraît faire fi de la légitimité et elle va à l’encontre de l’idée assez répandue que la modernisation de la gestion publique est un problème en grande partie technique et consistant par ailleurs à convertir la masse des fonctionnaires à une culture de gestion.
Remarquons cependant que dans les réformes étrangères les plus marquantes la discipline du pouvoir s’est concrétisée de façon organique. La banalisation du fonctionnement en agence (par exemple en Nouvelle-Zélande) avec l’instauration d’une séparation de principe entre un ministère dirigé par un homme politique et élaborateur de politiques et une agence dirigée par un manageur et metteur en œuvre traduit le renoncement du politique à vouloir maîtriser l’ensemble de la chaîne de l’action publique. Elle revient fondamentalement à limiter le champ de la rationalité politique en restreignant – en principe – l’interface entre celle-ci et la rationalité managériale au choix du dirigeant de l’agence, à son cahier des charges ainsi qu’au contrat passé entre l’agence et le ministère.
Lorsque cette solution organique n’est pas retenue, l’application du modèle métamanagérial est confiée à des procédures de portée juridique très diverses. La vision optimiste des choses pour la France, aujourd’hui, consiste à souligner que le modèle métamanagérial est porté par la LOLF, c’est-à-dire qu’il bénéficie du statut juridique le plus élevé après la Constitution et qu’il est associé à l’allocation budgétaire, acte fondamental s’il en est, de la gestion publique au concret. Il n’en reste pas moins que la discipline qu’impose la LOLF est une discipline imposée aux administrations, non au politique.
Or c’est du politique seul que dépend qu’il y ait des véritables objectifs pour les missions programmes et actions présentés par un ministère et non des objectifs flous. C’est du politique qu’il dépend que l’action d’un ministère ou de l’une de ses composantes soit jugée sur la situation au regard d’un indicateur mettant sous contrôle sa responsabilité et non pas sur des incidents avec tel ou tel groupe social ou sur l’occurrence d’un risque que la recherche de la performance aura fait prendre. C’est du politique encore qu’il dépend que la discussion budgétaire au Parlement se fonde sur les projets et rapports d’amélioration de la performance et pas sur tel ou tel problème local ou corporatiste…
En d’autres termes le statut élevé de la procédure et son contenu sont de bonnes choses, ils ne sont pas suffisants pour assurer que les règles de la LOLF seront, bien plus qu’un moule dans lequel il convient de s’inscrire, un véritable vecteur de changement. La force de la LOLF comme élément structurant la gestion publique, sa crédibilité auprès des fonctionnaires, petits et grands, comme déterminant des règles du jeu de la gestion publique dépendra du comportement de l’exécutif comme du législatif.
Ce faisant n’adoptons-nous pas une optique trop » macro » et pas assez » micro » ? N’accordons-nous pas trop d’importance au sommet de la pyramide et pas assez à l’affermissement de la gestion de la masse des administrations centrales, des services déconcentrés comme des établissements publics ? N’existe-t-il pas en France tout un courant de la littérature de la gestion publique pour souligner les initiatives, les actions de progrès, l’appétence d’initiative que manifeste une bonne partie des fonctionnaires ? N’existe-t-il pas indépendamment de la LOLF des invitations au changement comme, par exemple, l’obligation faite au ministère par un Comité interministériel à la réforme de l’État de développer des systèmes de contrôle de gestion ?
La réalité des actions poussant à un développement de principes et d’une culture de gestion de même que la fertilité du terrain dans de nombreux pans de l’administration ne font aucun doute. Le problème est alors celui de l’implantation de systèmes inspirés du métamodèle de gestion publique à des niveaux plus modestes que celui de l’intégralité d’un ministère et des facteurs de pérennité de tels systèmes. À notre sens cette pérennité requiert trois conditions cumulatives :
- un travail en profondeur pour que explicitation et quantification des objectifs des résultats et des coûts apparaissent comme une traduction réelle de ce que vivent les niveaux concernés, de leurs préoccupations et de leurs responsabilités réelles ; à défaut le système de gestion apparaîtra comme périphérique, marginal, voire comme une nouvelle forme de gadget managérial ;
- un système d’informations sur les résultats c’est-à-dire extracomptable capable d’alimenter de façon fiable les indicateurs retenus. Faute de quoi le système s’arrête ou l’on en revient à des indicateurs choisis en fonction des informations disponibles au départ, c’est-à-dire à contrôler ce qui est contrôlable et non ce qui est pertinent ;
- un système de récompense de la performance qui réclame d’abord une reconnaissance du système de la rémunération au mérite mais qui réclame aussi que le mérite soit assimilé pour la plus grande part à la performance telle qu’elle découle des indicateurs de performance retenus dans le système de reporting au profit de la hiérarchie. Cette dernière condition suppose que l’on admette un certain découplage entre la façon dont on est jugé au plus haut niveau de la hiérarchie – c’est-à-dire d’une façon qui ne correspond pas seulement à la première exigence de l’action publique – et la façon dont on juge ses collaborateurs. Ce découplage n’est pas impossible mais il est psychologiquement difficile et suppose un travail considérable sur le système d’appréciation de la performance.




