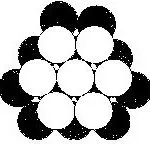Quelle crise de la recherche en France ?
Situation de la recherche publique au début des années 1980
Situation de la recherche publique au début des années 1980
Une grande partie de la recherche publique est traditionnellement effectuée dans les universités dont le principe fondateur, depuis plus de sept cents ans, est l’élaboration et la transmission du savoir, dans un contexte, au moins formel, d’indépendance à l’égard de tout pouvoir. À cela s’ajoutent les grands organismes de recherche publique de création plus récente. C’est cet ensemble qui a assumé l’essentiel de la recherche française jusque vers les années 1970–1980, fondant ainsi la base de l’essor culturel, scientifique, technologique et donc économique français et de l’influence qui en a résulté, par exemple : le programme nucléaire français, le développement du laser, les progrès décisifs de la biologie moléculaire et de la virologie, de la médecine, les technologies de la propulsion induisant les vols spatiaux, les progrès dans les transports, les microtechnologies, les méthodes de communication, les moyens de défense, sans parler des progrès auxquels notre pays a contribué dans le passé. Bien entendu, dans les années cinquante à soixante-dix, tout cela fut rendu possible par une volonté politique continue. Mais cette volonté politique eût été totalement impuissante si elle n’avait pu s’appuyer sur les personnes, sur leurs acquis intellectuels, sur leurs savoir-faire, ainsi que sur le niveau général très élevé d’instruction de l’ensemble du pays.
Vers une mise en cause
Soudain, au début des années 1980, des esprits » brillants » décident que rien ne va plus. En particulier, un universitaire, très médiatisé et politisé, découvre soudain que les deux tiers de ses collègues sont des » fainéants » alors qu’il a lui-même abandonné toute recherche depuis longtemps. Un conseiller spécial du ministre de l’Éducation nationale de l’époque dénonce l’inutile complication des mathématiques et de la physique qu’il ne comprend pas.
Mais ces initiatives médiatiques ont tout de suite des applications concrètes. La première conséquence, la plus nocive sans doute, car elle affectera les générations futures, est la réforme du doctorat. Jusqu’alors, le système est à peu près en équilibre. En particulier, la thèse d’État sanctionnait la capacité à effectuer de manière autonome un travail de recherche original et permettait de postuler aux corps de professeurs des universités ou de directeurs de recherche, assurant ainsi le renouvellement du corps professoral universitaire.
D’un seul coup, on décide qu’il n’y a pas assez de docteurs, qu’il faut former » à et par la recherche « , qu’il faut » produire » de 11 000 à 12 000 docteurs par an, d’où la création d’une » nouvelle thèse « , sur le modèle américain, remplaçant la thèse de troisième cycle, et la création d’une » habilitation à diriger les recherches « , se substituant à la thèse d’État, et qui se réduit le plus souvent à une simple compilation des articles déjà publiés.
Simultanément, la charge d’enseignement des enseignants-chercheurs est multipliée par le facteur 1,7. Bien sûr, les mêmes esprits » brillants » commencent alors à se lamenter sur le fait que les universitaires n’ont plus assez de temps pour mener à bien leurs travaux de recherche, ni pour encadrer les thèses qu’on a décidé de produire en série. Ainsi est créée une » prime de recherche et d’encadrement doctoral » destinée aux enseignants-chercheurs qui encadrent des thèses, pour qu’ils puissent remplir leurs missions, après qu’on leur en a retiré les moyens statutaires.
La première conséquence sera l’abaissement du niveau moyen des thèses : les directeurs de thèse finissent parfois par écrire en grande partie la thèse d’un doctorant pour conserver la prime. Le clou du système est la » charte des thèses » : par la signature de ce document officiel, le professeur s’engage à donner à son doctorant » un sujet de recherche faisable » ! Ensuite, les débouchés ne suivent pas. L’augmentation des charges d’enseignement a permis d’absorber, par des recrutements stables ou en régression, un nombre d’étudiants que le pouvoir politique veut, pour des raisons électorales, faire croître au-delà des capacités réelles des universités, trompant ainsi de nombreuses personnes quant à leurs chances de réussir leurs études supérieures.
De surcroît, les doctorants ne trouvent plus de débouchés en rapport avec les connaissances acquises. Devant ce gâchis humain, certains professeurs d’université en arrivent à conseiller à leurs étudiants de fuir à l’étranger : tant qu’à devoir subir le système anglo-saxon, autant aller se confronter à l’original.
Le nouveau tournant de 1990
Au début des années 1990 est franchie une nouvelle étape. Les prétendues réformes multiplient les structures, les couches de contrôle bureaucratique, tout en concentrant les personnes qui travaillent en » unités » gigantesques. On espère ainsi renforcer le contrôle des activités scientifiques par les pouvoirs politiques et économiques et » identifier, former et promouvoir » des » chefs de projets » supposés savoir mieux que quiconque comment » réaliser des objectifs « . Avant tout, la création de cette superstructure bureaucratique permettra de caser certains universitaires ou chercheurs qui se sont aperçus que les travaux de recherche et d’enseignement sont difficiles puisqu’il faut s’y remettre constamment en cause et s’y consacrer totalement. Ces personnes comprennent alors qu’elles ne sont pas faites pour cela et se rendent compte qu’il est beaucoup plus facile » d’animer » des commissions.
Ainsi, sous prétexte » d’animation « , toute une catégorie de personnes, plus douées pour les manœuvres syndicales et politiques que pour la science, est recyclée aux postes de » gouvernance » des universités et des organismes de recherche, et métamorphosée en » évaluateurs professionnels » dont la sévérité n’a d’égale que l’incompétence, le conformisme et l’étroitesse de vues. Pourtant ces personnes ont souvent bénéficié d’une très grande facilité dans leur recrutement et leur carrière de titulaire, ainsi que de moyens très généreux pour leurs travaux.
Un fonctionnement analogue s’est instauré au CNRS : les directions » scientifiques » ont utilisé la complicité de membres des commissions, à la fois juges et parties, alléchés par des promotions ou des moyens pour leurs laboratoires, pour détruire, sans motivation scientifique, de nombreuses » petites équipes » indépendantes sous des prétextes bureaucratiques (« masse critique »)… Tout cela est ubuesque : la formation des personnes de ces équipes, la mise en place elle-même de ces équipes, a nécessité, tout au long de la carrière de leurs membres, des efforts, des sacrifices considérables, du pays et de leur part. Cela est réduit à néant, au moment même où ces personnes pourraient atteindre le maximum de leurs capacités.
La vraie crise de la recherche aujourd’hui
Y a‑t-il vraiment une crise de moyens, de compétences ou de personnes dans la recherche publique française ? Les moyens semblent suffisants puisque, par exemple, la plus grande université scientifique française, avec l’accord de la quasi-totalité des élus syndicaux de son conseil d’administration, vient de voter une réduction de son budget de 20 %.Y a‑t-il une crise des personnes et des compétences ? Les personnes sont là, les compétences sont encore là, mais pour combien de temps ? Dans leur majorité, les chercheurs et les universitaires continuent de travailler et de réussir dans des conditions de plus en plus difficiles, s’apparentant désormais au harcèlement professionnel imposé par des incompétents ou des opportunistes.
L’approche structuraliste actuelle pose comme principe que des structures axées sur la collectivisation et le contrôle induiront spontanément des innovations et des découvertes. Or, l’abus de telles structures détruit les conditions fondamentales de la création intellectuelle : sérénité et liberté. Surtout, il tend à écraser ou exclure les minorités, alors que l’innovation et la création sont, par définition, le fait de minorités constituées par des personnalités qui ont su remettre en cause les ordres établis. Ainsi, peu à peu, les institutions scientifiques se transforment en machines destinées à empêcher les personnes d’exercer leurs missions. Voilà la véritable crise de la recherche, induite par l’idéologie des responsables. Mais, nous le savons bien, une idéologie, une fois établie, peut déployer ses méfaits pendant longtemps. Il est souvent affirmé :
» La recherche est une activité collective. » Cette affirmation est une banalité si elle signifie que, depuis la plus haute antiquité, les moyens de travail de la recherche scientifique (navires, observatoires, bibliothèques, aujourd’hui satellites, détecteurs, accélérateurs…) sont souvent collectifs dans leur construction et leur utilisation. Elle est une absurdité si elle signifie qu’un collectif pense. Elle constitue une escroquerie et surtout un danger si elle sert d’alibi à certains pour imposer leurs vues et créer une » science d’État « .
L’avenir d’un pays, d’une nation, son influence se jouent d’abord sur l’enseignement de tout niveau et sur la capacité de création intellectuelle et d’innovation. Cette création s’enracine dans l’activité mystérieuse et patiente de la pensée qui agit, le plus souvent, sans même que nous en soyons conscients. Mais cette création est aussi le résultat du hasard et des contingences, des rencontres inattendues, comme tout ce qui relève de la subjectivité humaine. Cela ne peut donc être réduit à une question de moyens, de structures et d’organisation, mais est essentiellement une question de personnes, de patience et d’enseignement. Seules, les personnes assimilent, pensent, créent. Les collectifs, les structures, les organisations ne pensent pas plus que les murs des laboratoires : leur rôle consiste à aider les personnes et non pas à les déstabiliser ou les harceler. Lorsqu’une idée nouvelle apparaît, elle est non reproductible en tant qu’idée nouvelle. D’où plusieurs conséquences : étant non reproductible, une découverte n’a pas de prix, pas de valeur au sens économique. Combien ont été payés les générations de professeurs qui ont mis au point les lois de l’électrodynamique tout au long du xixe siècle ou encore l’inventeur du principe de la vaccination ? Ils ont été payés, bien sûr, souvent très mal comme professeurs d’université, mais certainement pas en rapport avec les conséquences de leurs découvertes puisque ces conséquences ne sont apparues que bien longtemps après.
Que signifie donc la directive de la Commission européenne voulant privilégier les activités de recherche » à valeur ajoutée maximale » ? Dans le domaine des découvertes et de la recherche d’informations, il est illusoire de prétendre prédire une valeur ajoutée, entre autres, parce qu’il faudrait spécifier à la fois la durée sur laquelle cette valeur ajoutée se consolide et la manière dont elle le fait, et c’est exactement cela qu’il est impossible de prédire. La valeur ajoutée des lois de l’électrodynamique ou de la découverte de Pasteur est zéro, pour leurs auteurs et l’infini, cinquante ans plus tard. Ainsi, la recherche, par définition, n’est en général ni programmable dans ses résultats, ni évaluable au sens marchand. Évidemment, nous avons tous des projets. L’État, les entreprises peuvent et doivent aussi en avoir. Mais, souvent, ces projets ne se réalisent pas tels qu’ils furent imaginés. La réalité se charge de ramener rapidement l’imaginaire des projets et programmes à ce qu’il est : à la fois, tout, comme moteur de l’action, et, souvent, rien, comme résultat de la connaissance.
La recherche sur objectifs nous paraît donc constituer une impossibilité logique, il en est de même de son évaluation a priori. Une régulation de la recherche par la » demande sociale » constitue une malhonnêteté intellectuelle et une imposture vis-à-vis de la société. La demande sociale semble être un prétexte invoqué par des responsables désireux de contrôler le système. Le véritable questionnement apporte une réponse qui n’ira pas obligatoirement dans le sens voulu par la contingence politique ou la » demande sociale « . La nature, que nous interrogeons et qui répond toujours, ne connaît ni sens politique ni demande sociale.
D’où la nécessité vitale d’une recherche libre et indépendante. Le xxe siècle nous a fourni de douloureux exemples de ce qui se produit lorsqu’on oublie cette remarque. Sans compter que les développements de nouvelles technologies ou de nouvelles menaces nécessitent des débats contradictoires et impliquent donc que des personnes indépendantes et compétentes informent des risques et confrontent librement les diverses solutions entre elles. La revendication fondamentale de ceux qui font effectivement le travail dans l’enseignement supérieur et la recherche, c’est qu’on les laisse enfin travailler dans l’indépendance et la sérénité indispensables à la réflexion et à la création intellectuelle. Et il n’est pas clair qu’ils revendiquent autant de moyens que le réclament ceux qui prétendent les représenter.
Le problème des relations entre la recherche, l’enseignement et le pouvoir ne date pas d’aujourd’hui. Il y a 2 400 ans, à Athènes, Platon nous rapporte qu’un philosophe étranger, venu d’Élée, essaie de définir le pouvoir politique et ses différentes catégories, à la demande de Socrate, de Socrate le Jeune. L’Étranger, comme l’appelle Socrate le Jeune, en arrive à la description d’une caractéristique de la tyrannie : les tyrans veulent encadrer la liberté de la recherche et en délimiter les résultats par la loi. Reproduisons, en la traduisant librement, la partie du dialogue qui nous intéresse, elle se trouve au chapitre 38 du Politique.
» L’Étranger : Il faudra établir une loi précisant que quiconque effectue des recherches sur le pilotage, sur la santé et la médecine, sur le chaud et le froid et les vents et à imaginer quelques nouveautés sera traité de sophiste et de bavard et sera ensuite traîné devant les tribunaux, et s’il est démontré qu’il donne des conseils contraires aux lois en ces matières, il sera puni des derniers supplices. Car il ne doit y avoir rien de plus sage que les lois. S’il en est ainsi, Socrate, de ces sciences, et de la stratégie, de la peinture, de l’agriculture et de la fabrication d’ustensiles, si nous devions voir pratiquer selon des règles écrites l’art d’élever les chevaux et les troupeaux, l’art de servir ou la science des nombres appliquée aux surfaces planes, aux solides et aux mouvements, que deviendraient tous ces arts ainsi réglés sur des lois écrites au lieu de l’être sur la nature et l’art ?
Socrate le Jeune : Il est évident, Étranger, que c’en serait fait pour nous de tous les arts qui ne pourraient plus jamais renaître par suite de cette loi qui réglemente la recherche. Et notre vie, déjà si dure à présent, deviendrait alors absolument insupportable. »
(Platon, Œuvres. t. II, La Pléiade)