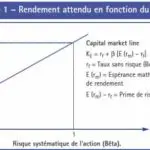Présence de Bernanos – L’invincible espérance III – Les Écrits de combat
I – Avant-propos
Nous avons accompagné Bernanos au Brésil devenu sa seconde patrie, mais laissant son cœur dans la première allant jusqu’au bout de la nuit française à la rencontre d’une autre aurore, espoir déçu à son retour, par le chaos politique régnant, la précoce renonciation du général de Gaulle, mais gardant l’espérance de son prochain retour aux affaires de la France, seule chance de salut à ses yeux.
Nous l’avons vu à la fois dévoré par sa mission et ses soucis de famille, arbitrage combien difficile, source de conflits intérieurs, de doutes sur la première, d’angoisses pour la seconde. Quelle disproportion entre sa propre faiblesse et la tâche démesurée requise par sa mission ! Est-il légitime d’imposer privations et souffrances à des êtres chers à cause des risques immenses que l’on a pris ?
J’ai mené une vie de chien, voilà le sûr, je dis une vie de chien et non pas une chienne de vie. Je ne regrette pas de l’avoir menée, mais elle a vraiment trop servi, trop souffert, il a trop plu dedans.
On aurait donc tort (comme l’a fait Paul Claudel) de voir en Bernanos un homme aigri, désabusé, malheureux : cette existence de labeur et d’angoisse, de communion au malheur de sa patrie et du monde s’accorde à son éthique chrétienne de dépouillement, de participation au mystère de la Sainte Agonie répandue sur le monde. N’accueille-t-il pas comme une grâce son état de pauvreté et l’invincible espérance qui le porte.
Il faut que ma vocation, mon travail et ma vie ne fassent qu’un et que je soulève tout cela jusqu’à lui…
J’appartiens de toute mon âme au douloureux troupeau des hommes, je voudrais savoir assez les aimer pour compatir à leur misère et non pour les utiliser à des fins édifiantes…
Que pèsent en comparaison sur l’autre plateau de la balance ses outrances verbales, ses jugements à l’emporte-pièce, ses animosités personnelles si ouvertement affichés… ? Passion et mesure ne vont-elles pas rarement de pair et Bernanos, à qui manque totalement le don de patience, n’a jamais su gérer l’envers de ses qualités (comme ses intérêts matériels d’ailleurs).
Du moins savait-il reconnaître ses torts, ses erreurs, témoigner sa confusion, se reprendre, car ce n’était jamais pour blesser ni humilier qu’il s’emportait. Il était dans sa nature de vivre intensément l’instant.
Avant de quitter cet « homme de fureur et d’amour » (au dire de son fils Jean-Loup) écoutons encore deux témoignages émanant de confrères l’ayant bien connu, mais de tempérament très différent si ce n’est une même profession de foi catholique, d’abord celui de Mauriac qui avait dû essuyer les sarcasmes de Bernanos agacé par « l’érotisme funèbre » de ses personnages romanesques, trop occupés d’eux-mêmes.
On ne pouvait pas ne pas aimer cet homme, sa puissance de vie et d’accueil, générosité, tendresse, prodigieux personnage… les invectives les plus sanglantes de Bernanos demeurent liées à une nappe souterraine de charité qui a embrasé toute sa vie.
Autre témoignage, celui de Julien Green (l’auteur de Mont-Cinère en 1926, d’Adrienne Mesurat en 1927…), dernier survivant d’une prestigieuse génération d’écrivains. Interrogé sur Bernanos peu de temps avant sa mort en août dernier, ce grand nostalgique de sa Virginie natale, mystique et introverti, après quelques réserves touchant sa technique romanesque (éloge indirect de son art à lui ?) n’en concluait pas moins : « Un tempérament… Il nous manque. »
En quoi Bernanos manquerait-il à notre temps ? Telle est la question abordée ici. Le récit de sa vie et des témoignages concordants nous révèlent qu’il a laissé à ses contemporains le souvenir d’une extraordinaire présence, d’une voix libre quasi prophétique, s’élevant dans le désert et le désarroi moral d’années tragiques où il s’en était fallu de peu que l’Europe et sa vieille civilisation ne sombrent corps et âme.
Une telle voix ne manquerait-elle pas à notre temps où les motifs d’angoisse se multiplient ? Le grand oublié ne serait-il pas une fois de plus l’être, la personne humaine car c’est bien ce que n’a cessé de proclamer Bernanos dans ses Écrits de combat. Ces derniers n’ont certes jamais prétendu apporter des solutions concrètes, du moins avaient-ils valeur d’avertissement, d’appel à la vigilance hors desquels aucun sursaut salutaire n’est possible, avant que n’advienne l’heure des ténèbres.
∗
À l’exception des Grands Cimetières sous la lune, le plus achevé, le plus pathétique d’entre eux, les Écrits de combat restent dans l’ensemble presque ignorés d’un public, enclin à n’y voir que des écrits de circonstance liés à la dernière guerre mondiale, ce cauchemar dont le souvenir terrifiant hante toujours notre imaginaire (pensons ici au film Le Soldat Ryan).
Il faut d’abord considérer que l’on se trouve en présence d’un ensemble d’écrits aussi vaste que polymorphe : livres, essais inachevés, articles de presse, conférences, interviews… C’est très progressivement, après la mort de l’écrivain qu’ils ont été soit réédités, soit sauvés de la disparition au prix d’un patient travail de recherche et de reconstitution, en sorte qu’il a fallu attendre 1995 (soit vingt-quatre ans après le tome I) la sortie du tome II des « Écrits de combat » de La Pléiade (un fort volume de 1 950 pages !).
Une synthèse en paraît aussi prématurée que problématique. Il convient de laisser au temps le soin de mieux nous révéler la profondeur d’une pensée qui ne se dévoile que par degrés. Comment en effet résumer une œuvre essentiellement journalistique et orale où la pensée vivante se donne libre cours, jaillit spontanément hors des contraintes de la narration romanesque, rebondit, se renouvelle au gré des circonstances qui la sollicitent. La réflexion bernanosienne par ailleurs si personnalisée sort toujours appauvrie et décolorée quand on prétend la conceptualiser. Ses meilleurs exégètes l’ont si bien compris qu’ils s’effacent la plupart du temps derrière ses textes, n’ayant pour cela, faut-il le redire, que l’embarras du choix.
Que faire d’autre ici, sinon de puiser dans les Écrits de combat, paroles d’un homme libre adressées au cœur et à la raison d’autres hommes libres. Le lecteur ne s’étonnera donc pas si pour l’essentiel, comme précédemment, ce propos modeste est fait d’extraits de ses écrits, prélevés ici et là, ne donnant qu’une idée bien fragmentaire d’une œuvre inimitable.
Libre à chacun de partager ou non la vision bernanosienne. Du moins la lucidité de son regard en son temps nous invite-t-elle à ne pas prendre à la légère ses avertissements et à y réfléchir. On ne saurait cependant dissimuler la difficulté qu’il y a aujourd’hui à les entendre, étant donné la tyrannie diffuse exercée par ce qu’on peut appeler « le pensable possible » notamment en matière d’éthique du bien et du mal.
La réflexion bernanosienne ne s’éclaire que si l’on prend d’abord le soin et le temps nécessaires pour découvrir les fils conducteurs de l’inspiration des Écrits de combat.
Tel est plus précisément l’objet de ce propos.
II – Scandale de la vérité
Que voulez-vous, c’est très embêtant de réfléchir
sur certains problèmes qu’on a pris l’habitude
de considérer comme résolus.
Bernanos inaugure la longue suite de ses écrits brésiliens par une trilogie dont la rédaction s’échelonne de septembre 1938 à avril 1940 : Nous autres Français, Scandale de la vérité, Les Enfants humiliés.
Le premier est une réaction à chaud, un cri d’indignation à l’annonce de Munich. Je me trouve dans ce scandale comme dans un buisson d’épines et chaque effort que je fais m’arrache la peau. Le deuxième entame une réflexion approfondie sur cet événement, tandis que le dernier ouvrage (seulement publié en 1949) est un message d’espérance réclamant pour la France vaincue, dont l’honneur est à refaire, un souverain la rétablissant dans sa dignité et réhabilitant la vertu politique de l’honneur.
Faute de place, nous avons sélectionné dans cette trilogie antimunichoise : Scandale de la vérité, opuscule achevé en janvier 1939, publié trois mois plus tard à Paris, assurant la transition entre Les Grands Cimetières et cette sorte de « Journal de la Deuxième Guerre mondiale » que sont les écrits brésiliens dont il préfigure les principaux thèmes, les préface en quelque sorte.
...Je distingue volontiers entre M. Maurras et M. Jaurès. Il n’en est pas moins vrai que leurs destinées politiques se ressemblent. Tous les deux humanistes, tous les deux professeurs, également ignorants ou secrètement dédaigneux du vrai peuple, également experts à parler le langage de l’action, à noyer l’action réelle dans la phraséologie de l’action, à l’amortir, à l’étouffer… Le premier a poussé peu à peu son parti dans le cul-de-sac de l’union des gauches, comme le second jette le sien dans l’impasse de l’union des droites.
En fait l’intérêt de Scandale de la vérité est double : c’est d’abord l’histoire, le résumé magistral d’une faillite. Comment la France a‑t-elle pu, de démission en démission, en arriver là ? C’est aussi le dialogue de l’écrivain avec lui-même, un retour sur son passé. : en 1938, après deux dures années d’épreuves et d’intense création, Bernanos sent le besoin d’un nouveau souffle, regard interrogateur de l’homme mûri, arrivé à un carrefour de sa vie et de ses engagements. N’est-il pas naturel en un tel moment de consulter un guide, un maître ? En l’occurrence Péguy pour qui le surnaturel est lui-même naturel, Péguy de Notre jeunesse dont il se sent si proche, auquel il ne cesse désormais de se référer. Certes Péguy, républicain sans repentirs et Bernanos, fidèle monarchiste ne campent pas sur une même rive politique, mais qu’importe, ne se font-ils pas la même idée de l’honneur de leur patrie et de son baptême chrétien. Or Péguy et lui ont vécu des illusions comparables et Bernanos de citer Péguy socialiste dreyfusard s’avouant floué par Jaurès :
« Ce politique qui avait fait semblant d’être professeur… semblant d’être un intellectuel… semblant d’être des nôtres… Dieu sait si nous étions des âmes simples, des pauvres gens, des petites gens… »
Il dresse un réquisitoire accablant contre Maurras, contre le terrorisme intellectuel que lui et ses suppôts ont exercé durant plusieurs décennies sur la droite française, Maurras dont le prestige reste assez grand en juin 1938 pour finir au musée avec un bicorne (son admission à l’Académie française par 20 voix contre 11).
N’est-il pas énorme d’entendre M. Maurras parler au nom de la tradition française alors qu’il reste volontairement étranger à la part la plus précieuse de notre héritage national : la chrétienté française… Il était d’autant plus farouchement intégriste qu’il n’avait pas la foi…
Sa force est de haïr la pensée d’autrui d’une haine vigilante, charnelle, qui a la puissance et le mouvement de l’amour. C’est par là qu’il féconde des milliers d’imbéciles [A1] qui ne l’ont pas lu ou l’ont lu sans le comprendre…
Les petits mufles de la nouvelle génération réaliste (Maurras, Doriot, Laval… Carbuccia, etc.) auront beau m’éclater de rire au nez, je ne leur en veux pas, comme dirait Péguy, de jouer le temporel mais ils jouent le temporel et le spirituel à la fois, c’est ce qui me dégoûte. Jouer le temporel avec les puissants de ce monde et en même temps faire appel à la mystique et à l’argent des pauvres, non !
Ils méprisent la mystique mais s’en servent sans vergogne. Vous avez soif d’idéal, nous vous fournirons d’idéal : aux « poilus » de gauche, la mystique pacifiste, aux poilus de droite la mystique nationaliste, chacun la sienne et rentrez tranquillement chez vous, lorsque la France sera réveillée, elle vous enverra le percepteur…
Bernanos « monarchiste »
Ouvrons ici une longue parenthèse. On sait que Bernanos n’a jamais varié dans ses convictions monarchistes dont il s’est expliqué à maintes reprises. Retenons en la composante essentielle, son côté « populiste », inséparable de l’idée mystique qu’il se fait de la France et de sa vocation dans le monde.
Que le chrétien Bernanos garde au fond de l’âme la nostalgie d’une France pétrie dans la foi chrétienne, celle des siècles de saint Bernard et de saint Louis (magistralement décrits par Régine Pernoud, cette grande historienne disparue cette année), nul ne songerait à s’en étonner comme à le lui reprocher d’autant qu’il n’en est pas plus dupe que des rêves ensevelis de sa jeunesse, mais à ses yeux, la France reste une personne temporelle et spirituelle ayant vécu dans sa jeunesse une expérience privilégiée à travers sa monarchie, comme l’enfance de tout homme est ouverte à l’influence du surnaturel. Il n’en est pas moins puéril d’ajouter foi au phantasme d’une « monarchie de droit divin », concept complaisamment « inventé par des théologiens courtisans ».
Nos pères n’en demandaient pas tant, ils avaient fait avec leurs rois une sorte de pacte qui pourrait s’énoncer ainsi : Nous voulons une France grande puissante et riche afin d’y vivre honorablement, mais nous savons aussi que la conquête et la défense de tant de biens sont difficiles et dangereuses…
Vous êtes des princes chrétiens, vous répondez de nous sur votre salut, arrangez-vous pour faire votre politique… sans manquer à la loi de Dieu… N’étant pas plus que nous à l’abri des tentations et des fautes, nous exigeons seulement que vous péchiez en chrétiens baptisés, non en païens, que vous soyez des hommes comme nous et non la Raison d’État, cette déesse à laquelle nous n’avons pas donné notre foi…
L’homme de l’Ancien Régime avait la conscience catholique, le cœur et le cerveau monarchistes, le tempérament républicain. C’est un type humain beaucoup trop riche, hors de la portée des intellectuels bourgeois…
Ainsi l’ancienne monarchie française avait fait un peuple ayant gardé l’esprit de jeunesse, rêvant de liberté et de justice universelle, capable après mille ans d’existence de s’enflammer pour cette cité harmonieuse dont parle Charles Péguy. Bernanos et ce dernier éprouvent en effet la même fascination pour les hommes de 1789 haïs par les conservateurs nationaux parce qu’ils les sentent plus jeunes qu’eux, tellement plus jeunes…
Et Bernanos de donner comme exemple de l’esprit de jeunesse et de la volonté de réforme secouant l’ancienne société française, la nuit du 4 août 1789 [A2] que les imbéciles nationaux ridiculisent à l’envi parce que l’abandon volontaire des privilèges est bien la seule forme de folie dont ils soient incapables… Et c’est vrai que la vieille France monarchiste s’est comme abîmée dans le plus prodigieux élan de réforme qu’on ait jamais vu dans l’histoire.
Relisant Notre jeunesse Bernanos y décèle un mystérieux parallélisme entre deux événements apparemment bien distincts et distants : l’affaire Dreyfus et l’affaire de Munich, cette farce macabre, cette sorte de fausse couche de la France violée pendant son sommeil. Il rappelle sur la première le jugement de Péguy :
Il faut le dire avec solennité, l’affaire Dreyfus fut une affaire élue, elle fut une crise éminente dans trois histoires elles-mêmes éminentes… l’histoire d’Israël… l’histoire de France… elle fut surtout une crise éminente dans l’histoire de la chrétienté.
Bernanos perçoit que la capitulation de Munich, venant après les guerres d’Abyssinie et d’Espagne, qui leur fait écho, est aussi une affaire élue, ouvre sur une crise majeure, une tragédie pour la France, le monde, la chrétienté et… Israël (cela Bernanos le discerne encore mal, même si l’ex-disciple de Drumont va se faire désormais solidaire du peuple juif, rejoignant Péguy, dénonçant l’antisémitisme comme blasphématoire, comme un refus du mystère de l’Incarnation. Le patriotisme de Bernanos va prendre ici sa forme définitive opposée au chauvinisme, celui de l’homme portant sur sa patrie le regard du propriétaire sur son domaine jaugé à son étendue et sa richesse.
Vocation historique de la France
La France, nous dit Bernanos, a une vocation historique, déjà inscrite dans sa haute tradition chrétienne, celle de promouvoir l’esprit de liberté et de justice entre les peuples, le respect et la défense du faible contre l’oppresseur. Le Monde attend autre chose d’elle que de perdre son âme à vouloir bien en vain rivaliser avec les puissants, plus experts qu’elle dans l’art du mensonge et l’hypocrisie politique.
Revenant en arrière, il récapitule les abdications en chaîne de la France, cernée de tous côtés par la menace totalitaire sous différentes manifestations idéologiques (le nazisme, « la race » ; le fascisme, « la nation » ; le franquisme, « le clan »). Ayant perdu confiance en son destin, notre pays s’était cru avisé de jouer la carte du (soi-disant) réalisme politique consistant notamment à faire le jeu de la politique impériale de l’Italie, avec la passivité complice d’une opinion manipulée par une presse fascisante aux mains de faux maîtres à penser, politique de Gribouille dont Bernanos dénonce les contradictions et inconséquences :
On maudit l’idole totalitaire à Berlin, on la tolère à Rome, on l’exalte à Burgos.
Est-ce qu’on nous prend pour des imbéciles ? Hitler justifie en Allemagne l’esprit de guerre, mais Mussolini pratique la même littérature aux applaudissements du clergé fasciste.
Et Bernanos de rappeler l’abjecte guerre d’Abyssinie (rendue possible par l’abandon en 1935 de la Somalie par Laval), la consécration solennelle du nouvel empire (Victor-Emmanuel III, empereur d’Abyssinie !) à Notre-Dame de l’Ypérite (allusion à l’emploi de gaz de combat), c’est aussi la première fois qu’une nation catholique patrie du Souverain Pontife se vante cyniquement de tenir le Droit international pour hypocrite. (Les sanctions décrétées par la SDN, auxquelles se rallie la France en traînant les pieds, gênent alors l’Italie.)
Si nul historien sérieux ne conteste aujourd’hui cette analyse, il n’en fut pas de même sur le moment où on crut de bon ton (même chez ceux qui n’étaient pas loin de partager les idées de Bernanos), de dénoncer l’inopportunité et la violence de ses critiques, belle illustration de ce banal constat : il n’y a que la vérité qui gêne. En réalité le grand scandale aux yeux du chrétien Bernanos est avant tout l’abdication de la chrétienté se taisant non seulement en Espagne mais aussi en Italie où les « Monsignori réalistes » pèsent abusivement sur la politique vaticane.
Même s’il s’est toujours défendu avec force de jouer au prophète, se jugeant un homme très ordinaire dépourvu d’un hypothétique sixième sens, Bernanos ne s’en comporte pas moins, à sa manière véhémente, comme un prophète de l’Ancien Testament pour qui l’apanage d’Israël était moins la Terre promise que son élection au plan divin, son risque majeur étant bien moins la servitude que l’apostasie.
III – Bernanos et l’Histoire
Bernanos : la foi qui fait l’histoire.
(Monseigneur J.-M. Lustiger)
L’expertise par Hélène Sadoul de l’écriture de G. Bernanos “ Inclinée, liée, mesurée, douce, … de sa signature claire, simple, anguleuse, étonnament semblable à elle-même … ” confirme en tous points son exceptionnelle personnalité.
Le moment est venu de mieux saisir le rôle et la portée du dialogue de Bernanos avec l’histoire.
Quand il nous y entraîne et Dieu sait avec quelle passion (On ne sait pas l’histoire, voilà le malheur !) c’est pour chercher à expliquer le présent, lui découvrir un sens.
Nous avons tort de mettre le passé derrière nous, il nous cède le pas un moment par politesse mais comme le loup du petit Chaperon rouge, il prend par le chemin le plus court que nous ne connaissons pas et il va nous attendre dans l’Éternel… J’aime le passé, précisément pour ne pas être un passéiste, je défie qu’on trouve dans mes livres aucune de ces écœurantes mièvreries sentimentales dont sont prodigues les dévots du « bon vieux temps »…
À sa manière, cette vision toute dynamique s’inscrit dans la tradition historique de quête de sens du siècle dernier (Michelet…, Tocqueville) mais elle se veut résolument centrée sur la face interne de l’histoire, prenant comme fils conducteur des événements, les consciences, les mentalités, « l’imaginaire collectif ». Démarche marginale plus intuitive que démonstrative. Elle se veut le regard d’une conscience chrétienne de part en part, et de pied en cap, réagissant à l’événement, n’hésitant pas à y porter la lumière de Dieu, non avec l’insupportable et illusoire prétention de posséder la vérité mais entendant, ce qui est tout autre chose, lui appartenir, plus exactement la servir, la chercher avec passion. Une telle attitude n’est recevable qu’assortie d’une foi simple, vécue au quotidien, d’un esprit d’humilité proscrivant l’orgueil.
Le grand malheur de ce monde, la grande pitié de ce monde ce n’est pas qu’il y ait des impies mais que nous soyons des chrétiens si médiocres, car je crains de plus en plus que ce ne soit nous qui perdions le monde, que ce soit nous qui attirions sur lui la foudre.
Quelle folie de prétendre nous justifier en nous vantant orgueilleusement de posséder la vérité, la vérité plénière et vivante, celle qui délivre et qui sauve puisqu’elle reste impuissante entre nos mains, que nous demeurions misérablement sur la défensive derrière une espèce de ligne Maginot hérissée de prohibitions, d’interdictions comme si nous n’avions rien de mieux à faire que de garder la loi alors que notre vocation naturelle et surnaturelle est de l’accomplir. En défendant l’homme du passé, c’est notre tradition révolutionnaire que je défends.
Bernanos s’appuie sur deux convictions fondamentales :
- d’un côté la fragilité face au mal de la créature déchue qu’est l’homme, fût-elle à l’image et ressemblance de Dieu,
- de l’autre, la toute puissance de la vérité engageant l’homme libre, son dépositaire, à témoigner pour elle :
Ce que tant d’imbéciles tiennent pour des nuées creuses : la justice, l’honneur, la foi, je les tiens pour des vivants, plus vivants qu’eux.
Ainsi, fidèle à la ligne suivie dans toute son œuvre romanesque, Bernanos s’aventure en histoire sur les chemins du péché et de la grâce, vers le fond obscur des consciences, dans la perspective du salut de hommes au double plan naturel et spirituel.
Dans le même esprit que celui de Dostoïevski, Bernanos n’est ni apologiste, ni moraliste [A3], il nous invite simplement à ôter nos masques, nous interroger sur la part de vérité que nous croyons détenir et le rapport que nous entretenons avec elle.
« La révolution » selon Bernanos
Bernanos va s’en expliquer longuement (notamment dans La France contre les robots). L’histoire, nous dit-il, a complètement altéré dans le langage et dans les esprits le sens du mot révolution. On peut y voir à la fois un signe et un facteur de démobilisation des élites.
De ce fait que les révolutions mettent périodiquement en péril l’ordre social, les imbéciles en ont conclu que l’esprit révolutionnaire était avant tout destructeur.
De cet autre fait que l’ordre social a toujours été sous le contrôle des élites et que l’idée révolutionnaire fut toujours exploitée, en apparence du moins, au profit des masses contre l’élite… les élites en ont fatalement conclu qu’elles favorisaient la collectivité contre l’individu alors que l’ordre cachait en lui cette tare mortelle de l’étatisme païen.
En conséquence, Bernanos appelle de ses vœux une révolution qui rappellerait dans son contexte celle de 1789 où les élites sont à l’avant-garde d’un mouvement d’aspiration à la liberté, témoignant de leur foi en l’homme alors que par la suite et cent cinquante ans plus tard elles sont à l’arrière, à la traîne, trouvant la chose parfaitement naturelle. C’est au peuple qu’elles prétendent laisser le risque de la recherche. Des classes dirigeantes qui refusent de bouger d’un pouce que pourrait-on imaginer de plus absurde, comment diriger sans guides, les classes dirigeantes refusent de bouger mais le monde bouge sans elles.
Cette « révolution manquée de 1789 », Bernanos n’aura cesse d’y revenir depuis qu’en juillet 1942 dans un article intitulé « La révolution nécessaire », il avait fait l’apologie du « mouvement de 89 ».
… L’extraordinaire sociabilité des hommes de ce siècle pourtant si peu dévot, si libertin, semble comme un dernier reflet de l’antique fraternité des chrétiens, leur indulgence est merveilleuse…
… Les hommes de 89 croyaient sincèrement la France parvenue à un si haut degré de culture qu’il ne dépendait plus que de sa volonté, de son génie, d’affranchir le genre humain non seulement des tyrannies mais, en un délai plus ou moins court, des disciplines sociales elles-mêmes, le citoyen n’agissant plus que selon la Raison, sans aucune nécessité de contrainte. On peut sourire aujourd’hui de ces illusions mais elles sont évidemment celles d’un peuple débordant de confiance en lui-même. J’ajoute qu’elles ne semblent pas avoir paru ridicules ou très présomptueuses aux contemporains. En Allemagne, en Autriche, en Russie, les esprits éclairés ne sont pas loin de croire en cet âge d’or. Du moins jugent-ils le peuple français plus capable qu’un autre, de démontrer dans un avenir prochain qu’une nation réellement civilisée peut se passer de tribunaux et de gendarmes…
La France qu’on aime c’est toujours la France de 1789 la France des idées nouvelles. Auprès de cette France-là comme celle du XIXe siècle paraît triste… elle a l’air de porter le deuil d’une révolution manquée… Le vêtement est triste et laid, l’architecture est laide et triste. L’homme du XIXe siècle a bâti des maisons qui lui ressemblent et il a logé le Bon Dieu aussi mal que lui.
Oh je sais bien, il y a la peinture, la poésie, la musique, le génie de la France n’a pas subi d’éclipses, c’est ce qui fait la valeur et l’intérêt des signes que je viens de donner.
IV – La liberté selon Bernanos
Je crains pour la liberté une crise terrible qui mettra
en péril de mort la chrétienté universelle.
(Rio, 1945)
S’il est dans toute l’œuvre de Bernanos un thème central fédérateur de tous les autres, un thème magistralement transposé de ses romans dans ses Écrits de combat, c’est bien celui de la liberté humaine consubstantielle à l’homme, chair de sa chair (Le Chemin de la Croix-des-âmes).
Bernanos a exalté la liberté de l’homme comme peu d’écrivains laïcs l’ont fait avant lui (pensons surtout à Dostoïevski). L’idée dynamique qu’il s’en fait parcourt toute son œuvre, jusqu’à jaillir en stances pathétiques comme dans ce beau passage de la Lettre aux Anglais qu’il serait incidemment dommage de ne pas rappeler :
Hommes libres qui mourez en ce moment et dont nous ne savons pas même les noms. Hommes libres qui mourez seuls à l’aube entre des murs nus et livides, hommes livides qui mourez sans amis et sans prêtre, vos pauvres yeux encore pleins de la douce maison familière, hommes libres qui aux derniers pas que vous faites entre la prison et la fosse, sentez refroidir sur vos épaules la sueur d’une nuit d’agonie, hommes libres qui mourez le défi à la bouche et vous aussi qui mourez en pleurant – vous, oh vous qui vous demandez amèrement si vous ne mourez pas en vain – le soupir qui s’échappe de vos poitrines crevées par les balles n’est entendu de personne mais ce faible souffle est celui de l’Esprit.
Aux yeux de l’écrivain, la liberté de l’homme est le mystère central, le plus angoissant, aucun ne l’interpelle davantage.
Le scandale de l’univers n’est pas la souffrance c’est la liberté. Dieu a fait libre sa création. Voilà le scandale des scandales car tous les autres scandales procèdent de lui. Oh je sais bien nous paraissons être ici en pleine métaphysique, que voulez-vous que j’y fasse ?…
Il faut lire intégralement le texte de cette conférence (publiée dans Les destinées) prononcée par l’écrivain le 4 avril 1947 dans la salle archicomble du lycée Carnot à Tunis, au profit des petites sœurs de Charles de Foucauld.
Ce jour-là, Bernanos, dans un langage simple, avec des images familières, expliquait à un auditoire, bouleversé par l’émotion, quelle signification revêtait ce mystère dans une vie humaine interpellant à son insu le cœur de l’homme, davantage que sa raison mais sans y contrevenir (cela est d’un autre ordre aurait dit Pascal).
Revenons six ans en arrière à un article publié en 1941 au Brésil intitulé « Aux hommes d’Europe », on peut y lire :
… La liberté est une force intérieure, une puissance de l’âme
Un peuple libre est celui qui compte sur une certaine proportion d’hommes fiers et si la proportion n’est pas atteinte à quoi bon le faire proclamer libre par les avocats.
Je ne me lasserai pas de répéter qu’il y a des hommes qui se vantent d’aimer la liberté parce qu’ils en jouissent. Loin de vouloir lui sacrifier quoi que ce soit, ils entendent bien qu’elle leur épargne tout sacrifice, qu’elle leur permette de s’engraisser en paix… S’il est vrai (se disent-ils) qu’un certain désintéressement ou même héroïsme est indispensable à toute démocratie fût-elle réaliste, je paierai pour qu’on soit héroïque ou désintéressé à ma place…
Hommes d’Europe ! Apprenez maintenant au monde qu’il n’est de véritable salut qu’en soi-même, que les systèmes politiques et sociaux que nous présentent les avocats ne sauraient suppléer indéfiniment à la défaillance des esprits et des cœurs, et que la loi ne protège efficacement qu’à condition d’être protégée elle-même contre les corrupteurs, par des hommes fiers en qui vit la tradition des lois non écrites de la Justice selon l’Esprit.
La liberté bernanosienne se situe donc au-delà de ses manifestations extérieures, telles que les libertés civiques à la base de toute démocratie, au-delà du premier stade de la liberté intérieure communément appelée le libre arbitre (dans le vocabulaire des philosophes : liberté « d’indifférence » ou « d’indétermination »). En définitive la liberté bernanosienne est l’autodétermination ou capacité de l’homme à se déterminer, à être fidèle à soi-même, sans esprit de résignation à une soi-disant fatalité. Nous ne sommes pas en effet déterminés, mais seulement conditionnés par des libres choix qui, en engageant notre responsabilité, ne font que déplacer les frontières de notre liberté par rapport à autrui.
Que cela plaise ou non, on ne saurait oublier la dette filiale de notre civilisation occidentale envers le judéo-christianisme, son dynamisme émancipateur et fondateur sur les ruines du monde antique. À la fois révélation (ou supposée telle) sur l’homme et révolution libératrice sans cesse menacée par l’implacable loi d’airain du rapport des forces mais aussi par les forces plus obscures au travail dans le cœur humain. En d’autres termes dans ce combat sans cesse à recommencer, la vigilance de l’homme à préserver sa liberté est double, devant s’exercer envers autrui et envers lui-même.
On ne saurait sous-estimer, nous dit implicitement Bernanos, le rôle civilisateur de la liberté intérieure de l’homme engagé dans une aventure personnelle ou collective, même si elle peut paraître mal armée face au colossal déploiement des convoitises de ses prédateurs.
Le principal obstacle se trouve dans l’homme lui-même, en effet pour beaucoup le sacrifice de la liberté est louable ou plutôt ce n’est pas un sacrifice pour eux, c’est une habitude qui simplifie la vie, et elle la simplifie terriblement en effet… Les tueurs se recrutent parmi les hommes terriblement simplifiés…
Qu’est-ce que donc que la « liberté intérieure » ?
La liberté intérieure appelle à prendre parti pour le vrai et le faux, le mal ou le bien. Jadis l’homme chrétien engageait du même coup son âme, la croyance métaphysique était pour lui une source inépuisable d’énergie.
À cet égard et à maintes reprises Bernanos invite à ne pas confondre la haute tradition libérale chrétienne restée purement spirituelle, à la politique d’Église qui s’est historiquement inspirée d’une tradition rivale plus ancienne même : la tradition romaine de la raison d’État celle de l’empire des Césars, dont elle était en quelque sorte l’héritière légitime, une colossale liquidation qu’elle n’avait pas réussi à mener jusqu’à son terme.
Or cette attitude chrétienne de la vie risquée pour un enjeu qui la transcende a plus particulièrement marqué en profondeur la mentalité française à travers les vicissitudes de l’histoire, survivant aux effets de la déchristianisation. Bernanos n’a cessé de revenir sur cette singularité, non seulement dans ses écrits brésiliens (Nous autres Français, La France contre les robots) mais au cours des cycles de conférences prononcées à son retour, où il s’attache à convaincre ses auditoires de la permanence d’une vocation propre à la France, dans le monde.
C’est ainsi que traitant du thème « L’esprit européen » aux rencontres internationales de Genève le 12 septembre 1946 il insiste sur l’impératif de faire un monde pour les hommes libres, évoquant particulièrement :
Cette liberté intérieure qui était notre privilège héréditaire et où nos ennemis voyaient non sans raison une incorrigible liberté, puisque c’est vrai qu’elle nous faisait légers même dans l’erreur, le péché, l’injustice, car nous étions plus légers qu’eux.
Écoutons Bernanos s’interroger sur le principal drame de l’homme moderne :
Il est de ne plus s’engager parce qu’il n’a plus rien à engager. Quel est en effet le symptôme le plus général de cette anémie spirituelle ? Je répondrai : l’indifférence à la vérité et au mensonge. Aujourd’hui la propagande prouve ce qu’elle veut et on accepte plus ou moins passivement ce qu’elle propose. Oh, sans doute cette indifférence masque plutôt une fatigue et comme un écœurement de la faculté de jugement mais la faculté de jugement ne saurait s’exercer sans un certain engagement intérieur. Qui juge s’engage.
Ces derniers mots (c’est nous qui soulignons) nous livrent l’un des messages essentiels de Bernanos déjà développés à plusieurs reprises dans ses romans, notamment Le Journal d’un curé de campagne :
S’engager tout entier… la plupart n’engagent dans la vie qu’une faible part, une part ridiculement faible de leur être… La damnation ne serait-elle pas de se découvrir trop tard, beaucoup trop tard après la mort, une âme absolument inutilisée, encore soigneusement pliée en quatre et gâtée comme certaines soies précieuses, faute d’usage ? Quiconque se sert de son âme, si maladroitement qu’on le suppose, participe aussitôt à la vie universelle, s’accorde à son rythme immense, entre de plain-pied dans cette communion des saints qui est celle de tous les hommes de bonne volonté auxquels fut promise la paix. (C’est nous qui soulignons.)
Au-delà de ses résonances évangéliques, ce texte (la parabole de Lazare et du mauvais riche) interpelle quiconque s’interroge sur le sens de sa liberté comme de sa charité.
Il y a dans notre pays et ailleurs beaucoup « d’hommes de bonne volonté », indépendamment de leurs convictions religieuses, politiques et autres.
C’est en définitive à eux tous, véritable « sel de la terre », qu’entend s’adresser Bernanos et plus spécialement à ses compatriotes.
Prochain article : « Modernité et liberté » (Partie IV, mai 1999)
_______________________________________________
[A1] « Les imbéciles »
Sous la plume de Bernanos, ce générique peu flatteur, utilisé à tout propos, revêt un sens très général, il englobe non seulement les myopes sur les événements, se dispensant du seul effort dont ils sont réellement incapables, celui de penser par eux-mêmes mais aussi les égoïstes intelligents… parfaitement capables de mesurer la portée des événements mais préférant s’arrêter à mi-chemin et faire demi-tour. En un mot sont « imbéciles » à la fois ceux dont la lumière manque aux yeux et ceux dont les yeux se dérobent à la lumière, ce qui fait en définitive beaucoup de monde, nous tous ou presque ainsi que le suggère Bernanos dans quelques-unes de ses brèves formules que l’on pourrait croire empruntées à La Rochefoucauld :
L’optimisme est une forme sournoise de l’égoïsme, une manière de se désolidariser du malheur d’autrui, sa vraie formule serait plutôt « après moi le déluge ».
Les optimistes sont des imbéciles heureux.
Les pessimistes sont des imbéciles malheureux.
Se connaître est la démangeaison des imbéciles, il faut être ce que l’on est simplement, sous le regard de Dieu sans savoir ce que l’on est.
[A2] L’historien, toujours en quête des réalités humaines au-delà des apparences, aurait beau jeu de démasquer des arrière-pensées derrière ce bel enthousiasme. D’un côté la peur contagieuse des désordres en cours (dans le Dauphiné et ailleurs, on pillait les châteaux) valait bien un signe fort d’apaisement, de l’autre nombreux étaient ceux (même dans le Tiers État alors détenteur de la majorité des privilèges attachés aux vieux droits féodaux) qui espéraient en être indemnisés. Le réveil fut brutal quand les jours suivants on se mit en peine de mettre au point les modalités pratiques.
Consciente du danger d’enlisement, l’assemblée était résolue à aboutir rapidement : une semaine plus tard, elle abolissait purement et simplement le régime féodal et il ne lui fallut ensuite que deux semaines pour mettre au point à partir d’un projet de l’archevêque de Bordeaux, un texte fameux, admirable de clarté et de concision dans ses 17 articles, véritable charte des temps modernes, la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, mais il est vrai qu’entre-temps elle avait escamoté le volet combien plus épineux des « devoirs du citoyen ».
[A3] Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici que fondamentalement le christianisme ne se résume pas en une morale, une loi, une esthétique voire même une sagesse, mais consiste d’abord en la remise de soi à une personne pour agir dans sa vie avec elle.