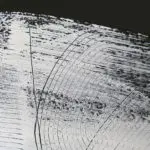Torrents de printemps
C’est dimanche. Sur votre terrasse, une brise de printemps déjà tiède ploie doucement les têtes fleuries des papyrus et caresse les jeunes pousses vertes des romarins. Demain lundi commence une semaine de travail dense et ses négociations difficiles dont le stress prétendument redouté vous excite déjà en réalité. Mais cette perspective vous apparaît comme lointaine et presque dérisoire, devant le plaisir attendu de quelques musiques dont la plupart vous étaient encore inconnues il y a peu, et que recèlent en leurs flancs minces les quelques disques qui jonchent votre table.
Zemlinsky et Prokofiev – Deux opéras
On peut se faire une idée de l’extraordinaire bouillonnement intellectuel à Vienne au début du XXe siècle en lisant Stefan Zweig (Le Monde d’hier) ou Elias Canetti (La langue retrouvée). La Vienne multiculturelle où se côtoient Klimt, Mahler, Freud, Schnitzler est le paradigme d’une Europe idéale qui disparaîtra bientôt à jamais, emportée par l’apocalypse de la Première Guerre mondiale.
Les chefs‑d’œuvre y foisonnent et sont remisés parfois dans un tiroir au profit de l’œuvre suivante avant même d’avoir été créés. Ainsi de l’opéra Der Traumgörge (Görge le Rêveur), qui devra attendre 1980 pour être créé (à Nuremberg), que compose en 1903–1907 Alexander von Zemlinsky, et que viennent d’enregistrer, dirigés par James Conlon, le Gürzenich-Orchester Kölner Philharmoniker et une pléiade de solistes parmi lesquels David Kuebler, Patricia Racette, Susan Anthony, Iride Martinez, Andreas Schmidt1.
Œuvre tonale subtile aux harmonies complexes et à l’orchestration raffinée, sans airs, onirique, dont la musique a pour ambition de “ coller ” aux émotions des personnages, eux-mêmes à la psychologie tourmentée : on pense, bien sûr, à Pelléas, composé dix ans auparavant ; mais Görge est moins austère, plus séduisant, avec des lignes mélodiques proches de la musique de Mahler plus que de celle de Strauss. C’est très beau, aussi raffiné et plus intelligent que Strauss. Conlon dirige avec beaucoup de clarté. À découvrir absolument.
Composé à la veille de la révolution d’octobre, Le Joueur de Prokofiev, d’après le roman de Dostoïevski, n’était pas dans la ligne du parti et ne fut créé en Union soviétique qu’en 1963. Alors que l’opéra de Zemlinsky est tout de mesure et d’équilibre, Le Joueur est une œuvre enfiévrée et excessive, avec pas moins de 31 solistes et un orchestre considérable – Dostoïevski n’en méritait pas moins. La musique est très proche du texte, expressionniste, et évoque irrésistiblement Wozzeck d’Alban Berg. L’enregistrement récent par les solistes, le chœur et l’orchestre du Kirov (aujourd’hui le Marinsky) dirigés par Valery Guergiev est superbe2.
Ceux qui ont eu la chance de voir Guergiev diriger au Marinsky, à Saint-Pétersbourg, ont découvert une sorte de Bernstein russe, extraverti, qui maîtrise avec passion un orchestre de premier plan, sans doute le meilleur de Russie aujourd’hui, avec des cuivres fabuleux. Si vous aimez Wozzeck et Lulu, courez écouter Le Joueur : vous découvrirez une musique beaucoup plus subtile et originale que celle des ballets que vous connaissez, Roméo et Juliette, l’Amour des trois oranges, ou encore, pour les aficionados d’Eisenstein, Alexandre Nevski.
Mahler, Chostakovitch, Schoenberg –
Trois symphonies, presque quatre
La 2e symphonie de Mahler – Résurrection – est un de ces monuments de la musique que tout mélomane connaît bien aujourd’hui, alors qu’elle était encore peu jouée, et redoutée, il y a trente ans. Peut-être la plus ambitieuse des symphonies de Mahler par ses connotations métaphysiques – Mahler y aborde explicitement le grand problème de la Vie et de la Mort avec l’emphase qui le caractérise – elle est grandiose aussi par son orchestration (un effectif considérable, dont 10 cors, 8 trompettes, 4 trombones, 2 harpes, un orgue).
Malgré ces excès, ou peutêtre grâce à eux, c’est une œuvre magnifique, du même niveau que la 9e de Beethoven, à laquelle on peut secrètement la préférer. L’interprétation qu’en donne Seiji Ozawa à la tête de l’Orchestre Saito Kinen de Tokyo, avec Nathalie Stutzmann, est très classique, et même beethovénienne, aux antipodes des envolées de Bernstein3. Pour ceux qui aiment la mesure et l’équilibre, même dans Mahler.
Les symphonies 2 (Octobre) et 3 (Le 1er Mai) sont parmi les moins connues de Chostakovitch, et il est bon que Neeme Järvi les ressuscite, à la tête de l’Orchestre et du Chœur Symphoniques de Göteborg4. Commandes très officielles du gouvernement, elles furent par la suite désavouées par Chostakovitch. On voit mal pourquoi : la musique est du meilleur Chostakovitch, avec le mélange habituel de grandiose et de burlesque, avec des thèmes qui prennent à la gorge, une orchestration d’une extrême richesse, une architecture irréprochable.
Alors ? Reste l’argument, de toute évidence propagandiste. On veut voir aujourd’hui dans Chostakovitch un créateur qui souffrait en silence de devoir se plier aux contraintes inacceptables de la culture d’État, et qui aurait adopté par réaction le mode parfois burlesque, voire sarcastique, pour brocarder les autorités. Certes. Mais la réalité est sans doute plus simple : dans le système, il n’y avait guère le choix qu’entre plier, s’enfuir si l’on le pouvait, ou risquer le Goulag. Comme l’immense majorité des artistes demeurés en France sous Vichy, à moins d’être un héros, il fallait bien… composer. En réalité, sans les contraintes du régime, Chostakovitch n’aurait peut-être pas écrit une musique aussi forte : la liberté absolue ne vaut rien aux créateurs.
Schoenberg est un de ceux, nombreux, qui se sont laissé séduire par le poème de Maeterlinck Pelléas et Mélisande. Le symbolisme et la psychanalyse naissante faisaient bon ménage. Encore inconnu, Schoenberg écrit non un opéra ou une musique de scène mais une symphonie en quatre mouvements, la dernière de ses œuvres tonales, qu’il dénomme modestement Pelléas et Mélisande, poème symphonique. Une musique intense, très fouillée, une des œuvres les plus fortes – et les plus belles – de la musique du début du siècle, que dirige remarquablement Christian Thielemann à la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Berlin5. Sur le même disque, Siegfried-Idyll, l’œuvre exquise, aérienne, de Wagner, à des années-lumière des outrances du Ring.
Henze, Schubert
Les Six Chants de l’Arabe sont une œuvre toute récente (1999) de Werner Henze, écrite précisément pour Ian Bostridge, l’extraordinaire ténor anglais, qui l’interprète sur un récent disque d’EMI6. Henze a écrit lui-même les textes. Il en résulte une œuvre étrange, très difficile, mais qui mérite l’effort d’écoute. Henze, compositeur atypique, a goûté de tout, de la musique sérielle au néoclassicisme. Ici, chaque mesure est supposée être la traduction de ce qu’expriment les mots du texte qui la sous-tendent (alors que, dans un lied classique, la musique dans son ensemble crée une atmosphère cohérente avec celle du texte). Sur le même disque, une autre œuvre de Henze, Trois Mélodies d’après Auden. Bostridge est accompagné par Julius Drake.
Et pour terminer, l’ineffable : quatre Sonates de Schubert par Alfred Brendel7. Il s’agit des Sonates en sol majeur, si majeur, la majeur, si bémol majeur. Nul aujourd’hui ne sait, comme Brendel, jouer Schubert à la fois avec ce détachement serein, mélancolique mais non désespéré, qui parle si bien de la vie qui s’écoule, du temps qui passe, sans dimension métaphysique, sans sentimentalisme ni mièvrerie non plus.
Aucun des Romantiques ne nous place aussi bien face à notre “ petit tas de secrets ”, selon le mot de Malraux – ni Chopin, encore moins Beethoven, ni même Brahms ou Schumann – avec une telle simplicité, une telle absence de recherche formelle, et nous procure en même temps un tel plaisir d’écoute. Il n’y a plus que nous, nous et la petite musique de l’âme, et Brendel est, entre les deux, le modeste et merveilleux intercesseur.
________________________
1. 2 CD EMI 5 57087 2
2. 2 CD PHILIPS 28945 45592
3. 2 CD SONY CB 802
4. 2 CD DGG 469 525–2
5. 1 CD DGG 469 008–2
6. 1 CD EMI 5 57112 2.