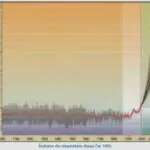Conclusions : quels défis pour l’ingénieur ?

Le président du groupe X‑Environnement, Jean-Marc Jancovici, m’a demandé de rédiger l’article conclusif de ce numéro de La Jaune et la Rouge consacré au thème « Croissance et Environnement ».
J’ai eu l’imprudence d’accepter d’évoquer les défis qui posent et poseront à l’ingénieur en général, et à ceux qui sont polytechniciens en particulier, les grands enjeux du XXIe siècle, tels qu’ils sont décrits avec beaucoup d’intelligence prospective dans les articles qui composent ce numéro : démographie, changements climatiques, raréfaction de certaines ressources naturelles, convergence des niveaux de développement, mondialisation et, dans ce contexte, pour notre pays, rythme et qualité de la croissance, répartition de ses fruits, protection de l’environnement, leviers de l’action publique, compétitivité des entreprises, vieillissement de la population, etc. Suis-je complètement qualifié pour aborder cet exercice. Probablement pas vraiment. J’ai sans doute quelque expérience de la gestion de l’environnement pour avoir, dans le ministère compétent, exercé la responsabilité de la direction de l’eau et de la prévention des pollutions pendant onze ans. De même, j’ai travaillé quinze ans dans une grande entreprise, Lyonnaise des Eaux, puis, après la fusion, Suez, où j’ai pu concourir, à ma place, à une croissance sans précédent.
Pourtant, j’ai conscience d’avoir beaucoup agi et insuffisamment réfléchi. Réfléchir avant d’agir comme le recommande Saint Luc : « Qui de vous, en effet, s’il veut bâtir une tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ». Il faut penser à s’asseoir. Il faut penser aux ressources. Il faut penser au terme, au long terme.
J’ai la chance, maintenant que le temps de l’action profitable est passé pour moi, d’être associé à divers travaux (Centre d’analyse stratégique, Académie des technologies, Haut Conseil de la Coopération internationale, Collège des Hautes Études de l’Environnement et du Développement durable, etc.) de réflexion sur le futur dans une perspective assumée de développement durable.
C’est donc à partir de ces réflexions et à la lumière des articles précédents que je vais essayer de voir comment les ingénieurs peuvent se préparer à affronter avec succès, pour la société et pour eux-mêmes, ces défis du XXIe siècle.
Et d’abord avons-nous une vue claire et pertinente de ce nouveau siècle, pour autant que cela ait un sens de découper notre histoire par tranche de cent ans ? Qui, au début du XXe siècle, aurait pronostiqué deux guerres mondiales, des progrès technologiques foudroyants culminant dans les techniques de traitement et de communication des informations ? Nous avons pourtant quelques repères solides : la croissance démographique de 6 à 9 milliards d’habitants dans le courant de ce siècle, soit une augmentation de 50 % de la population – là où nous étions deux, nous serons trois ! – la raréfaction de certaines ressources naturelles comme les hydrocarbures, les évolutions climatiques liées à l’émission des gaz à effet de serre d’origine anthropogénique, la dégradation de l’environnement et de la biodiversité, la poursuite de ce que l’on appelle la « globalisation » et de l’émergence de grands blocs politico-économiques, le relatif effacement des nations petites et moyennes, la persistance de la vie locale, notamment urbaine, souvent mégapolitaine, l’accentuation des phénomènes migratoires, etc. En revanche, il y a beaucoup de choses, beaucoup plus, que nous ne savons pas.
Nous ne savons pas si la Chine et l’Inde iront vers des modes d’organisation radicalement différents, si les États-Unis connaîtront un déclin relatif qui affectera leur tentation hégémonique, si l’Afrique réussira à sortir réellement du sous-développement où une partie de ses nations semble enlisée et finira par s’ériger en véritable puissance mondiale, si l’économie de l’hydrogène verra le jour, si les nanotechnologies seront une clé majeure de demain.
En France, même, à une autre échelle de temps et d’importance, nous ne savons pas si l’actuel Président de la République fera deux mandats, si le Parti Socialiste réussira sa refondation, si les OGM finiront par être acceptés, s’il sera possible d’ouvrir de nouveaux sites de centrales électronucléaires. Mais peu importe car il est peu probable que les tendances lourdes rappelées ci-dessus s’inversent, ce qui nous donne l’impression assez exaltante, mais sans doute, en grande partie illusoire, d’être capable de prévoir le futur voire de l’infléchir. Elles auront donc, à coup presque sûr, une influence sur la vie de chacun d’entre nous et en particulier sur l’activité professionnelle de l’ingénieur. Son rôle sera désormais de concourir à la mise en œuvre d’un développement autre, d’une croissance différente, voire, à la limite, d’une décroissance dans les pays les plus avancés, ce qui est sans doute contraire à la nature même de l’ingénieur, qui traditionnellement est plus un créateur et un réalisateur qu’un gestionnaire. Il devra de toute façon agir dans un contexte encore plus international, encore plus compétitif, encore davantage contraint dans le domaine de la protection de l’environnement et de la disponibilité des ressources naturelles.
Selon Wikipédia, la Commission des titres d’ingénieur en France, donne du métier de base de l’ingénieur la définition suivante :
« Il consiste à résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Cette aptitude résulte d’un ensemble de connaissances techniques d’une part, économique, social et humain d’autre part, reposant sur une solide culture scientifique. » Il est intéressant de noter un peu plus loin que « La considération accordée aux ingénieurs varie malgré tout sensiblement selon les pays : elle est ainsi très élevée en France et en Allemagne ; elle est moindre dans les pays anglo-saxons où les ingénieurs ont un profil plus spécialisé. »
Cette mention n’est pas sans intérêt dans un monde globalisé. Le concept d’ingénieur à la française (dont l’ingénieur polytechnicien est peut-être l’archétype) n’est donc pas universel.
Il me semble que, pour faire face aux grands défis du XXIe siècle, l’ingénieur doit acquérir au cours de sa formation et d’une manière appropriée une attitude, une culture et des savoirs.
L’attitude, c’est celle qui s’inspire des principes du développement durable. Il s’agit de voir large et de voir loin. D’être conscient de l’effet papillon et de ses limites dans la théorie du chaos. De se préoccuper des générations futures et pas seulement du court terme.
Cette aptitude peut sans doute s’acquérir par la pratique de divers outils comme le calcul de l’empreinte écologique, l’analyse du cycle de vie, l’identification des parties prenantes et leurs attentes, l’éco-conception. Il n’est pas certain que les classes préparatoires aux écoles d’ingénieurs soient particulièrement appropriées à l’acquisition de ces réflexes. Sans doute les écoles elles-mêmes le sont-elles davantage.
Au-delà, il faudrait aussi parler de l’analyse des risques et de l’éthique, qui sont au cœur du développement durable. Un très ancien doyen de l’Université d’Aberdeen avait pour devise « Confido sed caveo » : j’ai confiance mais je me tiens sur mes gardes. Grande sagesse.
La culture. C’est sans doute la force des ingénieurs, que de recevoir un enseignement à la fois sérieux et large. La Commission des titres parle bien d’un ensemble de connaissances techniques d’une part, économique, social et humain d’autre part, reposant sur une solide culture scientifique. Sans doute faudrait-il ajouter une certaine connaissance des sciences de la vie et de la planète. Et l’on retrouverait ainsi les trois domaines interpénétrés du développement durable, l’économique, le social et l’environnemental.
Face aux défis du XXIe siècle, cette formation large est une force. Au contraire, l’hyperspécialisation du « docteur » est parfois ressentie comme une faiblesse. Ce qui est certain, c’est que l’ingénieur et le docteur ont besoin l’un de l’autre, et qu’ils doivent le comprendre l’un et l’autre.
Finalement, l’ingénieur, certainement par une formation complémentaire à celle de l’X doit posséder un ensemble de savoirs et de techniques dans un domaine spécifique.
Dans ce ou ces domaines, les aspects humains, sociaux, environnementaux et bien sûr économiques ne doivent pas être évacués au profit de la seule technologie. Qu’il s’agisse des process, des produits et des services, les composantes sociales et environnementales prendront de plus en plus d’importance pour déboucher sur ce que l’on appelle les éco-technologies, les clés de la nouvelle économie.
S’il m’est permis de me référer à ma propre expérience, j’ai toujours trouvé que ma formation avait pêché par trois insuffisances notoires :
• apprentissage d’une seule langue, l’allemand, alors que la maîtrise réelle de trois langues, la sienne et deux autres dont l’anglais est reconnue aujourd’hui comme indispensable ;
• absence de contact avec les milieux de la recherche, mauvaise compréhension de ses apports, de ses ressorts, alors qu’elle joue un rôle fondamental dans tous les domaines et particulièrement dans l’approche des problèmes environnementaux et sociaux. C’était la conséquence malheureuse de la dualité bien française des filières université et grandes écoles ;
• faiblesse de l’enseignement en économie. Il faut à la fois le renforcer et sortir d’un enseignement trop dogmatique. Ne pas imposer le libre-échangisme ou la nécessité de la croissance comme des vérités révélées. Construire une compétence économique permettant l’analyse et ouvrant au débat. Toutes les réflexions actuelles sur la fiscalité écologique, les marchés de quotas, les contraintes réglementaires, leur efficacité et leur coût, la prise en compte du long terme montrent assez la nécessité de cette compétence chez l’ingénieur.
Ces insuffisances ont été pour moi des handicaps réels, dont je suis en partie responsable. J’imagine qu’il y a été remédié. L’ingénieur nouveau pourra donc affronter les défis de XXIe siècle.
Sans doute ne faudrait-il pas parler de l’ingénieur, mais des ingénieurs : variété des domaines d’application, variété des fonctions (maîtrise d’ouvrage publique ou privée, maîtrise d’œuvre, entreprise, industrie, etc.).
C’est en acceptant de s’intégrer dans des équipes pluridisciplinaires, en variant les positions, en assumant des responsabilités hors de France, notamment dans les pays les moins avancés, en continuant sans cesse à apprendre, que l’ingénieur pourra faire face à toutes les remises en cause que ce siècle lui demandera. Il lui faudra, sans doute, être plus entrepreneur que salarié, plus innovateur que routinier.
Je citerai volontiers pour finir l’expérience réussie du Collège des hautes études de l’environnement et du développement durable (CHEEDD). Cet organisme encore confidentiel réunit chaque année une trentaine de cadres, en passe de prendre des responsabilités de direction dans tous les horizons professionnels, administration de l’État et des collectivités territoriales, syndicats, ONG, entreprises, pour leur faire comprendre en profondeur le sens du développement durable.
La qualité des « maîtres », mais peut-être surtout celle du dialogue entre responsable d’origines très diverses, satisfait pleinement les auditeurs qui ont la chance de participer à ces sessions.
Il est bien clair que ces résultats ne peuvent être acquis sans décloisonnement, sans confrontations. De ce point de vue, les grandes écoles françaises risqueraient bien d’apparaître comme de petites chapelles. Heureusement, elles ont fait le choix de nombreux partenariats et de l’internationalisation. Elles sont sollicitées à l’étranger pour apporter leur expérience et leurs compétences. Il y a fort à parier qu’elles en retireront bien davantage pour elles-mêmes et leurs étudiants.
L’énumération successive des défis auxquels nous aurons à faire face pourrait porter au pessimisme. Beaucoup de prophètes de malheur s’expriment avec complaisance, tel Philippulus annonçant la fin du monde dans L’Étoile mystérieuse de Hergé.
Je crois, tout au contraire, que la perspective de nous engager progressivement en quelques décennies dans une nouvelle « civilisation », de pratiquer une gestion de la planète Terre en « bon père de famille » est plutôt exaltante et doit inciter toute une génération d’ingénieurs à se préparer l’esprit pour affronter ce surcroît de complexité et pour réussir cette éco-transition.