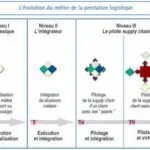Conseil : low-cost ou value for money ?

L’émergence d’offres low-cost se généralise dans de nombreux secteurs et oblige les acteurs en place à modifier leurs positionnements pour rester compétitifs.
Le conseil est aussi concerné par ce mouvement, même si les activités de services ont des spécificités à prendre en compte.
Le modèle low-cost
Quel est le point commun entre le logiciel de VoIP Skype, les hypermarchés Lidl, les hôtels Formule 1 et les avions EasyJet ? Tous ces produits sont commercialisés par des entreprises qualifiées de » low-cost « , qui partagent deux principes clés dans leur modèle : le premier consiste à minimiser par tous les moyens sa structure de coûts, le deuxième consiste à simplifier au maximum son offre pour casser les prix et prendre des parts de marché aux acteurs traditionnels.
Une offre à bas coûts prend à contre-pied le postulat désormais obsolète qui disait » qu’un produit de bonne qualité est forcément cher « . En effet, une entreprise low-cost commercialise une offre la plus simple possible (à produire et à communiquer) en supprimant toutes les composantes des concurrents que le client n’utilise pas mais qu’il paye : la marque, les options incluses d’emblée dans l’offre, les cadeaux et primes de fidélisation… En effet, pour trouver des relais de croissance ou des sources de différenciation sur des marchés arrivés à saturation, les acteurs » traditionnels » ont progressivement intégré dans leurs offres des fonctionnalités supplémentaires avec deux modalités également risquées : soit ils les proposent comme des options au risque de rendre leurs offres difficiles à comprendre pour le client (et le vendeur…), soit ils les intègrent dans le produit au risque de générer une frustration de la part du client qui paye pour quelque chose qu’il n’utilise pas. Ainsi, les acteurs low-cost définissent leurs offres en se limitant à ce que le client valorise le plus, en le vendant le moins cher possible et en communiquant fortement sur la qualité identique malgré des prix en baisse. Enfin, en complément de ce prix facial très attrayant, la plupart valorisent fortement les options ou les modifications demandées par le client par rapport à l’offre de base (ex. : prix Easyjet suivant la durée d’anticipation).
Concernant l’optimisation de la structure de coûts, tous les postes sont potentiellement concernés, de la R & D (minimale) au service client (automatisé). En outre, une gamme de produits réduite et des fonctionnalités limitées ou basiques sont des leviers supplémentaires de réduction de la structure de coûts. Ainsi, le succès de ces acteurs, qui entrent sur un marché déjà installé, repose aussi sur leurs capacités à mettre en œuvre dès leur création la structure la moins coûteuse sur le long terme à l’opposé des autres acteurs en place qui doivent amortir leurs modèles de coûts et qui ont de grandes difficultés à faire évoluer leurs structures existantes (c’est-à-dire incapacité à conduire un plan social, à modifier les contrats de travail…).
La combinaison de ces deux principes permet aux acteurs » low-cost » de capter une part de marché significative et de rester profitables :
- au Danemark, un opérateur virtuel de communication mobile Telmore a acquis en trois ans 10 % de part de marché et a entraîné une baisse des prix de 50 % en dix mois sur le marché avec une offre minimale,
- le hard discount (avec LeaderPrice et Lidl qui représentent 62 % de ce segment) représente 13 % de la distribution française en 2004,
- dix ans après son lancement en 1995, EasyJet dessert 60 aéroports et transporte 24,3 millions de passagers pour un chiffre d’affaires qui a dépassé 1 milliard d’euros en 2004. En Europe, les compagnies low-cost ont acquis 16 % de part de marché face aux compagnies traditionnelles.
Le modèle low-price
Les offres » low-cost » sont à distinguer des offres » low-price « . En effet, ces dernières promettent au client la même valeur ajoutée que les offres classiques mais à des prix bas. Les sociétés correspondantes gardent la logique de réduction des coûts mais sans forcément limiter au maximum la largeur ou la profondeur de gamme produit. Elles se fondent généralement sur une innovation qui leur permet d’avoir un avantage sur les coûts, et sur la sensibilité des clients au prix, en comblant une marge plus faible par un volume de vente plus important : Free a ainsi profité de la généralisation du haut débit en France pour commercialiser la Voix sur Internet (ou VoIP) et bousculer les opérateurs fixes. De même, Last Minute offre des tarifs réduits pour le même service final grâce à la commercialisation des » invendus » de dernière minute des compagnies classiques. Zara dans l’habillement vend grâce à sa Supply Chain des produits quasiment identiques aux produits de grandes marques et moins chers. Enfin, les logiciels libres leaders (comme Linux ou MySQL) sont passés progressivement du » low-cost » au » low-price « , en étoffant leurs fonctionnalités grâce au développement Open Source via des ressources gratuites réparties dans le monde entier.
Opportunités dans le conseil
En raison d’un marché du conseil en décroissance ces dernières années et de la pression des directions achats sur la réduction des taux journaliers, le conseil n’est pas épargné par cette tendance et il est apparu des cabinets positionnés à bas prix. Plusieurs points sont à prendre en compte pour évaluer la faisabilité d’un conseil à bas coûts.
Tout d’abord, le conseil est une activité en interface avec le client (« front office ») plutôt que d’activité support (« back office »), et la qualité de la prestation dépend fortement de la qualité individuelle de chaque consultant. En réalité, même si beaucoup de cabinets promettent de superbes méthodologies (la plupart se limitant à une paraphrase de diagnostic – plan d’action – mise en œuvre…), le facteur clé pour choisir un cabinet porte plutôt sur sa connaissance de la problématique et du secteur, sur sa capacité à structurer une réflexion et à garantir l’obtention d’un résultat. À l’inverse, le conseil » low-cost » supposerait des solutions ciblées – packagées, industrialisées – pour pouvoir être dupliquées avec un minimum d’investissement commercial et mises en œuvre par des consultants » interchangeables « . Dans la plupart des cas, la demande du client reste cependant complexe, la réponse implique des solutions originales (« chez moi, ce n’est pas pareil… »), supposant des consultants expérimentés capables de trouver ou d’inventer les solutions, et le modèle low-cost devient alors peu pertinent.
Par ailleurs, le conseil est une activité de service où le résultat est généralement obtenu grâce à un travail commun consultant-client. Ainsi, la confiance entre cabinet et entreprise est non seulement nécessaire mais est le fondement de la relation qui doit s’établir entre eux. Il n’est pas étonnant que les modèles low-cost aient beaucoup de difficultés à percer dans la banque, où une part importante de la valeur ajoutée réside dans la proximité entre le client et le conseiller, qui le comprend au mieux et peut lui proposer les produits les plus adaptés. La cherté de la prestation vient de l’individualisation, principe que les entreprises battent en brèche en dépersonnalisant au maximum la relation client-consultant, en allant jusqu’à la mise en place d’appels d’offres, de places de marché voire d’enchères inversées. Malgré ces nouveaux systèmes, le choix du client sera encore largement lié au » courant » qui s’établira lors d’une éventuelle présentation orale ou à sa connaissance préalable du consultant.
Un cabinet de conseil dit classique se trouve ainsi dans un contexte rendant un positionnement low-cost peu tenable dans la durée : structure de coût fixe importante (salaire des consultants), activité peu reproductible compte tenu du contexte spécifique de chaque client, actifs stratégiques reposant essentiellement sur des personnes et non sur des technologies ou des actifs matériels. Enfin, le modèle de rentabilité d’un cabinet repose sur deux facteurs principaux : la marge par ressource par rapport à son salaire et le taux d’activité sur projet. Alors que la plupart des agences d’intérim appliquent un coefficient compris entre 1,8 et 2 (pour des profils rares) par rapport au salaire brut, les cabinets de conseil doivent appliquer un coefficient supérieur pour gérer deux risques inexistants dans l’intérim : les projets sont (pour la plupart) facturés au forfait et non en régie, et la structure de coûts est fixe contrairement à l’agence d’intérim qui ne paye aux salariés que les jours facturés et dispose donc de coûts essentiellement variables.
Il existe ainsi une place éventuelle pour du conseil low-cost sur une nature de prestations bien particulières : services basés sur une méthodologie très standardisée, applicables sur un nombre important d’entreprises, où la prise en compte du contexte spécifique du client est faible et où la valeur du service réside plus dans la méthode que dans la valeur intrinsèque du consultant (non salarié mais en free-lance) : le conseil pour une certification qualité, l’audit, le déploiement d’une même solution générique, certains types de formation peuvent être ainsi des opportunités pour un prestataire low-cost. En revanche, le conseil en stratégie semble peu propice à ce modèle…
Conseil » value for money »
Sans aller jusqu’au modèle low-cost, il existe des marges de manœuvre pour un conseil moins cher et capable de proposer la même valeur ajoutée que les cabinets de marque. Ainsi, Hemeria n’est pas en tant que tel un cabinet low-cost, mais cherche à apporter le maximum de valeur ajoutée en réduisant au minimum les prix et ses coûts. Trois principes structurent cette logique :
- nous ne refacturerons pas à nos clients une prime de marque (qui peut aller jusqu’à 30 % en plus), même si nous disposons de chefs de projet et directeurs de projet formés dans ces cabinets de marque et via des expériences opérationnelles. De même, nous développons des partenariats avec des cabinets étrangers sans avoir les surcoûts d’une structure internationale sans valeur ajoutée. Enfin, nous avons dimensionné nos fonctions support au plus juste pour limiter les coûts tout en délestant les consultants des tâches à plus faible valeur ajoutée ;
- en outre, dès que possible, nous lions une partie de nos honoraires à l’atteinte effective des résultats chez nos clients afin de les rassurer sur la valeur que nous apportons et sur notre engagement à leurs côtés ;
- enfin, pour les missions de stratégie, nous prenons en compte dès le début la faisabilité opérationnelle pour limiter les analyses au strict nécessaire et éviter de creuser des points qui aboutissent à des beaux transparents mais n’apportent pas de valeur ajoutée dans la décision ou la mise en œuvre.
Selon le bon adage en cours dans les achats, il est préférable – en particulier dans le métier du conseil – de raisonner » coût complet et ROI » plutôt que simplement » prix d’achat et réduction « .
Ainsi, avant de sélectionner un cabinet de conseil pour un projet de stratégie, d’optimisation des opérations ou d’orientation vers le client, posez-vous deux questions principales :
- est-ce que le projet nécessite un accompagnement avec un cabinet disposant d’une forte marque : livrable pour des actionnaires, projet alibi pour justifier d’une conclusion que vous avez déjà identifiée… ?
- e projet nécessite-t-il une intervention du type rouleau compresseur ou faut-il plutôt un accompagnement personnalisé fondé sur une prise en compte du facteur humain et une mobilisation de compétences diverses permettant de trouver des solutions originales ? Avez-vous besoin d’atteindre vos objectifs quels que soient les moyens, ou bien la démarche pour y parvenir et l’implication des ressources internes sont-elles elles-mêmes un des objectifs du projet ?