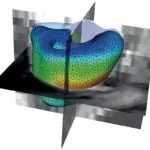Covid-19 et diabète, la télémédecine en pointe à Bichat


Ronan Roussel (91) est un polytechnicien médecin, chef du service de diabétologie de l’hôpital Bichat, un hôpital sur tous les fronts pendant la crise Covid. En plus des malades de la Covid-19, Bichat a accompagné, via la télémédecine et l’application CoviDIAB, plus de 20 000 personnes diabétiques, une population à risque de développer des formes sévères de Covid. Le recours à cette technologie s’est révélé particulièrement pertinent pendant le confinement et un précieux allié de la pratique traditionnelle de la médecine.
Quel a été ton emploi du temps pendant la crise de la Covid-19 ?
Ça a été dense et ça ne se calme pas car il faut complètement réorganiser l’activité. Les gens sont réticents à venir à l’hôpital par crainte du virus, notamment à Bichat qui a été sur le front. Après chaque consultation il y a une procédure de nettoyage et on doit aussi limiter les interactions entre les patients à l’hôpital de jour, par exemple.
Comment s’est passée la crise à Bichat ?
L’hôpital de jour et les consultations ont été arrêtés pour l’essentiel, notre service n’a gardé que la moitié des lits pour des hospitalisations classiques. Si les lits étaient fermés, c’était pour libérer du personnel pour aller dans les services dédiés à la Covid, j’ai moi-même effectué des gardes de nuit dans des services Covid. En effet les patients atteints de la Covid étaient beaucoup plus consommateurs de soins que des patients normaux. Ce qui fait que Bichat était à 80 % affecté à la Covid, en ayant deux fois moins de lits qu’en temps normal.
Tes activités ont-elles changé ?
Nous nous sommes réorganisés pour rendre service aux patients diabétiques qui n’étaient pas au contact de Bichat. Ça a été une montée en charge très importante de l’activité de téléconsultation, de la télésurveillance du diabète en utilisant des plateformes de télésuivi fondé sur la transmission des glycémies. Le diabète étant une maladie chronique, on connaît les patients. Le télésuivi permet d’avoir un nouveau canal de communication avec eux et de se rapprocher d’eux, contrairement à ce qu’on pourrait imaginer. Quand j’évoque la télémédecine, la réaction est souvent épidermique, disant que ce n’est pas humain, que ça éloigne le patient du médecin. En réalité ça rapproche énormément l’équipe soignante des patients.
Habituellement, on voit les patients tous les six mois, parfois même une seule fois par an. Alors que, de l’équipement du patient par un soignant avec un lecteur de glycémie relié à son appli au suivi des relevés de glycémie par ce même soignant, les interactions avec le patient sont plus nombreuses. Certes c’est digital, mais le patient connaît la personne, il peut lui poser des questions s’il a besoin de réassurance. C’est un canal digital d’un lien humain qui est très fort.
“Les diabétiques ont été assez
stigmatisés dans les annonces
gouvernementales.”
Depuis combien de temps pratiques-tu la télémédecine ?
Nous étions pilotes pour les services de diabétologie de l’AP-HP avec les collègues de la Pitié-Salpêtrière pour installer les outils de télémédecine de diabétologie à l’hôpital, car c’est un chantier complexe. Diabeo a été le premier outil, aujourd’hui abandonné. Il a fallu organiser les plannings, prévoir de réceptionner les données, les faire entrer dans les services financiers, vérifier que les firewalls de l’hôpital ne bloquaient pas les outils de télémédecine. La crise sanitaire a été un accélérateur important de cette démarche.
Actuellement, 200 patients sont suivis en télémédecine. Il s’agit de patients sous insuline car il existe un modèle économique pour ce traitement. C’est le programme Étapes (Expérimentations de télémédecine pour l’amélioration des parcours en santé) qui est une expérimentation de la HAS (Haute Autorité de santé) et de la sécurité sociale, qui rembourse le temps que les professionnels passent à faire ce suivi et à donner des recommandations aux patients. C’est une démarche expérimentale nationale qui a commencé il y a plus de deux ans et qui va durer cinq ans.
Ce programme ne concerne pas seulement le diabète mais aussi le télésuivi des patients insuffisants cardiaques ou porteurs de pacemakers. Nous sommes en train d’adapter ces plateformes aux patients sous d’autres formes de traitements antidiabétiques. La France est très en avance du fait de l’expérimentation de ce modèle économique. Plusieurs start-up se sont mises sur ce segment, nous utilisons essentiellement la plateforme française Diabnext, qui se veut universelle, compatible avec la plupart des dispositifs médicaux.
Quels sont les avantages côté patients en plus de la réassurance et de la formation ?
Ce télésuivi permet des gains de temps considérables et aussi l’amélioration du contrôle glycémique au long cours qui est le déterminant essentiel des complications du diabète. Le traitement du diabète est très original. C’est un traitement injectable que le patient s’administre lui-même, dont il détermine lui-même la posologie après avoir lui-même recueilli l’information. Ça fait beaucoup d’originalité et d’obstacles à franchir pour que le patient soit autonome. Franchir tous ces obstacles, c’est ce qu’on appelle l’éducation thérapeutique qui fonctionne très bien avec un support continu comme l’application. Ça évite des déplacements à l’hôpital et permet de relier les patients situés dans des zones un peu désertes en spécialistes à une équipe soignante, de délivrer un service expert à distance même s’il faut bien qu’il y ait un contact à un moment ou à un autre.
Et du côté des médecins ?
Le télésuivi permet que les choses soient organisées et ne nécessitent pas une intervention d’urgence pour un patient qui a trop attendu pour appeler. Les problèmes et complications sont beaucoup mieux anticipés, leurs prises en charge sont mieux canalisées. Le programme Étapes concerne une population assez étroite pour l’instant, diabétique sous insuline, avec un équilibre du diabète médiocre qui justifie d’entrer dans le programme. Pendant le confinement, cette limite sur l’éligibilité au programme a été levée au moins transitoirement à la demande des patients.
Les diabétiques font-ils partie des patients les plus à risque ?
Oui, ils ont même été assez stigmatisés dans les annonces gouvernementales. Ces recommandations s’appuyaient sur les premiers articles scientifiques qui nous parvenaient, de Chine essentiellement, qui décrivaient qu’une proportion importante des populations atteintes d’une forme sévère de complications dues au virus était diabétique, une proportion qui dépassait la proportion de diabétiques dans la population chinoise. Mais le diabète est extrêmement hétérogène, les patients ont été effrayés et ont été très demandeurs d’aide au suivi, mais aussi de recevoir des informations spécifiques au diabète. De quel diabète s’agit-il ? De type 1 ou de type 2 ?… Au début nous n’avions pas les réponses à ces questions. Finalement il y avait extrêmement peu de diabétiques de type 1 (environ 2 %), une majorité de diabètes de type 2, et le facteur très prédictif de complications s’est révélé être l’obésité.
C’est la raison pour laquelle nous avons décidé avec les collègues de la Fédération de diabétologie de Paris (AP-HP) d’ouvrir un canal d’information et de communication avec tout patient diabétique en France, l’application CoviDIAB. C’est un site d’informations actualisées sur le diabète et la Covid, mais aussi un canal interactif où l’on accompagne les patients dans un contexte d’épidémie. Nous avons intégré des questionnaires sur les symptômes de la Covid qui généraient des recommandations. Si des symptômes étaient évoqués, l’algorithme analysait ces réponses et générait des recommandations d’orientation : contactez votre médecin traitant, etc.
“La télé-médecine
est une carte qu’on se doit d’avoir dans son jeu pour le bénéfice
des patients. ”
Le patient est-il le seul à recevoir cette recommandation ?
À ce stade, c’est semi-automatisé et seul le patient reçoit cette recommandation. Si jamais une recommandation était faite, le lendemain le patient recevait une question lui demandant s’il avait suivi la recommandation et quelle en avait été la conclusion. Si le patient répondait non ou s’il ne répondait pas, une alerte était générée pour les médecins du service de diabétologie de Bichat, rapidement étoffé d’étudiants hospitaliers pour répondre à ces alertes. On contactait alors ces patients soit via l’appli CoviDIAB, soit par téléphone. Certains patients avaient peur de sortir pendant l’épidémie et l’appel était précieux pour les encourager à consulter. On estime avoir contacté environ 1% des patients sur CoviDIAB. Heureusement d’ailleurs car l’appli a eu pas mal de succès avec 20 000 inscrits au total, bien plus que le nombre de patients suivis à Bichat. CoviDIAB s’adressait donc essentiellement à des personnes qui n’étaient pas malades de la Covid.
Avec cette approche individuelle, nous avons maintenu un lien avec les personnes qui se posaient des questions. Nous avons organisé trois fois par semaine des lives d’une heure, souvent avec un invité – un collègue d’infectiologie, de virologie, etc. – et nous répondions aux questions des patients connectés à ce live qui réunissait entre 500 et 600 personnes. Ces lives existent toujours à raison de deux fois par semaine. Le retour des patients a été excellent. Ils étaient très heureux d’avoir cette source d’informations anti-fake news, dans une ambiance d’empathie qui les réassurait. Tout cela a été fait pour lever l’anxiété des patients.
Il faut reconnaître que nous avons été abreuvés pendant deux mois d’informations très anxiogènes avec l’annonce quotidienne du nombre de décès et de personnes hospitalisées, sans grande empathie.
Une de mes patientes m’a contacté directement car elle était choquée par l’emploi par exemple du terme de comorbidité lié aux patients diabétiques, comme si leur mort due à cette comorbidité était « de leur faute ». J’étais tout à fait d’accord avec elle et nous avons écrit une tribune parue dans La Croix pour dénoncer le choc des mots utilisés et le caractère répétitif, tel un journal de guerre, annonçant les victoires et surtout les défaites, jour après jour. L’application a ainsi généré beaucoup de retours très positifs des patients. Les lives ont aussi permis de constater que beaucoup de patients n’avaient plus de nouvelles de leur médecin traitant.
La population médicale est en effet hétérogène, en partie vieillissante. Les médecins hospitaliers étaient occupés à autre chose, certains étaient submergés. Des médecins libéraux qui n’avaient pas fait la démarche intellectuelle ou technique de se mettre à la télémédecine ont parfois baissé le rideau pour deux mois. Il me semble que c’est un peu une faute, c’est un peu abandonner ses patients en rase campagne. Je ne dis pas que la télémédecine ou la télésurveillance doivent remplacer tout le reste, mais c’est une carte qu’on se doit d’avoir dans son jeu pour le bénéfice des patients. Nous-mêmes avons décidé de continuer les lives indépendamment de la crise Covid. CoviDIAB s’est transformé en Diab’Échange car on y parle davantage du diabète que de la Covid. C’est toujours ouvert au-delà de nos propres patients.
Avec la télémédecine, comment peut-on être sûr de la protection des données de santé ?
Pour les plateformes de suivi, il existe un cadre légal extrêmement rigoureux, les données sont stockées chez des hébergeurs de données de santé. Pour réaliser l’application CoviDIAB, nous avons travaillé avec une start-up de Toulouse, Iriade, qui a repris le squelette d’une application déjà utilisée dans le service pour préparer les hospitalisations (questionnaires à remplir, vidéo qui explique l’opération). Cela explique pourquoi l’appli a pu être si rapidement opérationnelle au moment de la crise, en moins d’une semaine. C’est une appli aussi sécurisée que les outils médicaux.
Pour ce qui est de la téléconsultation, il est fascinant de voir que toutes les barrières sont tombées en 24 heures. Il a été recommandé par l’AP-HP d’utiliser un logiciel assez imparfait mais sécurisé, Ortif. En revanche il est bien moins facile d’utilisation que Skype ou Zoom qui n’ont pas la même sécurité. On pouvait utiliser ces plateformes à condition de prévenir le patient que nous n’utilisions pas la plateforme recommandée. Sur le principe, une possibilité de faille a été acceptée.
Comment passe-t-on de l’École polytechnique au service de diabétologie de Bichat ?
Comme j’étais bon en maths et en physique, j’ai fait une prépa. Mon père est ingénieur, mon frère est centralien, donc il fallait que je fasse mieux que Centrale ! À l’X, en première année j’ai fait mon service militaire et nous avons été sensibilisés à l’ingénierie médicale qui était mal en point à l’époque. Nous étions une dizaine de volontaires à tourner dans les hôpitaux militaires pour évaluer les besoins techniques médicaux. Ça m’a beaucoup plu, non pas tant l’aspect technique que l’aspect médical, le contact avec les gens. Faire médecine m’a traversé l’esprit mais je ne me voyais pas repartir en première année. J’ai fait pas mal de biologie à l’X, mais sans être intéressé plus que ça par le labo.
J’ai eu la possibilité d’effectuer un stage au CEA à la direction des sciences du vivant qui faisait de la RMN (résonance magnétique nucléaire). C’était de la physique qui permettait la pratique de la spectroscopie RMN pour mesurer de façon non invasive des concentrations de molécules dans les tissus. Celui qui proposait ce stage de 4A était Gilles Bloch (81), maintenant le patron de l’Inserm, un polytechnicien qui avait fait médecine pendant ses études à l’X. Il s’agissait de recherche médicale et c’était en même temps assez technologique, ce qui me plaisait bien.
Les médecins avaient un peu peur de cette partie technique, les techniciens qui venaient des sciences avaient un peu peur de l’humain, alors que les deux me plaisaient. À ce moment-là a été rendue possible une passerelle entre l’X et la troisième année de médecine sur dossier. J’ai pris goût à l’hôpital, j’ai passé l’internat et je suis devenu diabétologue du fait de mon activité de recherche sur la concentration de glucose dans le muscle. Parfois on me demande pourquoi j’ai abandonné Polytechnique. Je n’ai pas du tout ce sentiment-là. Pour moi c’est un infléchissement, j’ai eu l’embarras du choix à plusieurs étapes et je ne regrette pas mon choix. Je reçois chaque année cinq ou six polytechniciens qui songent à une carrière de médecine.
Ta formation d’ingénieur t’aide-t-elle pour la télémédecine ?
C’est clair depuis le début. Je ne suis pas un geek mais j’ai une certaine aisance avec le digital, le développement, les plateformes… Tout cela me parle, le jargon des ingénieurs n’est pas une langue étrangère pour moi. C’est d’autant plus important que maintenant le service a une certaine réputation dans ce domaine, et l’on voit passer des e‑mails de start-up qui nous écrivent pour proposer des idées, mais qui sont en fait infaisables ou à côté du besoin des cliniciens. Le fait d’être ingénieur m’aide pour le leur dire. Je suis à l’aise dans ces deux mondes.