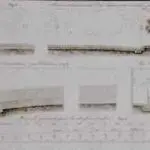Dans nos réflexions sur la cité idéale… n’oublions pas les villes des pays en développement
Notre planète se peuple et s’urbanise
Notre planète se peuple et s’urbanise
Si certaines villes sont plusieurs fois millénaires, c’est avec la révolution industrielle que s’est engagé le processus d’urbanisation massif qui affecte progressivement toutes les régions du monde. Pour nous qui vivons dans un pays déjà peuplé et urbanisé de longue date, un bref rappel de la croissance urbaine passée et prévue dans diverses régions du monde (l’Europe, l’Amérique du Nord, les pays développés, les pays en développement, dont l’Afrique) nous permettra de mieux saisir les enjeux auxquels notre génération et les générations à venir sont confrontées, et d’aborder dans des termes différents la question de la » cité idéale « .
En Europe, la population urbaine totale a quadruplé au cours de ce siècle, de 90 millions en 1900 à près de 400 millions d’habitants aujourd’hui, elle devrait plafonner à moins de 500 millions avant la fin du prochain siècle.
Les villes où nous considérons qu’il fait bon vivre ont souvent plus de mille ans d’existence, leurs quartiers centraux ont été construits, incendiés, rasés et reconstruits plusieurs dizaines de fois : il existe un lien direct entre l’attrait d’un quartier et le nombre de » cadavres » que ses habitants ont sous leurs pieds. Comme la population urbaine a quadruplé au cours de ce siècle, au moins les trois quarts des superficies aujourd’hui urbanisées ont moins de trois générations d’existence, un sixième a moins d’une génération : ces zones récemment urbanisées sont encore, pour la plupart, des » périphéries urbaines » qui n’atteindront la qualité et la complexité de nos villes anciennes que dans quelques générations : entre-temps, il faudra remplir les vides du tissu urbain récent, réhabiliter, casser et reconstruire plusieurs fois l’espace bâti.
Quant à l’Amérique du Nord, ce prolongement de l’Europe, elle a vu sa population urbaine septupler de 35 millions en 1900 à 240 millions aujourd’hui, et ce chiffre ne devrait croître au plus que d’un tiers au cours du prochain siècle.
En dehors de la côte est des États-Unis, l’âge moyen des zones urbaines nord-américaines était en 1900 de l’ordre d’une génération : autant dire que nombre de ces espaces ressemblaient plus à nos périphéries urbaines qu’à des villes dignes de ce nom. Aujourd’hui, les quartiers les plus anciens de certaines villes américaines ont eu le temps d’être cassés et reconstruits une dizaine de fois – tout va plus vite en Amérique -, et les plus favorisés commencent à prendre de la bouteille. Mais un bon quart de la superficie aujourd’hui urbanisée ne compte encore qu’une génération d’occupants.
Les pays développés pris dans leur ensemble ont vu leur population urbaine totale sextupler de 160 millions en 1900 à 950 millions aujourd’hui.
Ces pays ont, en un siècle, créé assez d’espace urbanisé pour accueillir quelque 800 millions de citadins supplémentaires, en sus des efforts de reconstruction et de restructuration des quartiers préexistants.
Pour construire en cent ans cinq fois plus d’espace urbain que ce qui avait été accumulé depuis l’origine des temps, les pays développés ont dû consacrer beaucoup de compétences et de ressources, mettre sur pied des mécanismes de financement adaptés aux besoins, mettre à contribution des institutions existantes (cf. la Caisse des Dépôts en France), en créer de nouvelles. Certaines des ZAC et autres ZUP ainsi créées à la hâte, devenues invivables, sont destinées à être entièrement détruites.
Mais, de même que l’on a appris à maîtriser le processus de vinification et à faire un bon vin en un ou deux ans, on peut aujourd’hui, en y mettant les compétences et le prix, fabriquer des villes nouvelles et des quartiers de ville qui, dès la première ébauche, ont la plupart des qualités requises d’une vraie ville, mais il leur manque toujours le » charme » et la complexité qui ne s’acquièrent qu’avec le temps.
Au cours du siècle prochain, les pays dits développés, dont la population urbaine n’augmentera plus guère, pourront, chez eux, consacrer l’essentiel de leurs efforts à faire mûrir le patrimoine urbain existant, à casser et à reconstruire un nombre de fois suffisant pour atteindre, vers la dixième génération d’occupants, l’âge de la maturité dans la plupart des zones urbanisées.
Faut-il pour autant qu’ils s’apprêtent à former moins d’urbanistes, moins d’ingénieurs des travaux publics, moins d’édiles ? Certes non, car nos voisins du Sud ont, dans tous ces domaines, des besoins gigantesques, auxquels nous ne pouvons rester indifférents.
Tournons en effet notre attention vers les pays dits en voie de développement. En 1900, ces pays comptaient une population urbaine totale de 100 millions d’habitants, soit les deux tiers de celle de l’ensemble des pays développés. Aujourd’hui, ces mêmes pays ont une population urbaine totale de 2 300 millions d’habitants, soit deux fois et demi celle des pays développés ! Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les pays en développement ont vu leur population urbaine multipliée par huit. Les deux tiers de la superficie occupée aujourd’hui par les agglomérations (et non un sixième ou un quart comme en Europe ou en Amérique du Nord) ont moins d’une génération. Et, contrairement aux pays développés, le processus d’urbanisation est loin d’être achevé : la population urbaine de ces pays devrait encore plus que tripler d’ici la fin du prochain siècle.
Jetons un petit coup de projecteur sur le continent africain, notre voisin du Sud. En 1900, ce continent ne comptait que 8 millions d’urbains (soit onze fois moins que l’Europe), dont 5 millions en Afrique du Nord et 3 millions en Afrique subsaharienne. Aujourd’hui, ce continent compte autant d’urbains que l’Europe, soit près de 400 millions, dont 100 millions en Afrique du Nord et près de 300 millions en Afrique subsaharienne : depuis 1960, date d’accès à l’indépendance de la plupart des pays africains, la population urbaine a plus que décuplé, et il faut s’attendre à ce qu’elle quadruple encore avant la fin du siècle ! Près des trois quarts de la superficie aujourd’hui urbanisée ont moins d’une génération.
Comment les pays développés et les institutions internationales réagissent face à ce processus d’urbanisation du Sud ?
Les premiers, surtout préoccupés par leurs affaires intérieures et par la défense de leurs intérêts, ne se posent guère de questions sur les conséquences de leur propre comportement sur les pays les moins avancés qui comptent si peu sur l’échiquier mondial. Quant aux institutions spécialisées dans l’aide au développement, au lieu de chercher à répondre, sans préjugé, aux besoins des pays aidés, elles ont souvent tendance à dire et à faire ce qui est censé plaire aux opinions publiques des pays développés, comme le montrent les deux citations ci-après :
Extrait d’un discours de Sadruddin Aga Khan, ancien haut-commissaire HCR : » Il faut arrêter l’exode : un grand nombre de gens quittent la campagne pour la ville, venant augmenter la population des bidonvilles déjà difficile à contrôler… Dans la région abandonnée, l’exode des muscles est tout aussi néfaste que l’exode des cerveaux… Dans la région d’accueil, l’arrivée des migrants pèse lourdement sur les services mal équipés et intensifie leur marginalisation… La meilleure façon d’éviter d’autres migrations est forcément d’épauler les populations dans leur région d’origine. Il faut les aider à atteindre une plus grande autosuffisance… avant qu’elles soient tentées ou forcées de s’exiler vers les zones urbaines. »
Extrait du document de stratégie d’un bailleur de fonds d’Europe : » Dans les pays d’Afrique de l’Ouest, le secteur agricole est le seul secteur productif significatif… L’urbanisation croissante y est à l’origine d’une répartition géographique déséquilibrée de la population, qui ne fait qu’accentuer les conséquences négatives de la croissance démographique globale… Cette urbanisation rapide à laquelle on a assisté dans la région du Sahel a approfondi encore le fossé socioculturel entre les villes et la campagne. Les villes en expansion rapide abritent une population jeune qui tourne le dos aux valeurs traditionnelles. »
On sait pourtant depuis longtemps que toute tentative de freiner la croissance urbaine dans les pays en développement ne peut être au mieux qu’inopérante et au pire que contreproductive. Si effrayant qu’apparaisse le spectre de ces multitudes de nouveaux citadins du Sud, les pays déjà développés et urbanisés n’ont pas d’autre choix que de prendre acte du caractère irrépressible de la croissance urbaine dans les pays en développement et d’adapter en conséquence les règles du jeu de l’économie monde.
Les taux de croissance de la population urbaine que l’on constate aujourd’hui dans les pays en voie de développement s’expliquent à la fois par les taux de croissance démographiques de ces pays, qui atteignent couramment 3 % par an pendant la phase de transition démographique, et par l’ouverture de ces pays au monde et à l’économie de marché, d’essence urbaine.
Dans les pays qui entrent en transition démographique avec des niveaux d’urbanisation initialement faibles, de l’ordre de 20 %, un pour cent d’émigration rurale se traduit par un surcroît de croissance urbaine de cinq pour cent, et les taux de croissance de la population de certaines villes peuvent durablement dépasser dix pour cent par an.
Reprenons l’exemple de l’Afrique dont la population totale aura décuplé en un siècle. Une telle croissance ne peut évidemment pas être uniformément répartie dans l’espace : la population tend à se concentrer dans les régions les mieux dotées en ressources et les mieux intégrées, d’abord au marché mondial, puis aux marchés régionaux. Ainsi, du fait des migrations régionales, la Côte-d’Ivoire, qui était deux fois moins peuplée que l’actuel Burkina dans les années 1960, sera à terme deux fois plus peuplée que ce pays. En Afrique aujourd’hui comme cela a été le cas en Europe au siècle dernier, les villes jouent dans cette restructuration nécessaire du peuplement et des économies locales (y compris du monde rural) un rôle essentiel.
L’urbanisation apparaît ainsi comme l’une des clefs de la » soutenabilité » de la croissance démographique des pays en développement et comme la manifestation de la modernisation et de l’ouverture à l’économie de marché. Vouloir freiner les migrations et la croissance urbaine de ces pays n’a pas plus de sens que d’y prôner la croissance zéro ou de chercher à mettre ces pays à l’abri des influences extérieures.
Sauf recours à la violence, comme cela a été le cas dans des pays comme la Chine lors de la Révolution culturelle et le Cambodge à l’époque des Khmers rouges, il n’y a pas plus de moyen de stopper la croissance urbaine que de remède contre le progrès scientifique et technique et contre la tendance à la mondialisation.
Reste à se demander ce qui doit être fait, et ce que nous, les pays développés, pouvons faire, pour rendre ce processus aussi efficace et soutenable que possible, et, à tout le moins, pour ne pas le gêner.
La mondialisation n’a pas que des avantages pour les pays en voie d’urbanisation
Sans s’étendre davantage sur ce sujet d’actualité, il faut au moins rappeler le découplage croissant entre, d’une part, la croissance démographique et l’urbanisation, qui se concentrent dans les pays les moins avancés, et, d’autre part, la croissance de l’économie mondiale, qui se concentre dans un petit nombre de pays avancés ou émergents. Le PNB moyen par habitant des 44 pays à faible revenu, qui regroupent 2 milliards d’habitants, est aujourd’hui 80 fois plus faible que celui des 24 pays à revenu élevé, qui comptent 800 millions d’habitants.
De tels écarts sont plus de dix fois supérieurs à ce qu’ils ont jamais été dans l’histoire de l’humanité, et ils sont d’autant plus dangereux que les communications ont considérablement rapproché les hommes et favorisé mimétisme et comparaisons.
Grâce à leurs faibles salaires, certains pays en développement peuvent certes bénéficier des délocalisations d’industries de main-d’œuvre. Mais la plupart sont surtout victimes des importations à bas prix de nos surplus (produits alimentaires, vêtements, véhicules…) qui nuisent au développement des mille et un petits métiers sur lesquels les villes de nos pays développés ont pu se construire. Ce premier constat doit nous inciter à réfléchir à un code de bonne conduite des pays riches à l’égard des pays en développement.
Le coût de l’urbanisation est proportionnellement plus élevé dans les pays en développement que dans les pays développés
L’une des conséquences de l’aggravation continue des disparités de PNB par habitant entre les pays riches et urbanisés et les pays en voie de peuplement est que le besoin de financement engendré par l’urbanisation de ces pays et le contenu en importation des investissements correspondants sont de plus en plus difficiles à supporter.
Dans un pays dont le PNB par habitant est de 400 dollars, le mètre linéaire de voie urbaine et le mètre carré de bâtiment public coûtent certes moins cher que dans un pays développé dont le PNB par habitant est de 20 000 dollars, mais pas dans ces proportions de un à cinquante, d’autant que la culture technique que nous développons chez nous et les normes que nous nous imposons à nous-mêmes servent de référence universelle. Or, les besoins d’investissements publics de fonction locale induits par la croissance urbaine des pays en développement sont plus élevés que dans les pays déjà urbanisés.
En Afrique subsaharienne, la capacité à dépenser des collectivités locales est en général incroyablement faible : le niveau moyen de dépense de fonctionnement et d’investissement par habitant des municipalités, exprimé en dollars, est de l’ordre de mille fois inférieur à celui des municipalités européennes, alors que les taux de croissance urbaine y sont cinq fois plus élevés et que le stock d’équipements publics hérité de l’histoire est inexistant ou en partie obsolète.
Ce deuxième constat doit nous amener à réfléchir sur l’avenir de » l’aide au développement « , qu’il est de bon ton de considérer comme destinée à disparaître rapidement, alors que les transferts de ressources du Nord vers le Sud, dont la première raison d’être est de contribuer au coût du peuplement de la planète, devraient fortement augmenter.
La maîtrise de la croissance urbaine impose d’adopter des objectifs réalistes et de recourir conjointement à un large éventail de moyens de financement.
Après deux décennies d’ajustement, qui ont entraîné une forte contraction de la dépense publique, un abandon de la planification et une certaine perte de contrôle du processus d’urbanisation, il est temps de rétablir des niveaux convenables d’investissement public urbain, à la mesure des enjeux, mettant en œuvre des mécanismes de maîtrise d’ouvrage et de financement soutenables et durables. Pour remettre à l’échelle la dépense publique urbaine, il est nécessaire de mobiliser conjointement toutes les sources concevables, à commencer par les ressources locales, qui sont généralement loin d’être exploitées au mieux.
Il faut aussi accepter d’étaler dans le temps les investissements d’urbanisation. Rêver de la ville idéale, c’est intéressant et stimulant, mais cela ne doit pas servir d’alibi pour ne pas s’occuper sérieusement de la ville réelle.
Dans le contexte de poursuite de la croissance de la population urbaine, même ralentie structurellement, et compte tenu du retard accumulé, il faut admettre, selon toute vraisemblance, qu’il y aura à gérer un » retard durable » de l’équipement urbain sur les objectifs communément évoqués dans les débats internationaux : par exemple, pendant encore une ou deux générations, seulement 50 ou 60 % de population urbaine aura un accès direct aux services urbains marchands et un niveau moyen du logement durablement peu satisfaisant – comme ce fut d’ailleurs le cas en Grande-Bretagne au temps de la révolution industrielle, aux États-Unis pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle et comme c’est le cas dans la plupart des pays émergents du Sud-Est asiatique aujourd’hui.
On a d’ailleurs fait depuis longtemps le constat que toute opération périphérique bénéficiant d’un équipement supérieur à celui de nombreux quartiers existants, si modeste soit cet équipement, est inévitablement accaparée par une clientèle de revenus moyens, sinon supérieurs, laquelle n’a ensuite de cesse de faire pression pour obtenir que l’investissement minimum réalisé soit rapidement amélioré aux frais de la collectivité.
Équiper des quartiers nouveaux avant les quartiers existants, a fortiori avant qu’ils soient occupés, n’est d’ailleurs pas une façon de favoriser la densification et d’améliorer la rentabilité des services publics : on ne compte plus les » lotissements équipés » et non bâtis…
À la recherche, toute théorique, de » normes minimales » en matière d’investissement urbain et à leur mise en œuvre intégrée, le réalisme et l’efficacité imposent donc de substituer le principe que proposent l’évolution réelle des villes et les pratiques populaires, à savoir : la progressivité généralisée de l’aménagement et de l’équipement urbains à partir du simple lotissement (bornage de lots à construire).
On constate en effet qu’il est possible de mettre de côté toute exigence » généreuse » d’un équipement préalable à toute cession de terrains à construire, fût-elle une exigence sanitaire… à condition que l’occupation du sol, le découpage parcellaire se fasse correctement, que les emprises de voirie soient réservées, ainsi que les terrains pour certains équipements futurs.
C’est là, dans l’ordre foncier, que se situe, en l’état actuel des choses, le véritable minimum préalable à la construction individuelle des logements. C’est un minimum, parce que cette condition préalable est loin d’être encore remplie, partout et toujours ; un minimum satisfaisant, parce que l’ordre dans le découpage foncier assure effectivement une » maîtrise de l’urbanisation » et donne l’assurance que les réseaux et services marchands pourront se développer, au fur et à mesure de la solvabilité, d’abord collective puis individuelle, des ménages installés.
C’est un minimum à ne pas dépasser, puisque l’obligation d’équipement minimal a presque toujours eu l’effet contraire de celui désiré, savoir de repousser dans la clandestinité et le désordre la production foncière informelle (coutumière) qui n’a ni les moyens de faire, ni intérêt à faire un investissement, alors qu’il existe une forte demande de terrains non équipés…
Les villes, comme Lomé, dans lesquelles le problème foncier a été correctement traité et où les opérations publiques d’aménagement ou d’habitat sont restées modestes, voire inexistantes, sont précisément celles où la maîtrise urbaine est la mieux assurée, où les disparités de niveau d’équipement entre quartiers sont les plus réduites et où, en conséquence, la ségrégation des habitants par l’argent est la plus faible.
Il faut encore faciliter l’accès des collectivités locales à l’emprunt, ce qui suppose, entre autres, la mise en place de nouveaux instruments financiers. Si la croissance économique locale peut se maintenir sur une tendance à long terme de l’ordre de 5 % par an, l’emprunt, progressivement substitué aux dons, permet de décupler le flux de ressources locales consacrées à l’investissement sans obérer l’avenir.
Encore faut-il que les durées d’amortissement et les taux d’intérêt réel de ces emprunts soient adaptés à la nature des investissements publics ainsi financés : en France, les investissements publics de fonction locale ont pu bénéficier de prêts assortis de durées d’amortissement de l’ordre de trente ans dont cinq à dix ans de différé, et de taux d’intérêt réel négatifs. Ce type de financement n’a pu être durablement assuré qu’en détournant au profit des collectivités locales des ressources à bas prix (la collecte des livrets des Caisses d’Épargne, les dépôts et consignations…) par l’intermédiaire d’institutions spécialisées, telles que les filiales de la Caisse des Dépôts et Consignations en France.
Une autre voie concevable est le recours à l’émission de bons ou obligations municipales : c’est ainsi que les villes nord-américaines ont financé leur développement. L’Afrique subsaharienne est l’une des rares régions en développement où ce mode de financement n’est pas pratiqué.
Il faut aussi peut-être repenser les politiques monétaires en tenant compte des nécessités du peuplement et de l’urbanisation. Prenons l’exemple de la zone CFA. On doit se demander si la rigueur actuelle de la gestion monétaire, indispensable et bénéfique d’un point de vue macroéconomique, ne constitue pas aussi, dans les périodes postajustement, un frein à l’épanouissement des économies locales.
La sous-estimation générale de l’économie populaire dans les comptes nationaux et la méconnaissance du caractère » local » d’une grande partie de l’économie réelle conduisent sans doute les autorités monétaires à rationner excessivement la monnaie. Ce rationnement pénalise évidemment davantage l’économie populaire que l’économie moderne (il suffit de prendre un taxi ou d’aller au marché pour voir à quel point la petite monnaie est rare et les billets de 500 F CFA sont usés jusqu’à la corde…).
Il pénalise évidemment davantage les régions éloignées de la capitale, où l’injection de liquidités par la dépense du secteur moderne, public et privé, est largement concentrée. Et il pénalise davantage les collectivités locales, qui ne peuvent ni emprunter aux conditions du marché ni recourir au troc, que le secteur privé. Une réflexion multidisciplinaire et sans a priori sur ce thème des relations entre la gestion monétaire, l’urbanisation, l’économie réelle et le développement local serait fort utile.
Et nos grandes écoles, sont-elles concernées par tout cela ?
En matière d’agronomie tropicale, l’effort de recherche et de formation entrepris au profit de l’empire colonial a en grande partie survécu. En matière de travaux publics, d’urbanisme et de génie urbain, on ne peut en dire autant. Ne faudrait-il pas, en quelque sorte, réinventer les » Ponts-Colo « , ainsi d’ailleurs que » l’Éna-Colo » ?
Ne faudrait-il pas aussi réinventer le SMUH (Secrétariat des missions d’urbanisme et d’habitat) qui, dans les décennies 60–70, a formé toute une génération d’urbanistes et d’ingénieurs municipaux, coopérants et ressortissants des pays en développement, et que l’on a bêtement enterré après l’affaire du » Carrefour du développement » sans se préoccuper des conséquences pour les pays partenaires ?
Aura-t-on encore besoin en 2020 d’une École des ponts et chaussées, alors que nos réseaux de transport seront achevés, que nos villes ne croîtront plus, et qu’il suffira de gérer l’existant, voire la contraction du patrimoine public ? Oui, bien sûr, car cette École devrait alors avoir, à Paris, des activités de recherche et d’enseignement en partie tropicalisées, et des effectifs triples de ceux de l’École actuelle, dont plus de la moitié d’élèves étrangers, originaires non seulement des autres pays développés et des pays émergents, mais aussi des pays en développement, ainsi qu’une forte proportion d’élèves nationaux destinés à passer dans ces pays une partie de leur carrière.
Et cette École des ponts parisienne devrait être… la tête de pont d’un réseau d’écoles régionales de haut niveau à créer dans les pays en développement, notamment en Afrique. L’Europe n’est-elle pas appelée à prendre sa part du problème de peuplement mondial contemporain, en Afrique d’abord ? La France ne doit-elle pas montrer la voie ?
Les problèmes des pays en développement évoqués ici sont-ils si éloignés de nos problèmes hexagonaux ou de pays riches ?
Les populations vieillies de nos pays sont relayées par l’immigration (Maghrébins, Africains et Turcs en Europe, Latinos en Amérique du Nord). Nos plus grandes villes sont touchées par la croissance urbaine mondiale, et les banlieues chaudes sont du » tiers monde chez nous « . L’expérience que nous pouvons acquérir en travaillant dans les villes des pays en développement peut aussi nous être très utile chez nous. La coopération décentralisée, de ville à ville, donne d’ailleurs déjà lieu à des expériences intéressantes dans ce sens.
Les pays en développement sont aussi un marché à exploiter, un marché dont l’importance relative à terme dépasse très largement les quelques pour cent qu’ils sont censés peser aujourd’hui dans l’économie mondiale. Les États-Unis s’investissent massivement en Amérique latine, comme le fait le Japon dans son ère de coprospérité d’Asie du Sud. Notre Sud à nous, c’est l’Afrique.
Et c’est un Sud aussi prometteur que les autres, avec, bientôt, son milliard d’habitants : la concurrence commence d’ailleurs à y être rude. Nous devons nous préparer à investir massivement en Afrique. Certains grands groupes français y sont déjà bien implantés. Mais, pour beaucoup de nos PME, c’est encore une terra incognita…