Enjeux et défis des pratiques médicales au XXIe siècle
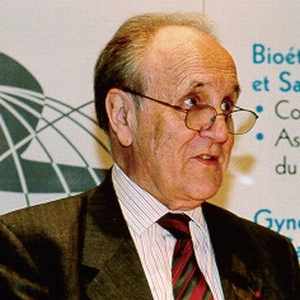
Curieusement, la médecine échappe volontiers à la reconnaissance de cette complexité, et s’offre à une vision réductrice, binaire, schizophrène parfois, opposant la bonne médecine, éventuellement douce ou naturelle, et les bavures, voire les scandales, l’autonomie au paternalisme, les » lois de bioéthique » au droit à l’enfant, les droits de la mère à ceux de l’embryon ou du fœtus ; la société civile croit à la médecine et à ses progrès ou en redoute les effets pervers, sans percevoir l’interpénétration totale des uns et des autres, et le caractère utopique d’un espoir de séparation formelle entre eux ; elle n’accepte pas les inconvénients, et même les drames qui sont la rançon inévitable des avancées scientifiques ; elle croit au bout du compte que l’on peut préférer le blanc au noir alors qu’il faut s’accoutumer au gris ; habituée à une logique binaire, née de l’informatisation, elle a oublié qu’un corpuscule peut être aussi une onde, que la mécanique des fluides peut s’appliquer à l’écoulement d’éléments solides, qu’entre le malade et le bien portant il n’y a que l’espace d’un diagnostic, voire la détermination statistique d’un risque prospectif, que le placebo peut être efficace, et que la psychologie imprègne toutes nos réactions, y compris physiques ; elle devrait savoir, pourtant, que l’individu n’est pas réductible à son génome, qu’une donnée » acquise » peut ne pas être encore » actuelle « , et une donnée actuelle n’être jamais acquise, que » l’evidence based medicine » peut être un leurre et un embryon à la fois une personne et une chose.
Casse-tête pour les adeptes de la rigueur mathématique, surprise pour les juristes, scandale pour les philosophes et les éthiciens, réalité quotidienne pour les praticiens.
La médecine est devenue efficace
Il est banal de situer le début de cette efficacité à l’immédiat après-guerre. Cela est vrai en grande partie : jeune externe en pédiatrie, j’ai assisté aux premiers succès de la streptomycine sur la méningite tuberculeuse, jusque- là constamment mortelle. Mon père est mort en 1950, à 56 ans d’une insuffisance cardiaque d’origine valvulaire, et ma propre valve mitrale a été réparée, reconstruite, avec un plein succès par un chirurgien génial, il y a déjà huit ans de cela. Le cancer guérit aujourd’hui dans environ 50 % des cas ; la mortalité périnatale a été réduite des 3⁄4 depuis 1950 et l’incompatibilité sanguine fœto-maternelle due au facteur Rhésus élucidée, diagnostiquée, traitée, prévenue en une vingtaine d’années.
Mais il faut reconnaître, objectivement, que bien avant des progrès avaient été accomplis. Certes, un chirurgien célèbre avait eu l’inconscience d’affirmer péremptoirement dans les années trente, » malheur à nos successeurs, ils n’auront plus rien à découvrir « . Mais la fièvre puerpérale qui décimait par périodes les maternités publiques (et décimer est un terme faible, puisque parfois 90 % des accouchées mouraient) avait été expliquée, puis prévenue grâce à Semmelweis, Pasteur, Tarnier dès la fin du XIXe siècle, traitée avant-guerre déjà grâce aux sulfamides.
Contrepoint inévitable, le progrès, l’efficacité s’accompagnent d’un renforcement des risques et ceux-ci ne sont reconnus que progressivement. Plus les progrès seront marqués, plus les conséquence nocives seront présentes, et, au moins un temps, imprévisibles.
N’ayons aucune illusion. Nulle recherche cellulaire in vitro, nulle expérimentation animale ne peut mettre à l’abri de ces dangers. Au contraire même, les précautions nécessaires et de plus en plus exigées peuvent à l’inverse retarder le progrès médical : si l’on avait appliqué autrefois les règles actuelles précédant les diverses phases préalables aux autorisations de mise sur le marché, deux médicaments parmi bien d’autres n’auraient jamais été utilisés chez les femmes enceintes en raison de leur risque malformatif avéré chez l’animal, la cortisone et surtout l’aspirine. Aujourd’hui, l’application de ces règles contraignantes dissuade l’industrie pharmaceutique de tout essai thérapeutique d’un nombre important de molécules, au cours de la grossesse, y compris de certaines qui pourraient avoir un effet bénéfique sur l’évolution de celle-ci.
Les exemples de nocivité potentielle de médicaments sont innombrables. Ils sont bien entendu répertoriés et le recours à l’informatique, pour constituer une banque de données sur les effets fâcheux ou les incompatibilités, deviendra de plus en plus une absolue nécessité.
Conservation des paillettes de sperme.
© ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS
Mais rien ne peut éviter les premiers accidents, qu’ils soient observés au cours des phases I, II ou III préalables à l’autorisation de mise sur le marché, ou surtout de la phase IV de pharmacovigilance.
Des exemples d’une telle nocivité viennent immédiatement à l’esprit : la surdité des enfants traités par la streptomycine, les inconvénients des thérapeutiques antimitotiques ou antisidéennes ; une situation particulièrement dramatique fut constituée par la thalidomide au cours de la grossesse et ses conséquences malformatives sur les membres des enfants, et plus encore le cas si particulier du distilbène.
Cas particulier à plus d’un titre : d’abord parce que les conséquences sur les enfants (adénocarcinomes vaginaux et cervicaux, anomalies de forme de la cavité utérine, ou d’apparence de la muqueuse du col) furent retardées, et donc assez tardivement reconnues ; ensuite parce que la focalisation extrême de l’attention sur cette relation de causalité occulta la recherche sur des » cofacteurs » susceptibles d’être intervenus à la même époque.
Enfin, parce que la reconnaissance de cette liaison fut à l’origine d’une telle crainte que les compagnies pharmaceutiques exclurent systématiquement de leurs protocoles de recherche les femmes enceintes, en particulier dans le domaine de l’hormonologie, faisant ainsi littéralement de la grossesse une sorte de » maladie orpheline « .
Au bout du compte, le renforcement de l’efficacité diagnostique (recours aux moyens physiques et chimiques de détection) et thérapeutique se traduit par l’allongement spectaculaire de la longévité (gain ces dernières années d’une heure toutes les trois heures) et surtout de la survie en bon état ou avec des déficits mineurs.
Mais il faut bien comprendre, et admettre, que de tels progrès ne peuvent être obtenus, quelque précaution que l’on prenne, qu’au prix d’inconvénients ou même d’accidents. Le progrès médical comporte des aspects négatifs, et le tableau final est certes blanc, mais avec des taches sombres, et l’évaluation moyenne conduit au blanc cassé.
L’évolution de la médecine n’est qu’un cas particulier de celle de la société
Il ne viendrait probablement à l’idée de personne (mais est-on assuré de la validité de cette affirmation ?) de soutenir que l’évolution de la société et de son environnement comporte plus d’inconvénients que d’éléments positifs. Même les critiques les plus virulents de cette évolution utilisent avion, train, voiture, voire bicyclette et peu le cheval, tout au moins dans les agglomérations. Certains regrettent-ils la bonne odeur du crottin, ou l’utilisation du charbon, extrait de mines mortifères ? On peut certes déplorer certains accidents (l’amiante dont l’usage fut promu pour pallier les risques des incendies, la pollution maritime dont les conséquences à long terme sur la flore et la faune sous-marines sont peut-être souvent évaluées de manière incomplète ou biaisée, l’abandon de la nourriture végétarienne des vaches), il n’empêche que globalement notre environnement n’est pas si épouvantable qu’on le dit parfois.
Comparons avec la situation dans certains pays dits en voie de développement. Au risque de choquer oserais-je ajouter que la défense de certaines espèces animales ou végétales protégées, coléoptères ou amphibiens, le sauvetage à grand prix de trois baleines prises par les glaces, l’introduction de loups et d’ours dont nos ancêtres eurent bien du mal à se débarrasser, la protection forcenée d’oiseaux migrateurs dont on semble oublier que la destinée est, comme pour nous, de périr, et dont les soins dont ils furent l’objet après mazoutage s’apparentent plus à un acharnement thérapeutique dispendieux qu’à une opération humanitaire, apparaissent profondément inconséquents alors que 600 000 femmes meurent chaque année dans le monde du fait d’une grossesse, dans l’indifférence générale. J’abandonnerais volontiers 10, 100, ou 1 000 oiseaux pour sauver 1 femme.
C’est dans ce climat incertain, guidé par la subjectivité, les réactions impulsives, les opinions a priori, la stimulation de craintes irrationnelles que se développe le progrès médical.
Et en particulier que persiste la méconnaissance d’un fait fondamental : l’influence prépondérante, sur la santé de la population, des dommages liés aux comportements, par rapport à ceux liés à l’environnement.
Un exemple caractéristique en est fourni par la diminution de l’écart entre longévité des femmes et longévité des hommes, due à l’accroissement du tabagisme féminin. Cela ne signifie certes pas qu’il faille s’accommoder des inconvénients ou des dommages liés directement à l’évolution de l’environnement. Nombreux sont ceux qui ont été évoqués, conséquences de l’accumulation de déchets, tels que, exemple parmi bien d’autres, les xénoestrogènes susceptibles de retentir sur la santé et la fécondité des générations futures. Il faut s’en soucier et surtout rechercher des preuves objectives, plutôt que s’abandonner à des impressions, voire invoquer un principe de précaution auquel on se réfère de plus en plus, dans tous les domaines, afin de faire l’économie d’investigations sérieuses et d’éviter aux décideurs, politiques en particulier, des risques judiciaires.
En tout cas, la notion qui émerge de plus en plus, à propos de la santé comme de l’environnement et des relations qui unissent l’une à l’autre, est que la complexité des phénomènes doit conduire d’abord à la prudence et à la modestie.
La médecine, associée à la biologie, conduit-elle à la maîtrise de la vie, de la souffrance et de la mort ?
Ce fut l’un des arguments, aussi faible que bien d’autres, avancé contre la procréation médicalement assistée, et au-delà le clonage. Cette introduction forte de la biologie conduit notre société schizophrène à l’enthousiasme, lorsqu’il s’agit par exemple de pallier les conséquences d’une infécondité qui devient obsessionnelle, et à la terreur lorsqu’on évoque les hordes de clones déferlant sur nos terres. Or, l’enthousiasme comme la terreur sont à la fois excessifs et partiellement légitimes.
Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’essor des biotechnologies, en particulier en matière de procréation. Sauf à souligner l’émergence très marquée ici, mais aussi dans d’autres disciplines, telles que l’hématologie, l’hépatologie, ou la neurologie, d’un type nouveau d’activité : la biologie interventionnelle. Les Académies de médecine et de pharmacie y ont consacré un important rapport sous l’impulsion de G. David. Jusqu’ici, en effet, la biologie clinique était centrée sur une activité de diagnostic : le clinicien effectuait un prélèvement (sang, cellule, tissu, etc.) et le biologiste lui transmettait un résultat. Avec le développement de la biologie interventionnelle, tout change : le clinicien extrait le prélèvement qui demeure vivant (globule, cellules éventuellement cultivées, de diverses origines, cellules sexuelles, voire embryons de 2 ou 4 cellules), le confie au biologiste qui le modifie (fécondation in vitro, modification génomique, clonage) et le remet au clinicien qui le réinjecte dans l’organisme originel (ou éventuellement un autre). On perçoit dès lors l’accroissement de la responsabilité du biologiste, et la nécessité d’une définition précise des tâches respectives ainsi que d’un enseignement très spécifique.

Intervention chirurgicale au service de neuroradiologie vasculaire de l’hopital du Kremlin-Bicêtre.
© ASSISTANCE PUBLIQUE-HÔPITAUX DE PARIS
Cette association étroite clinicien-biologiste va dès lors s’attaquer à la lutte contre de nombreuses affections, en particulier héréditaires ou cancéreuses. Le premier succès mondial de thérapie génique a récemment été obtenu en France par Alain Fischer pour une anomalie hématologique congénitale.
Quant à la fécondation in vitro réalisée avec succès en 1978 en Angleterre après des années de travaux difficiles menés par Steptoe et Edwards (travaux qui ont, faut-il le rappeler, nécessité le sacrifice d’un certain nombre d’embryons humains conçus dans un but exclusif de recherche), elle a permis des milliers de naissances particulièrement désirées, mais aussi, il faut le reconnaître, conduit à bien des désillusions (20 % de succès globalement), à des conséquences redoutables (grossesses multiples, suivies d’accouchements prématurés), au développement de la congélation embryonnaire et celle-ci à la question délicate du devenir des embryons surnuméraires ; le clonage, enfin, a soulevé aussi bien des protestations » catégoriques, véhémentes et définitives » quant à sa version thérapeutique, malgré les perspectives médicales qu’elle ouvre, plus vives encore quant à sa version » reproductive » ; celle-ci en effet conduit naturellement à une perversion des relations transgénérationnelles et à un risque pour la structure et l’équilibre familiaux, bien plus qu’aux menaces si souvent alléguées sur la dignité, la diversité, la spécificité humaines.
Il s’y ajoute des dangers biologiques majeurs, qui mettent en cause la sécurité des individus qui s’y exposeraient bien plus que l’avenir de notre espèce. Au bout du compte, le clonage » physique » paraît, lorsqu’on considère la géopolitique du XXe siècle, bien moins dangereux pour l’ensemble de nos sociétés que le clonage idéologique dont nous avons vu et continuons à observer de bien tristes exemples.
Comme on le voit, ici encore, règne la complexité et les jugements nuancés sont nécessaires. Mais ils doivent conduire à un renforcement dans tous ces domaines de la vigilance et de la traçabilité.
Il en va de même avec le développement de la génétique et les conséquences que l’on est en droit d’en attendre et d’en redouter en matière d’information prédictive : prudence en effet quant à l’information des assurances ou des employeurs, mais aussi des individus eux-mêmes, quant aux affections auxquelles ils sont exposés, aux mesures à prendre pour éviter la concrétisation des risques, à la légitimité de les informer lorsque les processus sont irréversibles et les affections incurables, à l’attitude quant à leur descendance, et bien entendu à la réflexion sociétale sur l’euthanasie et l’eugénisme.
Au cœur d’une telle évolution, la mission du médecin s’éloigne de celle d’un robot automatisé dans lequel certains souhaitent le confiner ; son rôle de conseiller, son aptitude à la compréhension des problèmes humains, psychologiques, existentiels ne peuvent que devenir de plus en plus nécessaires.
Conclusion : le médecin dans la société
Dès lors apparaissent clairement l’ambiguïté et la difficulté de la situation du médecin dans la société.
Chercheur, il tente d’élucider les mécanismes pathologiques pour mieux les maîtriser, et sait qu’il s’expose à la critique des personnes qui se croient saines, déplorent l’importance d’investissements supposés inutiles pour elles-mêmes, et plus encore la fuite en avant d’une science déshumanisée.
Praticien, il doit donner et donne effectivement à son patient tout l’amour et toute la compassion dont il est capable et admet qu’en cas d’échec, supposé ou réel, il s’expose à la critique personnelle, poussée éventuellement jusqu’à la poursuite civile ou pénale, à la critique collective de générer des dépenses insupportables pour la société, alors qu’il sait pertinemment que l’exigence des individus, et celle de la collectivité, ne peuvent que conduire à l’accroissement de ces dépenses, que la prévention aggravera le coût financier, la précaution et la prédiction plus encore.
Médecin de santé publique, il perçoit qu’entre les grandes options le choix ne peut résulter de calculs élaborés, fondés sur l’évaluation du prix de la vie humaine (comment choisir entre la vie d’un fœtus, celle d’un nouveau-né, d’un enfant atteint d’affection congénitale, d’un cardiaque ou d’un cancéreux en phase terminale, d’un patient exposé à une maladie dégénérative cérébrale ?) mais sera soumis à l’influence des lobbies ou des circonstances.
Quel qu’il soit, il ne sait finalement qu’une chose : qu’il est le défenseur naturel des patients en général, et de son patient en particulier, qu’il constitue un indispensable corps intermédiaire, un non moins indispensable contre-pouvoir destiné à protéger l’ensemble des individus constituant la collectivité contre les maladies, les travers comportementaux qui les menacent, mais aussi le carcan législatif et administratif destiné à annihiler leur autonomie.
C’est bien cette spécificité de l’action médicale qui explique que deux pouvoirs, opposés entre eux, le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, s’accordent pour une fois dans une commune entreprise d’écrasement de ceux qui doivent l’assumer.


