Eudes Jouët-Pastré (2010), berger fromager dans la Drôme

Si vous passez par la Drôme provençale, entre Nyons et Rémuzat, et si, un soir d’été, vous vous promenez dans les collines sauvages de Villeperdrix, vous croiserez peut-être un jeune berger qui hèle ses chiens et qui « roucoule » vers ses brebis. Eudes Jouët-Pastré – un nom presque prédestiné – est un polytechnicien berger, à la trajectoire singulière mais construite et cohérente. L’écouter parler avec amour de son troupeau, pendant sa garde du soir, au son des cloches des brebis, rend intensément présente la Provence de Giono ; mais interroge aussi sur l’orientation d’un monde d’après la crise sanitaire, qui se fait attendre.
D’où viens-tu ? Es-tu un Drômois d’origine ?
Je suis un Drômois d’adoption. J’ai grandi en Alsace à Mulhouse. J’en suis parti à 17 ans après mon bac pour aller en sport études à Lille car je faisais de l’escrime à haut niveau à l’époque. J’étais dans une école d’ingénieurs postbac avec prépa intégrée, l’Isen, qui avait l’avantage de proposer un parcours sport études. Je me suis blessé au genou pendant deux ans donc j’ai dû arrêter l’escrime. Comme mon objectif était d’être enseignant chercheur en maths à la fac, mes parents m’ont poussé à faire l’ENS ou l’X. J’ai fait une L3 de maths puis j’ai passé les concours de l’ENS de Lyon et de l’X. À l’X nous étions une dizaine par an à intégrer par voie universitaire (ce que ne propose pas Ulm).
Ton choix initial de faire sport études escrime a‑t-il plu à tes parents ?
Mon père est un ingénieur des Mines, ma mère est professeure des écoles, fille de normaliens. Ils n’étaient pas très contents car ils voulaient que je fasse une prépa classique. Ça a été un combat pour imposer mon choix, ainsi que pour imposer mon choix d’aller à l’université. Car, dans le milieu des grandes écoles, il y a toujours du mépris pour l’université.
Finalement, ton choix s’est révélé pertinent et payant ?
J’ai eu les deux, l’ENS de Lyon et l’X. J’ai préféré l’X, son campus périurbain avec des infrastructures sportives et une vie associative qui me paraissait assez riche, ainsi qu’un enseignement pluridisciplinaire qui me parlait davantage. Mes parents étaient contents de ces résultats bien sûr. Mais, à cette époque, j’étais déjà relativement indépendant dans mes décisions.
Qu’est-ce que tu as aimé ou moins aimé à l’X ?
Ce que j’ai beaucoup aimé, c’est la vie associative. Le nombre de binets est énorme, chacun peut trouver de quoi répondre à ses aspirations. J’ai aussi aimé les cours d’humanités et sciences sociales qui apportaient une ouverture d’esprit vraiment appréciable. Ce que j’ai moins aimé, c’est ce que j’appellerais la violence de classe. Par exemple, à Polytechnique, je faisais des maraudes avec une association qui s’appelait la Chorba. Le camarade responsable des relations avec la Chorba m’a dit un jour : « Je n’imagine pas qu’une famille puisse vivre avec moins de 5 000 € par mois. » Je viens moi-même d’une famille bourgeoise où l’on gagne plus que ça, mais je pense qu’il y a quand même un minimum de décence à avoir.
Une autre fois, parce que je faisais beaucoup de stop, de bivouac, de camping, en voyage d’option sportive, un camarade me dit : « Là, tu fais du camping parce que t’es jeune, mais après tu feras comme tout le monde, tu iras à l’hôtel. » Et ces paroles étaient tout à fait anecdotiques, normales de la part de ces camarades. C’est d’une telle violence ! C’est le point à l’X qui m’a choqué.
Te sentais-tu intégré ou un peu à part ?
Je pense que j’étais un ovni. J’étais bien intégré dans le sens où j’avais pas mal d’amis, je suis sociable, et en même temps j’étais un ovni. Je dois dire aussi que, avant d’intégrer l’X, j’étais parti en voyage avec la fondation Zellidja qui offre des bourses de voyage pour des jeunes entre 16 et 20 ans, seul en Alaska. À 19 ans, je me suis immergé seul dans la nature juste après mes concours dans le Nord-Ouest canadien pour un voyage de 40 jours dont une vingtaine dans la nature sauvage. J’ai descendu le fleuve Yukon en mode survie.
Mon obsession était alors d’éviter les attaques d’ours. Et j’ai intégré l’X le surlendemain de mon retour, donc dès mon arrivée, j’étais déphasé. Je voyais un camarade qui lisait un bouquin de finance en anglais, un autre un cours de physique de Feynman. Je ne me sentais pas trop dans le même univers.
L’été d’après, je suis parti vivre chez les Pygmées du Cameroun, les Bakas, dans la forêt équatoriale. C’est un peuple de chasseurs cueilleurs, j’ai vécu parmi eux pendant un mois entre ma première année et ma deuxième année. On pratiquait la chasse, la pêche, la cueillette aussi.
Comment as-tu eu l’idée d’aller vivre cette expérience chez les Pygmées ?
Quand je suis allé dans le Nord-Ouest canadien, une bonne partie de mon voyage était consacrée à la rencontre avec les peuples amérindiens pour voir comment ils perçoivent l’exploitation de leurs ressources naturelles, depuis la ruée vers l’or jusqu’à aujourd’hui. C’était un cadre fixé par la fondation Zellidja, qui a financé mon projet, que mon voyage soit l’occasion d’une enquête. En descendant le Yukon, je parcourais la voie de circulation utilisée par les chercheurs d’or à l’époque. J’ai donc passé pas mal de temps dans les communautés autochtones. Ils ont complètement subi la ruée vers l’or où il y a eu un afflux massif de 40 000 orpailleurs en un an ou deux, sachant qu’ils étaient bien moins nombreux que ça. Et aujourd’hui, avec tout le pétrole et le gaz en Alaska et au Yukon, j’ai enquêté pour savoir comment ils se positionnent.
Je me suis pas mal interrogé sur les relations hommes-nature, pour comprendre comment un peuple autochtone se définit par rapport à son milieu naturel et comment il se définit par rapport aux autres peuples ; donc comment les Amérindiens se définissent par rapport aux Blancs et comment les Bakas se définissent par rapport aux Bantous, c’est-à-dire aux Camerounais qui ne sont pas pygmées.
C’est sûr qu’à l’X tu fréquentais plutôt les futurs cadres supérieurs des compagnies pétrolières…
Peut-être que je ne serais pas allé travailler chez Total, mais je pense qu’on ne peut pas étudier un sujet sans écouter toutes les parties. Il est important de prendre en compte les peuples autochtones, qui sont souvent la dernière roue du carrosse dans les projets comme ça. Y compris dans les projets soi-disant destinés à la protection de la nature.
Je pense à de beaux projets de parcs en Afrique, où, sous couvert de lutter contre le braconnage, on empêche les populations locales de continuer de pratiquer la chasse et la cueillette comme elles l’ont toujours fait depuis des millénaires. L’ONG Survival défend les peuples autochtones. Les pygmées Bakas sont en bas de l’échelle au Cameroun. Quand un Bantou croise le regard d’un Baka, le Baka baisse la tête et prend la fuite. Et, à moi, ils me disaient : « En plus d’être blanc, tu es grand. » Toute la hiérarchie sociale était énoncée dans cette phrase.
Comme c’était inscrit sur ma peau, quels que soient mes actions ou mon discours, c’était impossible pour moi de construire quelque chose là-bas. Je les voyais comme des égaux et eux me voyaient comme le gars au sommet de la pyramide sociale. À partir de là, je n’ai plus trop voulu voyagé, j’ai voulu construire ma relation à la nature ici, sur mon territoire en France.
Le fossé sociologique qui te séparait des Bakas t’a‑t-il paru infranchissable ?
C’est sûr qu’il y a un fossé, une asymétrie de fait. Le simple fait que je puisse me payer un billet d’avion pour aller chez eux, que je vienne avec quelques cadeaux, que je puisse rapporter de la ville 1 kg de riz et une boîte d’allumettes, rien que ça, ça crée une situation de fait complètement inégalitaire et indépassable. Ce n’est pas une inégalité sociale fondée sur les chiffres, c’est de la perception. Les Bakas ne sont pas dans les chiffres. Leur système numérique permet de compter jusqu’à 5 ou 6 et, au-delà, c’est « beaucoup ». C’est une perception qu’on ne peut pas dépasser. Après ces expériences, plutôt que d’aller chercher dans des sociétés qui me sont étrangères à analyser la relation entre un peuple et son environnement, j’ai préféré construire ma propre relation à mon environnement ici en France.
Quel est ton parcours depuis l’X ? Comment es-tu devenu berger fromager ?
En 3A, j’ai choisi SDE, la première édition des sciences pour les défis de l’environnement. Puis, en 4A, j’ai fait un master d’écologie. Après mon master, je me suis dit que j’allais travailler dans l’agriculture pendant un an ou deux pour découvrir différents domaines agricoles. J’ai commencé par un premier contrat en vaches laitières dans le Beaufortain, puis j’ai continué avec un travail de berger dans la Crau. Tout s’est enchaîné, je me voyais difficilement faire autre chose.
Au bout d’un an de salariat, j’ai suivi une formation agricole en apprentissage. Auparavant, entre la 3A et la 4A, j’ai été volontaire dans une ferme en Écosse qui faisait de la brebis à viande et de la vache à viande. C’était un élevage extensif. En Écosse, les brebis sont lâchées dans la colline et, une fois de temps en temps, on va les récupérer. Ça m’a donné une première base. Là où je suis, il faut être en permanence avec le troupeau. Il faut une présence humaine et des chiens pour nous protéger du loup, j’ai une bergère d’Anatolie et un patou.
Au terme de cette formation de deux ans, en parallèle, j’ai cherché du foncier pour m’installer. Il a fallu que je monte un projet, ça a pris du temps, j’ai mis un an et demi avant d’avoir les bêtes. Pendant ce temps, j’ai été prof à mi-temps, manœuvre en maçonnerie, une expérience très formatrice que je conseille de vivre à tous les polytechniciens. Puis j’ai fait une formation en fromagerie, j’ai reçu les bêtes – deux cents brebis de race corse –, pour lesquelles il fallait construire un bâtiment. Ça nous amène au printemps dernier où j’ai produit mes premiers fromages en avril-mai. Trois ans et demi d’expérience avant de s’installer, c’est un minimum.
Vis-tu de ton métier ?
Je ne suis pas à l’équilibre financier pour l’instant. J’espère l’être d’ici un an ou deux. Compte tenu de l’évolution de la PAC, j’ai jugé plus prudent de travailler aussi en fromage. Il y a deux choses qui font parler les éleveurs : la PAC et le loup – le loup davantage.
Y a‑t-il des résonances dans ta vie d’aujourd’hui avec tes expériences passées ?
En matière d’écologie, on parle beaucoup d’écosystème. Nous, humains, faisons partie de l’écosystème depuis des millénaires, nous avons quelque chose à y apporter, un rôle à jouer. Un écosystème, ce sont des interactions : nous avons à recevoir quelque chose de la nature. Quand je garde mon troupeau, il existe une interaction entre mes chiens, mon troupeau, moi, la végétation, le soleil, la pleine lune qui fait que je ne vais pas rentrer les brebis à la même heure, etc. Une interaction entre des éléments vivants et inertes qui contribuent au rythme de la vie.
Qu’est-ce qui te rend heureux dans ton travail ?
La garde, être avec mes brebis dans la montagne. Je ne souffre pas de solitude car le soir je rentre à la maison rejoindre ma compagne – qui est professeure des écoles – et mon bébé, une petite fille, Salomé, qui a 18 mois.
Depuis que je suis installé, je travaille énormément. Ma journée type en été commence entre 6 et 7 heures du matin ; je monte à la traite, puis je mets les brebis en parcs avec des filets et des clôtures mobiles. Après avoir descendu le lait, je vais faire de la fromagerie. Puis je remonte pour les garder l’après-midi.

Ça doit être très exigeant, de s’occuper d’un troupeau.
Il n’y a pas plus exigeant qu’une brebis laitière, avec l’astreinte de la traite, surtout en système pastoral, c’est-à-dire avec mon troupeau déployé dans la colline, dans la lande. Il y a peu de prairies, beaucoup de landes pauvres ici. On ne peut pas tirer de parcs dans la colline. Il faut être présent aux bêtes pour les garder. Quand je les garde, je les mène dans des endroits où elles peuvent se remplir la panse. En fin de journée les brebis doivent ressembler à une table basse.
“On condamne des zones
entières à la désertification,
avec la disparition des services
de l’État, des maternités, etc.”
Comment es-tu connecté au monde, à l’approche des présidentielles par exemple ?
Je m’informe mais je n’ai pas le temps de prendre un engagement politique comme il serait bien d’en avoir en zone rurale. Nous avons de très bons élus locaux de tous bords ici. Et nous sommes les abandonnés de la République. On supprime les classes une par une, jusqu’à supprimer l’école. Au sein de la commune, nous militons pour mettre en place un système de ramassage scolaire, sinon Villeperdrix va rester un village mort, où les familles ne peuvent pas s’installer. On condamne des zones entières à la désertification, avec la disparition des services de l’État, des maternités, etc. C’est un cycle complétement malsain que l’on masque avec le déploiement de la fibre optique. En réalité ça ne correspond pas du tout aux besoins. La dématérialisation va simplement permettre de supprimer tous les services locaux.
La ruralité pourrait être plus dynamique si on s’en donnait les moyens. On assiste plutôt à une « disneylandisation » de la ruralité, où les coqs ne doivent pas chanter trop tôt le matin. Il y a beaucoup de touristes, beaucoup de résidences secondaires, de gîtes, de campings, car c’est une très belle région. En conséquence, nous n’arrivons pas à nous loger, car nos salaires ne permettent pas de rivaliser avec les salaires des cadres européens qui achètent leurs résidences secondaires. Il y a beaucoup de Suisses, d’Allemands, de Belges, de Français de la moitié est de la France.
Que voudrais-tu dire à tes camarades polytechniciens ?
Reconnectez-vous au monde qui vous entoure, le monde naturel, et aussi l’environnement humain, notamment le monde des travailleurs et des gens simples. Il faut réussir à se reconnecter au monde qui n’est pas régi uniquement par des chiffres. Le réel est infiniment plus complexe et plus riche que ça.
Nous, bergers, avons une relation d’affect à nos bêtes. Quand le loup attaque le troupeau, le chèque d’indemnisation ne remplace pas les bêtes attaquées. Pire, cette indemnité nie notre lien aux animaux. Ce que les bergers demandent, ce ne sont pas d’abord des euros, c’est d’être reconnus symboliquement. Or nous n’avons plus de reconnaissance sociale dès que l’on sort de l’image d’Épinal et qu’on aborde le métier de berger dans sa réalité d’aujourd’hui.
Actuellement, on sait qu’un loup est en train de rôder, un chevreuil s’est fait attaquer en début de semaine. Lorsque les louves apprennent aux louveteaux à chasser, il peut arriver qu’on trouve 15–20 bêtes mortes ou à l’agonie. Sans parler des avortements de brebis stressées par les attaques… Derrière cette situation, il y a un problème symbolique, nous ne nous sentons pas respectés sur ces questions-là. Il y a une reconnaissance à trouver, un vrai respect du pastoralisme.
Camarades, il faut sortir d’une approche technocratique pour remettre l’affect au centre. Soyez réceptifs aux gens simples : ils vivent plein de situations analogues à la mienne et sont légitimes pour en parler…





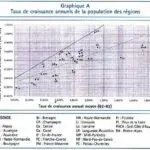

2 Commentaires
Ajouter un commentaire
Témoignage magnifique. Merci.
Bravo pour cette démonstration de courage et d’engagement qui devrait inciter à la recherche du sens dans son activité professionnelle.