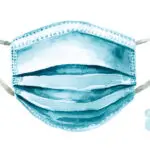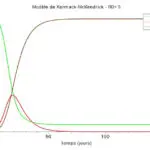Faut-il vraiment relocaliser ?



Il n’est pas besoin de présenter Isabelle Méjean à nos lecteurs, qui ont fait sa connaissance dans notre n° 720 de décembre 2016, à l’occasion de son prix Malinvaud. Elle a plus récemment reçu le prix du meilleur jeune économiste 2020. La J&R l’a rencontrée pour évoquer les conséquences économiques de la crise Covid-19.
Isabelle Méjean, à l’époque de votre prix Malinvaud, vous travailliez sur les relations entre les chocs qui affectent les entreprises au niveau microéconomique et ce qui se passe au niveau macroéconomique (PIB, etc.). Avec la crise post-Covid, nous y voilà en plein !
En effet, et je suis restée de fait fidèle à cette ligne de travaux, même si mes centres d’intérêt se sont depuis lors largement tournés vers l’international. C’est d’ailleurs à cette échelle que les premiers désordres liés à la crise provoquée par la Covid-19 sont apparus : avant même que le virus ne gagne l’Europe, des effets économiques se sont fait sentir en raison de difficultés d’approvisionnement dans certaines chaînes de valeur très dépendantes de la production chinoise. On a eu une bonne illustration d’un de mes thèmes de recherche, la propagation des chocs de productivité dans des chaînes de valeur internationales très concentrées. Rapidement, ces problèmes d’approvisionnement sont cependant devenus anecdotiques, une fois que la crise de la Covid-19 a provoqué une baisse de la demande et un ralentissement de la production dans une grande partie du monde.
Mais le problème pourrait redevenir important si des deuxièmes vagues non synchronisées conduisaient à de nouveaux dérèglements des chaînes de valeur.
On a bien vu que les entreprises comme les États ont eu de gros problèmes d’approvisionnement.
Oui, cela montre qu’il ne suffit pas qu’il y ait de la demande pour que l’économie fonctionne correctement. Les entreprises ont rencontré de vraies difficultés pour gérer ces problèmes d’approvisionnement, mais l’économie globale a quand même continué à tourner : les biens ont – heureusement – continué à circuler et à s’échanger entre les pays et les problèmes d’approvisionnement se sont finalement résorbés assez vite. Mais il est vrai que, même si les marchés ont continué à fonctionner, il y a eu des retards, des coûts supplémentaires pour les entreprises, qui ont eu une incidence sur la productivité. Est-ce que cela va les inciter à revenir en arrière en matière de délocalisation de leurs approvisionnements ? Je ne le crois pas : les entreprises ne sont pas inconscientes des risques qu’elles courent. Ce sont des choix qui sont faits en pleine conscience.
Peut-être s’agira-t-il plutôt de sécuriser la chaîne de valeur que de la relocaliser ?
En effet, plutôt que recentraliser leur production, les entreprises ont intérêt à diversifier leurs sources, ce qui est bien sûr différent d’une relocalisation. Et il ne faut pas non plus s’attendre à voir les choses évoluer beaucoup à court terme à l’occasion de cette crise : face aux difficultés, on sait bien que c’est l’investissement qui pâtit en premier. Or réorganiser les chaînes d’approvisionnement peut représenter de gros investissements. Le « nouveau monde » n’est pas pour tout de suite !
L’industrie pharmaceutique a attiré sur elle beaucoup d’intérêt. Qu’en est-il ?
C’est une industrie relativement simple en termes de chaîne de valeur : les étapes de fabrication ne sont pas très nombreuses. En revanche les productions, qui présentent un très important facteur d’économie d’échelle, sont très concentrées. De manière intéressante, il y a une sorte de spécialisation : le paracétamol est concentré en Chine, mais l’insuline l’est en Europe, et les États-Unis produisent les médicaments à base d’opioïdes. Contrairement à ce dont on a pu avoir l’impression dans les médias, tout ne se fait pas en Chine : l’Europe est aussi un gros producteur. On pourrait décider de rapatrier ce qu’il faut pour assurer notre souveraineté, mais ce ne serait pas facile.
Par exemple, la production du paracétamol est une industrie très polluante, qui met en jeu de grandes quantités de produits toxiques, difficiles à transporter. Et, bien sûr, revenir en arrière en relocalisant cette industrie, ce serait perdre en économie d’échelle. Mais il y a d’autres solutions que la relocalisation : on a vu que Europe, Chine, États-Unis… nous sommes interdépendants. Cette interdépendance peut aussi contribuer à atténuer les tensions géopolitiques qui peuvent apparaître et inciter les États à coopérer.
C’est bien le problème de relocaliser : il faut accepter de réintégrer des industries dangereuses et polluantes.
La question se complique encore si l’on prend en compte l’enjeu carbone. Mais, paradoxalement, l’Europe – puisque c’est au niveau de l’UE que cela se passe – taxe moins les biens très polluants que les autres. Une étude récente montre une corrélation plutôt négative entre le niveau de taxation et l’empreinte carbone : les biens au contenu en CO2 élevé, qui sont souvent des biens qui entrent haut dans les chaînes de valeur, ont tendance à être moins taxés que les biens plus proches du consommateur final. Cette corrélation peut résulter de pressions industrielles, puisque les entreprises qui utilisent ces biens polluants comme intrants ont intérêt à ce qu’ils soient peu taxés. Mais il peut aussi y avoir une rationalité économique, car les tarifs qui s’appliquent très haut dans les chaînes de valeur ont une incidence sur un grand nombre de produits en dessous dans la chaîne.
Au contraire, si on descend dans la chaîne, à l’autre bout, l’incidence est plus faible. Par ailleurs, le consommateur serait volontiers sensible à l’intérêt de taxer les biens polluants, mais malheureusement il est moins organisé que les entreprises pour faire valoir son point de vue.
C’est sans doute particulièrement sensible pour des industries très imbriquées, comme l’automobile ou l’aéronautique ?
L’automobile est un exemple typique d’une industrie très imbriquée, mais essentiellement en Europe. Nous avons délocalisé vers l’Europe de l’Est, pas vers la Chine : les productions d’entreprises européennes en Chine sont destinées au marché local. Voilà un cas où les difficultés d’approvisionnement ne doivent pas grand-chose à la Chine !
Mais ne verra-t-on pas cette industrie reconfigurer complètement ses chaînes de valeur avec l’arrivée du véhicule électrique, et cette fois hors d’Europe ?
C’est un débat intéressant. En fait, la question est de savoir si on veut investir dans des technologies d’avenir, comme ici les batteries. Il y a des approches nationales différentes. Ainsi, si on examine le plan de relance européen, on voit que la France investit plutôt dans du sectoriel : il s’agit de relancer notre industrie aéronautique, ou l’automobile… Alors que l’Allemagne investit plutôt dans des filières technologiques qu’elle juge stratégiques pour l’avenir. On pourrait avoir la même démarche. Pourquoi ne pas profiter de la crise pour investir dans la transformation d’industries dont l’activité va évoluer du fait de la transition écologique, et de cette manière bâtir une industrie porteuse pour l’avenir ?
On a bien vu aussi qu’il n’y avait pas qu’une question d’équilibre économique global, mais que la question de la temporalité était essentielle en temps de crise.
Oui, en particulier avec les masques, on a vu que, malgré le fait que les capacités de production ont été globalement suffisantes, c’est la question des délais d’approvisionnement et d’acheminement qui est devenue cruciale. C’est toute la question de la gestion des stocks et de l’analyse des risques, plus que d’économie : le risque épidémique va-t-il croître à l’avenir, ou pas ? Quels seront les biens stratégiques pour la crise suivante, à nouveau les masques ou les tests, ou autre chose ? Ce ne sont pas des questions simples. En revanche, cela montre aussi qu’il faut éviter de surréagir au milieu d’une crise : la probabilité est alors forte de prendre de mauvaises décisions …
La théorie économique est très au point sur les questions d’équilibre. En revanche est-elle bien armée pour traiter les situations de transition brutale, comme celle que nous connaissons ?
La macroéconomie standard est assez bien équipée pour étudier l’impact de chocs d’ampleur modérée, qu’ils soient temporaires ou permanents. En revanche, la question des risques extrêmes est sans doute moins traitée dans la littérature. Il n’y a qu’à voir le nombre impressionnant de papiers produits par les économistes sur la crise Covid-19 pour comprendre que, tout comme les autres citoyens, les chercheurs se sont retrouvés assez démunis face à la pandémie, ce qui les a poussés à produire tous ces papiers. Maintenant qu’on est sorti du confinement, on se retrouve quand même sur le terrain mieux connu de la crise économique avec une demande agrégée insuffisante et des inquiétudes sur l’investissement et sur les défaillances d’entreprise.