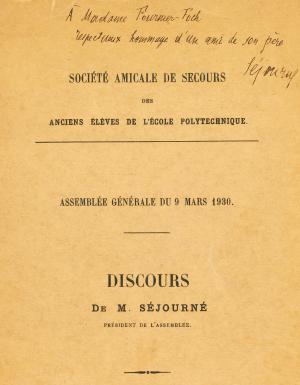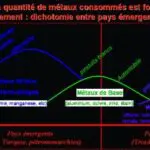Hommage au Maréchal Ferdinand FOCH (1871)
Mes chers camarades,
Quand votre Bureau m’a fait le très grand honneur de me proposer de présider cette Assemblée, j’ai pensé tout d’abord à refuser, et avec les meilleures raisons du monde. […]
“ C’est que le patriotisme est plus vif chez les vaincus ”
Mais Foch est mort depuis moins d’un an, j’avais été son camarade de salle et étais resté son ami : j’avais le devoir de vous parler de lui. J’ai donc accepté. […]
Permettez-moi, d’abord, quelques souvenirs de ma vieille, et très chère, promotion de 1871 (promotion jaune, comme celle de nos trois autres maréchaux : Joffre, Fayolle, Maunoury – simple coïncidence).
Nous portions, alors, la grande cape espagnole ; on l’a supprimée en 1873 ; nous l’avons regrettée, elle conservait dans ses plis une parcelle de notre prestige. À l’intérieur de l’École, dans ces temps lointains, le grand chic était d’être aussi débraillé que possible. Foch, lui, était toujours très correct. […]
Exemplaire du discours dédicacé à Anne Fournier-Foch, seconde fille du Maréchal.
En 1871, nous ne pensions qu’à la revanche et pas du tout à l’argent. […] Nous étions […] le reflet de l’ambiance. C’est que beaucoup d’entre nous avaient vu de près les casques à pointe ; beaucoup avaient vu Paris flamber sous les yeux des Allemands, qui occupaient nos forts.
L’ambiance, on la trouvait aussi aux salons de peinture. On n’y a guère vu, après la Grande Guerre, de tableaux militaires. C’est que le patriotisme est plus vif chez les vaincus.
Dans notre salle 2 […], fort rétrécie, nous étions 12, nous restons deux. Il y a quelques années, nous y avons marqué la place de Foch ; il nous a dit alors : « Quand nous étions sur ces bancs, nous n’avions tous qu’une pensée : la Revanche. Nous sentions tous qu’elle viendrait, qu’il la fallait.
Dans les pires moments de la guerre, je me suis toujours répété : si la France ne triomphe pas cette fois, elle est morte ; il ne se peut pas qu’elle meure, il faut vaincre. Aux plus dures situations, il n’y a qu’une issue, qu’une porte : celle de la victoire. » […]
En 1901 – il était alors professeur à l’École de guerre – un ministre, un camarade pourtant, mais qui ne pratiquait pas la tolérance religieuse, cette vertu si polytechnicienne, estime qu’on ne peut pas aller à la messe et professer la stratégie : il l’envoie en disgrâce à Laon.
D’autres qui ont subi cette même injustice ont quitté l’armée. Lui, fidèle serviteur du pays malgré ses erreurs, obéit et attend sa revanche : elle est venue. En 1907, ses chefs le proposent pour commander l’École de guerre : Clemenceau, alors chef du gouvernement, désire le voir. Foch lui dit, avec sa loyauté coutumière, qu’il a un frère jésuite, à quoi le Président répond : « Je m’en f… » et le nomme.
Après l’École de guerre, il commande le 8e Corps, puis le 20e. C’est là qu’à la Guerre, Joffre va le chercher pour lui confier la IXe Armée. Ici, je veux saluer le vainqueur de la Marne, Joffre, qui, la bataille des frontières perdue, a su rester maître de soi, et exalter le moral du soldat pendant la retraite et l’invasion.
C’est bien lui qui a arrêté l’ennemi sur la route de Paris, comme Philippe Auguste à Bouvines, comme Villars à Denain. Foch l’a toujours proclamé le vainqueur de la Marne : sa merveilleuse campagne de 1918 est fille de cette première victoire.
“ Ce sont les Anglais qui le demandèrent comme général en chef ”
C’est pour cela qu’il a demandé que, dans la promenade triomphale des Armées alliées, à Paris, le 14 juillet 1919, Joffre défilât à côté de lui.
Au cours de sa glorieuse histoire, la France a toujours trouvé, au moment opportun, l’homme nécessaire. En 1914, quand tout était compromis, il fallait un chef prudent, d’un merveilleux sang-froid : elle a eu Joffre.
En 1918, pour bouter l’ennemi hors de France, il en fallait un autre, hardi, impétueux : elle a eu Foch – Condé après Turenne.
Et ces deux chefs, tous deux pyrénéens, sont fils de notre admirable École, celle qui apprend à apprendre. […]
Quand, après 43 ans de paix, la guerre éclate, Foch a 63 ans. II n’a jamais conduit d’expédition coloniale. Il ne sait de la guerre que ce qu’il a lu dans les livres : il n’a que l’expérience des autres. Mais il était né chef. Il en avait naturellement les qualités maîtresses : l’autorité, celle que ne confèrent ni les titres, ni les galons ; la volonté qui n’a pas peur des responsabilités, qui ne connaît ni hésitation, ni découragement, qui maintient jusqu’au bout les déterminations prises.

Le maréchal Foch par Louis Bombled, vers 1920.
En 1914, la guerre a tué son fils et un de ses deux gendres. Il en souffre cruellement ; mais, très vite, ne veut penser et ne pense plus qu’à la guerre. Quand il ne commandait pas, il savait persuader.
En 1914, quand il arrêta les Allemands sur l’Yser, il ne commandait pas, il conseillait ; mais ses avis, parce qu’ils étaient bons, ont été suivis par les Belges et les Anglais. Plus tard, il sait faire accepter ses directives par les Italiens.
1916 est l’année de Verdun et de la Somme ; les Allemands ont fait des pertes énormes et parlent de paix : si nos affaires avaient alors été mieux conduites, on pouvait terminer la guerre en 1917. Mais comme la bataille de la Somme n’avait pas donné tout ce qu’on en espérait, très malheureusement, on écarte Joffre. On voulait, en même temps, se débarrasser de Foch, en le prétendant malade. Il ne l’était nullement et, pour continuer à combattre, eut accepté une division, voire une brigade.
Au commencement de 1917, on fait vers Laon une tentative de percée ; elle échoue. Arrive la débâcle russe. Dans notre armée, qui avait jusque-là montré le meilleur esprit, il y eut des mutineries et un vent de défaitisme souffla de l’arrière. Clemenceau, chef du gouvernement en novembre, lui fait tête et rétablit la discipline du pays. Ça a été un immense service.
En mars 1918, après l’échec de l’armée anglaise de Gough, tout le monde comprit, enfin, qu’il fallait un commandement unique. Clemenceau y pensait, mais pour lui-même, avec Foch comme chef d’état-major. Ce sont les Anglais qui le demandèrent comme général en chef.
En mai, nous sommes bousculés au Chemin des Dames. Déjà des parlementaires, affolés, demandaient la révocation de Foch : Clemenceau le maintint. Le 18 juillet, Foch attaque à Villers-Cotterêts ; puis, sans laisser aux Allemands le temps de se remettre, poursuit sa marche triomphale vers la frontière. De ses belles manœuvres, je ne me permettrai pas de parler. D’autres l’ont fait qui, eux, étaient qualifiés.
Le 31 octobre, alors que douze armées alliées rejetaient les Allemands sur leurs communications, Foch exposait aux chefs alliés leur situation désespérée. On lui demanda si, dans ces conditions, il ne fallait pas continuer la bataille.
Il répondait : « Je ne fais pas la guerre pour la guerre, mais pour des résultats. Si l’ennemi donne aux gouvernements alliés le moyen d’obtenir les résultats qu’ils désirent, il n’y a pas de raison pour que le sang des combattants continue à couler. » C’est bien le langage du grand chrétien qu’il était.
On a critiqué l’armistice comme prématuré. On a dit que les Allemands se seraient sentis plus complètement vaincus si on l’avait signé à Berlin. Foch n’ignorait pas ces critiques et m’en a parlé souvent. « L’armistice, disait-il, nous a donné toute la sécurité qu’il nous fallait, les ponts du Rhin ; nous pouvions aller à Berlin ; qu’y aurions-nous gagné ? Nous n’y aurions trouvé personne et il eut fallu occuper militairement toute l’Allemagne. La guerre est un moyen ; la paix est le but. » […]
“ Il ne suffit pas de vaincre, il faut survivre à la victoire ”
Pour Foch, notre frontière militaire est le Rhin : celui qui l’a est le maître. Dès qu’un ennemi le passe, la France est en danger. […]
Dès qu’on a parlé des conditions de la paix, les Anglais ont immédiatement fait connaître ce qu’ils voulaient et sur quoi ils n’admettaient aucune discussion. […]
Ils ont eu tout ce qu’ils ont demandé et, de très longtemps, l’Angleterre n’a rien à craindre de l’Allemagne. Foch a fait tout ce qui était possible pour assurer notre sécurité ; mais les Anglais ne voulaient pas que la France fût trop victorieuse, et Foch n’a pas été appuyé. Il sentait qu’on élaborait le Traité en dehors de lui ; il a demandé à plusieurs reprises à être entendu. On lui a répondu, en invoquant la suprématie du pouvoir civil, qu’avec la victoire son rôle était fini.

Couverture de l’ouvrage du photographe-portraitiste Paul Darby en 1920 en l’honneur du maréchal Foch.
On l’a cependant entendu : « Il n’y a pas de principe, a‑t-il dit aux gouvernants d’alors, qui puisse obliger un peuple libre à vivre sous une menace continuelle et à ne compter que sur ses alliés pour lui épargner le désastre quand il vient de payer son indépendance de plus de 500 000 cadavres et d’une dévastation sans exemple.
Il n’y a pas de principe qui puisse prévaloir contre le droit des peuples à l’existence, contre le droit absolu qu’ont la France et la Belgique d’assurer leur indépendance. » Il n’a réussi qu’à être entendu, non à être écouté ; il n’a pas même obtenu un procès-verbal constatant ce qu’il avait dit.
Et il a pu dire à des ministres d’alors : « Si le peuple français savait ce que vous avez fait, il vous pendrait. » Donc, malgré tous ses efforts, nous serons vis-à-vis de l’Allemagne dans une situation pire qu’en 1914. […]
Beaucoup de camarades cherchent des situations hors de l’armée. Elles ne sont pas faciles à trouver – la Société des Amis de l’École en sait quelque chose – et, souvent, elles ne valent pas celles que leur assurait l’École. Foch déplorait ces trop nombreuses démissions, alors, disait-il, que ceux qui entrent maintenant dans l’armée sont sûrs d’être généraux.
Le but de la vie n’est pas uniquement de gagner de l’argent ; le minimum qu’il faut, le pays doit l’assurer à ses officiers. Que, sans cesser de l’éclairer – et vos anciens s’y efforcent – on lui en laisse le temps : il le fera. Et il faudra bien aussi qu’on redonne aux officiers les avantages moraux d’autrefois.
Je viens de parler du recrutement de l’École. Il y a un autre recrutement autrement important : celui de la France. Il ne suffit pas de vaincre, il faut survivre à la victoire. Sauver la France, c’était le devoir d’hier ; le devoir d’aujourd’hui, c’est de la perpétuer. […]
Appeler l’attention des Français sur l’urgence d’assurer le recrutement de la France, voilà une belle croisade à faire, digne de vous, mes camarades. Cette croisade, Foch vous la demande, nos 800 morts l’imposent : il ne faut pas qu’ils soient morts pour rien. Le succès en sera lent : mais, vous le savez bien, il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
Je m’arrête. En parlant de Foch, en rappelant ce qu’il faut pour que la France dure, j’ai fidèlement suivi la plus belle partie de notre vieille devise : « POUR LA PATRIE.
_________________________________
1. Le fac-similé de ce discours est disponible sur demande à olivier.herz [at] m4x.org