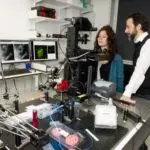La bioéthique et les trois petits singes
Il était une fois un roi qui était atteint d’un terrible mal. Les médecins convinrent que le seul remède possible serait de lui faire une greffe à partir d’un être humain sélectionné. Le roi ordonna de rechercher un homme correspondant à la description des médecins. Finalement, on trouva un jeune paysan qui remplissait toutes les conditions et, après avoir donné de l’argent à ses parents, on l’emmena à la Cour. Là, le juge promulgua un décret aux termes duquel il était permis de faire couler le sang d’un sujet innocent lorsqu’il s’agissait de rendre la santé au roi.
Au moment où le bourreau allait procéder à l’exécution, le jeune garçon tourna son visage vers le ciel et se mit à rire. Le roi, stupéfait, lui demanda les raisons de son allégresse. L’enfant répondit : « Le devoir des parents est de protéger leurs enfants, celui du juge d’entendre les plaignants et celui du roi de défendre ses sujets. Mais mes parents m’ont voué à la mort, le juge m’y a condamné et le roi y trouve son avantage. Je ne cherche plus refuge qu’en Dieu. »
Le roi fut ému aux larmes par ces paroles et s’écria : « Ma mort est préférable au sang d’un innocent. » Il embrassa l’enfant, lui conféra de grands biens et lui rendit la liberté. On raconte que, dans la même semaine, le roi recouvra la santé.
Ce conte du poète persan Saadi (XIIIe siècle) est très bioéthique avant l’heure. On y trouve déjà tous les ingrédients de nos modernes tourments : argent, pouvoir, immortalité… À y regarder de près, les choses ont-elles vraiment changé depuis cette époque ? Rien n’est moins sûr. Le mythe de l’ogre n’est pas mort et les puissants se repaissent encore de chair fraîche pour s’enivrer des illusions de l’éternelle jeunesse. Le cannibalisme embryonnaire devient un témoignage revendiqué de solidarité entre les générations. Le thème de la transgression est en permanence resservi à de doctes assemblées qui finissent par trancher héroïquement dans des directions neutres. Et l’argent permet toujours de tout acheter, y compris la vie d’un congénère dont le jeune âge déprécie la cote.
La seule chose qui change, c’est le dénouement de l’histoire. Celle de Saadi connaît une heureuse fin puisque le souverain, par un acte intelligent et courageux, renonce à une monstruosité et y gagne sa propre guérison. Mais notre histoire bioéthique à nous, Occidentaux du XXIe siècle, c’est-à-dire l’inscription législative de notre aptitude à agir dans le domaine de la vie (bio) conformément à la sagesse humaine (éthique), est en passe de tourner court.
En effet la bioéthique se meurt de faire comme les trois petits singes d’ivoire trônant sur les vieilles commodes coloniales. Elle se suicide en fermant la bouche, les yeux et les oreilles sur ce qui constitue son objet propre et son bien le plus précieux, à savoir la vie humaine. À partir de trois exemples d’actualité inspirés par la discussion législative en cours – l’instrumentalisation de l’embryon, le clonage et le dépistage anténatal – nous nous interrogerons sur une dérive conduisant à la perte du sens mais qu’il serait simple de stopper à condition de le vouloir.
L’homme indicible
Le fait qu’il n’y ait plus de mot pour dire l’homme n’est pas la moindre bizarrerie de notre époque. Le nom de l’homme est devenu imprononçable, inarticulable, indicible, ineffable, inexprimable, indéfinissable, innommable. Parcourez les médias qui couvrent la perspective législative prochaine d’autoriser la destruction de l’embryon humain à des fins de recherche. Il est question de pré-embryons, d’embryons préimplantatoires, d’embryons surnuméraires, en plus, en trop, périmés, abandonnés, ne faisant plus l’objet d’un « projet parental », d’ovules fécondés, de cellules souches embryonnaires, de matériel embryonnaire, etc.
De l’humain, il n’est guère fait mention. Les mots valsent, hésitent, bafouillent, bégayent, dérapent pour nommer l’homme. On a noyé l’humain dans la vase du vocabulaire, on l’a étouffé sous l’édredon de la terminologie, enseveli sous l’avalanche de la cuistrerie. L’homme n’a plus de nom. Il est privé de substantif. Il n’est plus qu’une ombre, un creux, un négatif flanqué de qualificatifs glauques. C’est un peu comme si un nouveau clergé imposait à l’embryon humain de ne sortir qu’accompagné d’un commissaire sémantique lui interdisant de révéler ontologiquement ce qu’il est : un homme.
Pourtant, de quoi s’agit-il ? Il est tout simplement annoncé qu’à condition de bien vouloir accepter le principe de la vivisection de l’embryon humain vivant pour lui prélever ses précieuses cellules souches, la recherche va effectuer des bons de géant et que nous serons bientôt guéris de maladies dégénératives telles que Parkinson, Alzheimer, chorée de Hungtington, etc. Aux États-Unis, de prétendues conférences de consensus associant médecins, chercheurs et malades font pression pour que l’utilisation de l’embryon humain soit autorisée.
En France, j’ai assisté à une rencontre de ce type, organisée par l’AFM. Tous les scientifiques invités, sans exception, étaient favorables à la destruction de l’embryon humain à des fins de recherche. Et face à cette apologie de la transgression, les malades présents étaient priés de comprendre qu’ils ne guériraient que s’ils consentaient à la destruction embryonnaire. Tragique dilemme qui n’a pas empêché l’association de saisir les parlementaires de ses conclusions convenues dans l’espoir que cette fontaine de jouvence d’origine embryonnaire garantie soit sans délai mise en exploitation légale.
Mais il faut le dire, cette piste est fausse. D’abord et surtout pour une question de principe : il n’y a pas de progrès humain à supprimer un membre de l’espèce humaine. Quand la première proposition d’une démarche qui se veut scientifique, au service de la communauté humaine, commence par la destruction de l’existence d’un être humain vivant, les fondements de l’édifice à construire sont déjà vermoulus. Il est pernicieux de vouloir aller au-delà. Oui mais, rétorqueront certains, si ces embryons de toute façon voués à la mort servent à la guérison de malades ? Le principe ne saurait être ébranlé par des arguments si indigents. Quand Robert Badinter ferraillait contre la peine de mort, à certains qui tentaient d’obtenir des exceptions pour des crimes particulièrement odieux, contre les enfants par exemple, il répétait qu’il se battait pour une question de principe et qu’aucune exception n’était recevable.
En matière bioéthique, la proposition est hélas ! renversée : l’enjeu est de légiférer toujours plus avant sur des exceptions à un principe de civilisation structurant, celui du respect de la vie humaine ; il s’agit » d’encadrer les dérives « , c’est-à-dire de céder à une tentation superstitieuse de changer la règle pour être en règle. Rappelons que, contrairement à ce qui est souvent répété avec complaisance, la transgression éthique n’a jamais été un facteur de progrès médical. Les illustrations de ces prétendues transgressions médicales constituent peut-être, au pire, des transgressions sociales, mais certainement pas des transgressions éthiques : l’autopsie, la transfusion sanguine ou les prélèvements d’organes post mortem sont des actes qui ne sont pas anodins mais enfin ils ne tuent personne et restent au service de la vie. En revanche, les transgressions éthiques qui ont été commises par les médecins dévoyés du régime nazi n’ont entraîné aucun progrès scientifique. Et aujourd’hui les expérimentations sur les embryons et les fœtus qui sont déjà pratiquées légalement dans certains pays du monde n’offrent aucune perspective thérapeutique.
À cet argument de principe, en lui-même suffisant, s’ajoutent d’autres raisons techniques surabondantes de ne pas utiliser l’embryon humain. Cellules souches embryonnaires et cellules souches adultes, bien que présentant des similitudes, diffèrent cependant sur un point capital : les cellules souches embryonnaires prolifèrent à l’infini, propriété qu’elles partagent avec les cellules cancéreuses, ce qui les rend dangereuses. Les cellules souches adultes, au contraire, ne manifestent leur capacité de prolifération et de différenciation que lorsque cela est nécessaire au maintien de l’intégrité de l’organisme.
Ainsi donc, pour la thérapie cellulaire, seules les cellules souches adultes peuvent être utilisées, car l’organisme sait les contrôler. Ensuite, on aurait tort d’oublier que les embryons surnuméraires produits par fécondation in vitro dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont quatre fois plus porteurs d’anomalies congénitales que la moyenne. Il en ressort que l’usage thérapeutique des cellules souches de ces embryons contrevient directement au principe de précaution.
La vérité sur l’appétit pour l’embryon humain est prosaïque. Elle figure dans les rapports de l’Académie des sciences et de l’Assemblée nationale. Ce qui est en jeu, c’est la mise à disposition de l’industrie de lignées de cellules souches embryonnaires utilisables en toxicologie et en pharmacologie et ceci pour remplacer les tests chez l’animal dans le développement des médicaments. Alors pourquoi l’embryon humain ? Parce que le recours aux embryons de primates, qui permettraient de mener la plupart des expérimentations, « présente un inconvénient majeur : son coût » (le coût de l’élevage des primates) et surtout « il se heurte partout dans le monde à des oppositions bien organisées »… Ces rapports, curieusement, ne fournissent d’ailleurs pas le nombre précis des embryons surnuméraires qui existent et dont il est prévu d’accroître le stock pour qu’ils fassent l’objet d’appropriation avantageuse par les laboratoires publics ou privés. Dans ces conditions, on mesure le poids du silence sur l’irréductible humanité de l’embryon.
L’homme invisible
Faire disparaître, aux yeux de nos contemporains, l’humanité de l’embryon produit par clonage est une autre performance à laquelle se prêtent un certain nombre d’acteurs intéressés. Cet escamotage expérimental qui s’apparente à une forme grossière de négationnisme scientifique pose une question : à qui profite le crime ? Qui est vraiment opposé au clonage ? Dans le clonage, le risque d’inversion des repères de l’engendrement est tel, le symbole de ce qui a été qualifié d’inceste biologique est si grave, que seul un masquage de la réalité permet de faire avancer la technique dans l’inconscient collectif.
Aussi, pour les besoins de la cause, a‑t-il été inventé un « méchant » clonage, le clonage reproductif, et un « gentil » clonage, le clonage dit thérapeutique. Le « méchant » clonage, reproductif, sert de repoussoir. Il est chargé d’attirer sur lui toutes les malédictions. C’est le bouc émissaire. Il est voué aux gémonies solennellement par toutes les autorités qui comptent dans le monde. Jamais, proclament-elles unanimement, la main sur le cœur, on ne consentira à reproduire un autre être humain vivant. Chaque être humain est unique et irremplaçable. Le dupliquer serait une illusion (Mozart) ou une désillusion (Staline). Soit.
En revanche, il existe un « gentil » clonage, dit thérapeutique, qui, lui, n’aurait rien à voir avec le précédent. Il consisterait simplement à transférer quelques-unes de vos propres cellules somatiques dans un ovule énucléé et à cultiver l’ensemble avec la finalité altruiste de vous en faire bénéficier dans le cadre de la thérapie cellulaire. La malice de cette alternative est qu’elle n’existe pas. D’abord l’usage thérapeutique des cellules embryonnaires est une fausse piste, nous l’avons vu. Ensuite le transfert de noyau somatique, c’est très précisément du clonage reproductif. Il n’y a pas deux types de clonage, l’un pour produire des bébés qui serait immoral et l’autre qui pourrait être accepté parce que sa finalité serait de produire des médicaments. Le clonage, s’il fonctionne dans l’espèce humaine, ce qui n’est pas encore démontré, est toujours reproductif. Le clonage dit thérapeutique n’est qu’un clonage reproductif interrompu au cours du développement embryonnaire pour en extraire, moyennant la destruction de l’embryon, les cellules souches convoitées.
En réalité, les partisans du clonage sont beaucoup plus nombreux qu’on ne l’imagine, mais ils voudraient nous (et se) rassurer en faisant naviguer le clonage reproductif sous le pavillon de complaisance du clonage thérapeutique. En somme, ils sont favorables à l’interdiction incantatoire du clonage par convenance en même temps qu’ils sont favorables à son autorisation pratique par intérêt.
Le résultat de cet aveuglement sur la nature humaine de l’embryon produit par clonage est saisissant. On y voit les plus hautes autorités morales et intellectuelles du pays y perdre leur latin. L’opinion publique est à la dérive. Et les parlementaires se font des illusions en réservant un sort différent aux deux types de clonage. Criminaliser le clonage reproductif est une mesure nécessaire. Mais seulement différer l’autorisation du clonage dit thérapeutique par opportunité (le temps de résoudre le problème de l’obtention des ovocytes) revient à dérouler le tapis rouge à cette technique – et donc au clonage dit reproductif – qui entrera dans la loi d’ici peu, comme en Grande- Bretagne ou en Belgique.
À la vérité, quel est le scandale du clonage ? Est-ce vraiment le risque de voir naître quelques enfants clonés qui passeront entre les mailles du filet répressif ? Ou n’est-ce pas plutôt l’organisation d’un consensus aveugle sur la conception d’innombrables enfants clonés disponibles et commercialisables en pièces détachées ? Ce qui est strictement la proposition du clonage thérapeutique ! Quel est le rideau de fumée qui empêche d’appréhender cette réalité vérifiable, à savoir que le clonage thérapeutique, c’est du clonage reproductif plus la mort de l’embryon ? Dès lors si le clonage reproductif est un crime, le clonage dit thérapeutique l’est doublement. Et si l’on veut vraiment interdire le clonage, n’est-ce pas d’abord le clonage thérapeutique qui représente une menace ?
L’homme inaudible
Supprimer le malade par une politique de « prévention », faute d’être capable de mobiliser les moyens pour supprimer sa maladie est le révélateur d’une étonnante surdité à la souffrance dans nos fraternelles démocraties. C’est la réponse sans doute pragmatique et utilitariste à une bonne question : comment faire pour donner naissance à des enfants sains ? Mais c’est une mauvaise réponse qui se trompe de terrain en choisissant de se battre contre le malade et non pas contre la maladie. Aucune victoire n’est obtenue contre la souffrance ni de l’intéressé, ni de sa famille, ni du corps social. L’ignorance sort renforcée de la démission intellectuelle consistant à exonérer les chercheurs de tenter de comprendre. La peur reprend du terrain et nourrit l’exclusion de l’enfant handicapé ou malade devenu un rescapé de l’eugénisme pour lequel la médecine restera impuissante et la mort eût été préférable.
Le cadre national français fournit deux illustrations magistrales d’un tel fourvoiement. Ainsi la trisomie 21, anomalie chromosomique qui est la première cause au monde de retard mental, et qui compte de 50 000 à 60 000 malades en France dont l’espérance de vie est passée en quinze ans de 25 à 50 ans, ne fait-elle l’objet d’aucune politique publique de recherche en dehors de la recherche sur le dépistage. La base de données ORPHANET, gérée par la direction générale de la santé et l’INSERM, ne fait apparaître aucun projet de recherche à visée thérapeutique. La direction générale de la santé n’a connaissance d’aucune équipe publique dédiée spécifiquement à la relation entre trisomie 21 et retard mental.
En revanche le coût du dépistage de la trisomie 21, comprenant les marqueurs sériques proposés à toutes les femmes enceintes, l’amniocentèse, le caryotype fœtal et l’échographie, s’élève à 100 millions d’euros par an à la charge de l’assurance maladie. Dans les trois quarts des cas, les enfants dont la trisomie 21 a été dépistée font l’objet d’un avortement qui peut intervenir à tout moment de la grossesse. Cette maladie génétique n’est pas une maladie rare puisqu’elle touche un fœtus sur 600 à 700. Alors qu’il devrait naître normalement environ 1 200 enfants trisomiques, ce nombre est pratiquement divisé par quatre depuis la généralisation du dépistage de masse.
Dans ces conditions, après avoir économisé sur la recherche et tout misé sur le dépistage, il est inévitable qu’éclatent des affaires judiciaires comme l’affaire Perruche dans laquelle la justice a indemnisé l’enfant handicapé qui n’aurait pas dû naître. Il ne faut pas oublier que la sécurité sociale elle-même s’était jointe à l’action de la famille Perruche, estimant que ses finances avaient subi un préjudice propre résultant de cet événement. Que notre système de solidarité nationale fasse valoir en justice le coût résultant de la naissance d’un enfant en mauvaise santé et demande réparation au médecin qui n’aurait pas dû laisser la vie à un trublion de la normalité, en dit long sur la logique qui s’installe dans les pays développés.
Comme en écho, une logique analogue préside aux destinées de l’assistance médicale à la procréation. Là, il s’agit non pas d’extraire un enfant indésirable du ventre des mères mais de n’y introduire qu’un enfant désiré. L’épisode de la naissance du premier enfant né en France après diagnostic préimplantatoire, c’est-à-dire après tri embryonnaire, dans une famille déjà éprouvée par le handicap a donné lieu à une mystification éloquente. L’information qualifiée de « grand succès thérapeutique » répercutée par les médias est que cet enfant a pu naître indemne de la grave maladie qui frappait sa famille grâce à la recherche médicale financée notamment par le Téléthon. Mais comment évoquer un succès thérapeutique consécutif à la générosité du public à propos de la naissance d’un enfant en bonne santé qui n’a jamais été guéri puisque, survivant au tri embryonnaire l’ayant déclaré sain, il n’a jamais été malade et donc n’a jamais été traité ?
Au fond, la problématique de l’embryon et celle de la personne handicapée se rejoignent. L’un et l’autre, avec cette fragilité qui est leur force, ne doivent pas être la cause de notre rejet, ni le motif de notre pitié, mais une source d’inspiration pour notre action politique et scientifique. Comprenons – et je pense que des parents d’enfants handicapés le diraient encore mieux – que ce n’est pas nous qui les protégeons. En réalité, ce sont eux qui nous protègent de nous-mêmes et de nos folies.
C’est pourquoi la Fondation Jérôme- Lejeune, reconnue d’utilité publique, qui finance dans le monde entier la recherche sur les maladies de l’intelligence d’origine génétique et qui représente en France le premier financeur de la recherche sur la trisomie 21, a fait le choix d’un avenir où les progrès de la science restent au service de l’homme.
Elle s’engage à financer exclusivement les recherches qui respectent l’être humain dès le commencement de sa vie. Ayant hérité du Pr. Jérôme Lejeune la plus importante consultation de personnes souffrant de déficiences intellectuelles, la fondation s’efforce modestement de ne jamais dissocier l’éthique, la science et la prise en charge en conjuguant toujours ensemble les verbes : chercher, soigner, défendre. La méthode n’a rien d’original, elle puise à une source hippocratique qui recommande d’abord de ne pas nuire, mais qui tend à être oubliée aujourd’hui. Rien n’interdit à personne d’y revenir, services publics en tête.
Car, finalement, a‑t-on jamais donné de meilleure réponse aux défis de plus en plus complexes posés par la bioéthique que le principe de réalité rappelé par le poète Saadi : embrasser l’enfant, lui conférer de grands biens et lui rendre la liberté ? Jérôme Lejeune pensait qu’il n’y avait pas de solution scientifique à la folie des hommes. Nous ajouterons que tout ce qui n’est pas donné au plus petit des hommes est perdu pour l’humanité. Que les politiques et les scientifiques veuillent bien méditer intelligemment et courageusement toutes les conséquences de cette sagesse éternelle – éternellement menacée – et nous leur donnons sans inquiétude carte blanche.