La crise de la globalisation, un défi économique et politique
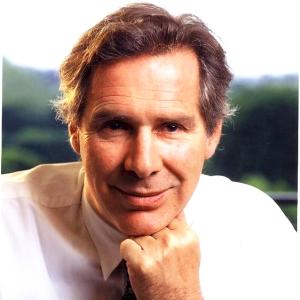
Révélée par la crise financière, la crise de la globalisation détériore le bien public mondial qu’est la stabilité économique et monétaire. Nous manquons cependant encore de modèles adéquats de cette globalisation.
REPÈRES
Le processus dominant et emblématique de la globalisation est la création du couple « Chinamérique « . La Chine, afin de maximiser son rythme de rattrapage, exporte massivement ses excédents de marchandises et d’épargne aux États-Unis qui les acceptent. Ce processus a largement favorisé le maintien de taux d’intérêt bas qui ont amplifié les effets de levier excessifs, centraux dans la crise financière. Il a engendré aux États-Unis et ailleurs une dynamique de croissance par endettement des ménages insoutenable à long terme. Les fruits de la globalisation sont très inégalement répartis. Des continents entiers en sont exclus, voire maintenus dans des trappes de pauvreté. Au sein des pays riches et émergents, les inégalités explosent, faisant chaque année des millions de nouveaux pauvres relatifs.
La crise de la globalisation, révélée par la crise financière, pose de sérieux défis à une théorie économique qui reste encore mal armée pour l’analyser et proposer au débat public des processus de sortie de crise. En effet, l’instrument principal dont elle dispose est la théorie du commerce international, qui analyse en détail les conséquences de l’ouverture des frontières au commerce des marchandises. Or cette théorie est d’une part épuisée d’autre part inadéquate à un phénomène, la globalisation, qui ne se réduit pas à l’ouverture commerciale.
Les imperfections du marché
La théorie du commerce international est épuisée par son succès même. Dans les années soixante-dix, comme dans la plupart des compartiments de l’économie, l’introduction des imperfections de marché et de l’économie politique révolutionne les modèles.
La théorie du commerce international est épuisée par son succès même
Ces imperfections sont : les monopoles, dus aux rendements d’échelle croissants et aux économies de réseau et d’agglomération, les autres externalités positives (telle la diffusion des connaissances) et négatives (telles les pollutions). Elles sont toutes fondées sur l’incomplétude et l’asymétrie de l’information, laquelle rentre ainsi en force dans la théorie économique. Quant à l’économie politique, elle introduit une vision moins naïve des gouvernements. On peut, certes, les modéliser comme cherchant à maximiser » l’intérêt général « , mais aussi tout simplement à gagner la prochaine élection.
Les imperfections de l’État
Sont introduites ainsi, symétriquement aux imperfections de marché, des « imperfections de l’État « . Elles ne proviennent pas seulement de ce que les actions de l’État dans la sphère économique peuvent être » polluées » par des motifs politiques, mais aussi de ce qu’elles rencontrent, comme c’est le cas pour les acteurs privés, une information imparfaite et asymétrique.
Travail qualifié et non qualifié
Les modèles de commerce international sont par ailleurs trop restreints pour décrire une globalisation qui excède largement une simple ouverture des frontières aux flux de biens et services. Témoin de l’insuffisance du cadre analytique de ces théories, le débat très vif initié à la fin des années quatre-vingt-dix autour de la question : » La globalisation est-elle coupable de l’augmentation des inégalités dans les pays riches ? » Non, avaient répondu la plupart des économistes, car le « commerce avec les pays à bas salaires » ne pouvait expliquer qu’une faible part de l’augmentation des inégalités.
Le raisonnement était simple. Dans un pays riche, le commerce avec un pays à bas salaires détruit des emplois, généralement non qualifiés, et augmente la demande d’emplois qualifiés. En effet, le pays riche exporte des biens comprenant peu de travail, mais qualifié et cher, en échange de biens comprenant beaucoup de travail peu qualifié bon marché, importés des pays pauvres. Il est alors facile de mesurer l’effet mécanique direct, sur les inégalités entre travail qualifié et non qualifié, du seul commerce avec les pays à bas salaires.
Démontrer ce qu’on veut
L’épuisement de la théorie du commerce international vient de ce que ses modèles ont été enrichis et diversifiés à un point tel qu’ils permettent désormais de « démontrer » à peu près ce que l’on veut, s’agissant des relations de causalité entre ouverture commerciale, croissance et inégalités. Avec un modèle comprenant des imperfections de marché en quantité et en intensité ad hoc, et un comportement des États de même, on peut « démontrer » que : l’ouverture commerciale stimule la croissance et réduit les inégalités, ou qu’elle stimule la croissance en accroissant les inégalités, ou l’inverse, ou qu’elle ne favorise ni la croissance ni la réduction des inégalités. De plus, ces résultats peuvent varier fortement selon des conditions exogènes parfois bien difficiles à définir et a fortiori à quantifier, telle la « bonne gouvernance ». Ce ne serait pas très gênant si des tests empiriques robustes permettaient de trancher entre les différentes thèses. Or c’est rarement le cas, pour de multiples raisons : pertinence et qualité des données, corrélations entre variables du modèle, données exogènes non statistiquement « contrôlables ».
Des investissements défensifs
Les pays riches à la fin des années quatre-vingt- dix étant en réalité peu ouverts au commerce avec les pays à bas salaires, cet effet était très limité. Pour les partisans de cette analyse, c’était donc essentiellement le progrès technique (le développement des technologies de l’information et de la communication) qui, rejetant du travail non qualifié remplacé par les ordinateurs, expliquait la croissance des inégalités entre travail qualifié et travail non qualifié.
Cependant, on ne se demandait généralement pas pourquoi ce progrès technique était « biaisé » en défaveur du travail non qualifié. Celui des Trente Glorieuses, tout aussi vigoureux, ne l’avait pas été. Pourquoi cette différence ? Cette thèse » la mondialisation n’est pas coupable « , appuyée sur les théories du commerce international, faisait également peu de cas des effets induits du commerce avec les pays à bas salaires. En particulier des investissements défensifs, mis en évidence par Adrian Wood, qui, pour résister à la concurrence des pays à bas salaires (victorieusement, donc pas de trace dans le volume du commerce), substituent des machines aux emplois et réduisent ainsi encore plus l’emploi total. Un bon exemple de : » autre modèle, autre résultat », et dans ce cas comme dans bien d’autres, il fut malheureusement difficile de les tester empiriquement.
Changer de cadre
La globalisation ne se réduisait pas au « commerce avec les pays à bas salaires « , elle se traduisait alors surtout par un accroissement de la compétition entre les territoires des pays développés. Enfin globalisation et progrès techniques sont évidemment liés. Les entreprises orientent la recherche technique selon les incitations créées par la globalisation. Ce débat très mal posé était le signe incontestable qu’il fallait changer de cadre et de méthodes d’analyse.
Compétitifs ou protégés
Pour être à la hauteur des défis que lui lance la globalisation, la théorie économique devrait donc d’une part adopter un cadre d’analyse pleinement adapté aux mobilités particulières qu’autorise et entrave la globalisation actuelle et d’autre part privilégier les modèles dynamiques de simulation des processus sur de longues périodes.
Ce que dit un modèle est toujours en partie déterminé par les conditions initiales
S’agissant du cadre d’analyse, il faudrait selon moi raisonner en termes d’acteurs économiques « nomades », qui mettent en compétition l’ensemble des territoires pour la localisation de l’ensemble de leurs activités, et » sédentaires « , attachés à un territoire.
Pour ce qui est des individus résidents d’un territoire, il faudrait raisonner en termes de » compétitifs « , c’est-à-dire soumis à la compétition avec des acteurs d’autres territoires et » protégés » de cette compétition, quoique très souvent en vive compétition entre eux.
Car les inégalités engendrées par la globalisation se creusent d’abord entre ces deux catégories, les inégalités qualifiés – non qualifiés n’en étant qu’une conséquence.
De grossières simplifications
Il faut par ailleurs modifier le mode d’usage des modèles. Réduire l’importance relative actuellement accordée à l’élaboration foisonnante de modèles théoriques d’équilibre avec solutions analytiques (donc avec d’énormes simplifications des comportements d’acteurs et des relations de marché, qui seuls rendent possible une solution analytique).
Ce qui s’impose est la montée en puissance du « nouvel État mercantiliste »
S’orienter vers des modèles de dynamiques économiques avec imperfections de marché et rationalité limitée des acteurs, qui pour être un peu réalistes sont nécessairement des modèles de simulation.
Autant que possible, chercher à les calibrer dans certaines circonstances historiques et géographiques. Il conviendrait enfin de ne les utiliser qu’à des fins analytiques, l’explication des trajectoires passées, et prospectives, la construction des scénarios de trajectoires futures en fonction des dynamiques et des actions de politique économique qu’ils modélisent.
La ruée des nomades
La globalisation actuelle ne se réduit pas à une ouverture des frontières commerciales. Elle a considérablement accru aussi la mobilité des informations y compris scientifiques, de la monnaie, des titres, et enfin du capital humain porteur de savoir-faire managériaux et techniques de pointe. Des facteurs productifs essentiels, en particulier humains, deviennent ainsi parfaitement mobiles, de purs nomades capables de fertiliser très rapidement le » capital social » sédentaire patiemment accumulé dans les futurs « pays émergents », en particulier durant leur phase socialiste. Si bien qu’une joint-venture initialement, puis rapidement une firme locale, qu’elle soit manufacturière en Chine ou de services informatiques en Inde, obtient la même productivité du travail qu’en Europe avec des salaires bien moindres et qui resteront longtemps tirés vers le bas par la masse paysanne et le secteur domestique formel et informel à faible productivité. Un capital social favorable, un capital humain dont une fraction s’améliore très rapidement, de bas salaires lestés par les masses à faible productivité travaillant pour le marché intérieur, ajoutez à cela les économies dynamiques d’agglomération (il vaut mieux être là où les autres sont déjà que d’être un pionnier isolé ailleurs), voilà qui explique que les nomades du monde entier se ruent dans certaines provinces du monde
Le rôle de l’État
Dans les deux cas, il faut admettre que ce que dit un modèle est toujours en partie déterminé par les conditions initiales et environnantes, par l’intensité supposée et très difficilement quantifiable des imperfections de marché, et enfin par les politiques publiques modélisées qui ne peuvent être que de grossières simplifications des politiques, elles-mêmes très imparfaites, effectivement menées. L’économie devrait donc se contenter de l’ambition de construire des outils heuristiques et des scénarios aux conditions exogènes bien explicitées.
Vers une science expérimentale
L’économie devrait abandonner toute prétention normative et devenir une science expérimentale et pas seulement une mathématique combinant des comportements trop simplifiés. Elle devrait se rapprocher des méthodes à l’oeuvre dans les sciences de l’ingénieur, qui d’ailleurs se rapprochent d’elle par un usage croissant de la modélisation numérique. Elle ne perdra ainsi pas nécessairement en influence, au contraire, mais elle perdra fort opportunément en arrogance. Heureusement, il semble bien qu’un certain nombre d’économistes aient commencé à s’engager dans cette voie. Par ailleurs l’exigence, les techniques et les moyens de l’ancrage empirique des modèles progressent.
Au sein des défis lancés par la globalisation à la théorie économique il en est un qui est particulièrement redoutable, car intriqué à la géopolitique. C’est l’analyse du rôle des États. Bien que l’on ait constaté le retour des » États keynésiens » à l’occasion de la crise économique, ce qui s’impose aux yeux de l’analyste de la globalisation est la montée en puissance du » nouvel État mercantiliste « .
En dehors du maintien de la paix intérieure, le rôle essentiel de l’État contemporain semble être de retenir et d’attirer sur son territoire le maximum des purs nomades que sont devenus les firmes globales et les individus aux compétences hautement valorisables dans la globalisation. Il se comporte ainsi comme les monarchies mercantilistes qui cherchaient à attirer le maximum d’or dans leur royaume.
Une stratégie par nature égoïste et potentiellement conflictuelle. Dans le même temps, les mobilités croissantes multiplient les besoins de « biens publics mondiaux » : climat, biodiversité, contrôle des pandémies, stabilité du système financier et monétaire international, biens qui doivent être » produits » par une coopération volontaire entre grands États.
Une coopération mutuellement bénéfique
Ainsi, pour revenir au couple » Chinamérique « , il est possible de comprendre la rationalité des comportements étatiques et les raisons d’une coopération bilatérale jugée jusqu’ici mutuellement bénéfique. Le gouvernement chinois maximise sa vitesse de rattrapage par une croissance tirée par les exportations et les investissements directs étrangers, le gouvernement des États-Unis élude de possibles difficultés économiques, sociales et politiques issues de l’accroissement des inégalités dues à la globalisation, grâce à une consommation fondée sur une dette croissante dont chacun des deux partenaires sait très bien qu’elle ne sera jamais remboursée
Mais, ce faisant, ils détériorent un bien public mondial, en l’occurrence la stabilité monétaire et financière internationale, ce dont ils finissent par pâtir eux-mêmes, mais de façon différenciée, ce qui engendre de fortes tensions dans l’entente initiale… Modéliser ne serait-ce que la rationalité économique de ce genre de jeu complexe de stratégies concurrentes, tel est le défi dans le défi.

