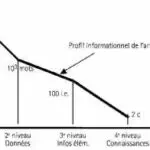La France du nouveau siècle

Tous les peuples aiment qu’on leur parle, et pas seulement qu’on les écoute. Les Français peut-être plus que d’autres, en tout cas par intermittence, parce que, comme le rappelle René Rémond : » Notre culture est largement faite de la conviction que c’est par la politique qu’un peuple conduit son destin au lieu de le subir. » Ainsi observe-t-on que la participation électorale, certes en baisse comme partout, reste chez nous l’une des plus élevées des pays démocratiques. En ce début de siècle, les Français ne sont pas fâchés avec la politique, mais avec une certaine manière de la faire. Ils attendent un discours crédible et dynamique sur les forces et les faiblesses de notre pays, et sur les actions auxquelles il convient de s’atteler pour que la France donne le meilleur d’elle-même. Alors que le monde change à un rythme sans précédent en raison d’une combinaison de facteurs liés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication et aux effets cumulés de la chute des empires au XXe siècle, le silence de nos hommes politiques est assourdissant.
» En trois décennies, observe Hervé Gaymard, on est passé du changer la vie rimbaldien à la pure gestion » – le plus souvent en fait, de la mauvaise gestion -, » et du tout est politique à la politique introuvable, de la dictature du politique […] à la domination sans partage du fait social. » Les citoyens accordent plus volontiers foi à un sociologue, à un journaliste, voire à un astrologue ou un sportif, qu’ils n’écoutent un homme ou une femme politique. » Le miroir de la représentation est fracassé. » Face au malaise provoqué par une situation aussi étrangère à notre culture, il faut redéfinir un projet dans lequel la politique ne soit pas subordonnée au social, la loi bafouée par les droits et le risque nié au nom de la prévention.
Dans ses réponses à la question » Pourquoi la France ne doit pas disparaître ? » Jean-Pierre Chevènement s’inscrit dans cette perspective. Pour lui, comme pour Michelet, la France » est patrie, apprentissage à l’universelle patrie « . Elle est un exemple fort d’articulation entre le particulier et l’universel. La France ne doit pas disparaître parce qu’elle porte le message de la citoyenneté. Le message républicain, pense le fondateur du Mouvement des Citoyens, conserve toute sa force, et se distingue du modèle anglo-saxon où, selon lui, les individus sont » égaux mais séparés « . À l’intérieur, la France doit favoriser le dialogue des cultures pour éviter le choc des civilisations. À l’extérieur, sa mission est d’œuvrer pour une conception polycentrique des relations internationales. Pareil discours fera l’objet de débats, mais l’expérience immédiate de la vie politique montre qu’il se situe à la bonne hauteur.
À la séance solennelle de rentrée des cinq Académies, le 16 octobre dernier, je citais en conclusion de mon propos ces lignes de Victor Hugo : » La France a cela d’admirable qu’elle est destinée à mourir, mais à mourir comme les dieux, par la transfiguration. La France deviendra l’Europe. » En dépit des apparences, il n’y a nulle contradiction à affirmer simultanément que la France ne doit pas disparaître et qu’elle est vouée à mourir par transfiguration, en devenant l’Europe. Dans la France du nouveau siècle, » il y a besoin de dire ce qu’est la politique, ce qu’est la République, ce que doit être un discours à la nation française dans une Europe qui se construit » (H. Gaymard). Mais il faudra choisir entre deux types de discours : l’un, tourné vers le passé et les figures mythiques héritées de la Révolution française ; l’autre, structuré par l’idée de l’Europe à construire, opérant la synthèse du meilleur de notre histoire commune en vue d’exercer à nouveau une influence décisive sur l’avenir de l’humanité.
Ne se sentant pas portés par un grand projet, les Français, mal à l’aise, balancent entre morosité et suffisance. Nous fûmes longtemps au premier rang. À l’époque de l’État royal, au Siècle des lumières, par la force des choses pendant la période révolutionnaire, l’Europe, sinon le monde, se référait à la France. Au xixe siècle, notre recul se cristallisa dans la défaite de 1870. En 1918, nous eûmes brièvement l’illusion de revenir en tête. Puis vint le traumatisme de la défaite de 1940, toujours présent. Et nous n’en finissons pas de digérer la décolonisation. L’un des fondements de notre ambivalence vis-à-vis des États-Unis est un sentiment proche de la jalousie : nous en voulons aux Américains non seulement d’être devenus les premiers, mais d’exercer ce qu’ils appellent leur leadership – nous disons plus volontiers leur hégémonie – en utilisant nos propres cartes, celles des Lumières, de l’universalité, des Droits de l’homme. Autant d’idées qu’à la différence des Américains nous avons d’ailleurs toujours eu tendance, conformément à notre génie, à concevoir de façon plus abstraite que réelle.
Ainsi, Jean-Denis Bredin a‑t-il bien montré que le Droit français a tendance à vouer un culte tout théorique aux Droits de l’homme et à les mépriser dans les faits. La Révolution a proclamé les Droits de l’homme. Elle les a aussitôt anéantis au nom de la souveraineté et de l’infaillibilité du peuple. Nous avons toujours considéré que des » circonstances exceptionnelles » pouvaient justifier – au nom d’un intérêt suprême – le non-respect des droits (voir l’article 16 de la Constitution de la Ve république).
Nous ressentons douloureusement, avec un sentiment d’impuissance, le recul de notre langue. Jean-Marie Zemb a développé le thème de la racine langagière du génie français, en partant du sujet mis au concours de l’Académie de Berlin par le roi de Prusse en 1784 : » Qu’est-ce qui a rendu la langue française universelle ? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative ? Est-il à présumer qu’elle la conserve ? » Nous ne l’avons pas conservée et nous en souffrons comme si s’éteignait le phare qui nous avait permis d’éclairer le monde. Nous craignons pour notre culture – un thème abordé sous différents angles par Jean Drucker, Dominique Lecourt, Dominique Wolton et Michel Zink. Nous sommes minés par le spectre du déclin. Déjà, dans les années 1970, on avait vilipendé le président Valéry Giscard d’Estaing pour avoir qualifié la France de » puissance moyenne « , ce qu’en réalité nous sommes depuis la fin de la Grande Guerre. Il y a deux siècles, nous avions une place prééminente dans la science mondiale, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et notre population est désormais 1 % de celle de la planète.
Mais qui ne voit que c’est l’Europe dans son ensemble qui a reculé au xxe siècle, en raison de ses déchirements ? Ainsi, l’expansion scientifique américaine, par exemple, n’aurait pas eu lieu à cette échelle sans les immigrants européens fuyant le national-socialisme. René Rémond a raison de poser la question : » Pourquoi l’Europe ne retrouverait-elle pas le secret de l’invention ? » Quel que soit l’angle d’attaque, il doit être absolument clair que le renouveau passe par le succès de la construction européenne, que nous devons envisager avec enthousiasme et non comme une sorte de mal nécessaire.
Notre balancement, notre oscillation entre complexes d’infériorité et de supériorité se manifestent d’une manière générale dans la façon dont nous interprétons les chiffres. Nous sommes fiers d’apprendre que, selon les données de la Banque mondiale pour l’an 2000, la France est le troisième exportateur de la planète pour les services commerciaux (après les États-Unis et le Royaume-Uni) et le quatrième pour les marchandises (après les États-Unis, l’Allemagne et le Japon) – ou encore que nous sommes classés en tête, à égalité avec les États-Unis, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse pour le » climat des investissements « . Nous nous gonflons d’orgueil quand une étude de l’Organisation mondiale de la santé – dont la méthodologie est au demeurant très contestable – affirme que notre système de santé est le meilleur au monde, une affirmation que Jean de Kervasdoué et Daniel Laurent ont relativisée en montrant à quel point ce système devait être réorganisé de fond en comble.
Mais nous demeurons interdits, humiliés et vaguement sceptiques, en découvrant que les mêmes indicateurs de la Banque mondiale nous déclassent année après année et nous situent seulement au 23e rang (sur 207 pays classés) pour le PNB par habitant. L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas, la Suisse et bien d’autres nous dépassent. Les statistiques officielles de la Commission européenne nous situent au 12e rang sur les 15 pays de l’Union pour l’an 2000 ! Nous nous offusquons de nous retrouver, selon l’ordre de compétitivité établi par le Forum de Davos – avec une méthodologie là encore contestable – en vingtième position.
En fait, ce genre de statistiques n’a rien de décisif. Suivant la perspective que l’on adopte, on peut les utiliser pour se rassurer, voire pour justifier le statu quo, ou au contraire pour tirer des sonnettes d’alarme et appeler des réformes. Il est vrai, comme le souligne encore René Rémond, que la France n’a jamais autant changé qu’au cours du dernier siècle : ouverture de l’économie, mutation de l’agriculture, acceptation d’une souveraineté partagée, introduction de nouvelles institutions politiques, apprentissage – certes un peu chaotique – de la décentralisation, révolution technologique… Nos performances scientifiques sont très honorables et parfois remarquables. Nous continuons, en particulier, d’exceller en mathématiques.
Arrêtons-nous quelques instants sur le cas du secteur productif. Dans certaines industries comme l’énergie nucléaire, la tradition colbertiste a pu donner de grands résultats. Avec » le cas Renault « , Louis Schweitzer a retracé la saga d’une entreprise devenue le symbole du secteur nationalisé après 1945 et qui semble avoir réussi, malgré les pesanteurs étatiques, à prendre les deux tournants décisifs pour son avenir : celui de l’Europe dans les années 1980 et, plus récemment, celui de la mondialisation au moyen de l’alliance avec Nissan. Avec l’exemple du groupe Lafarge, Bertrand Collomb a infirmé l’identification trop fréquente entre mondialisation et américanisation. Il a également montré que la discipline commerciale la plus exigeante n’empêchait pas de » mettre l’homme au cœur de l’entreprise « , selon la formule de son prédécesseur, Olivier Lecerf.
Mais la mondialisation implique aussi l’internationalisation du dialogue social. Cela doit commencer par l’Europe. Jean-François Dehecq, qui depuis treize années préside au développement de Sanofi, l’une des grandes réussites industrielles de notre pays, plaide lui aussi pour une vision humaniste et européenne de l’entreprise (pour lui, un patron se définit par sa responsabilité vis-à-vis d’une communauté humaine) et affirme justement que l’État national et l’Europe n’ont rien perdu de leur primauté en tant que garants des règles du jeu. On pourrait citer bien des exemples de succès parmi les petites et moyennes entreprises. Que de progrès depuis une vingtaine d’années ! Il n’en reste pas moins que le tableau d’ensemble doit être nuancé. Ainsi la société française est-elle insuffisamment adaptée au développement des » jeunes pousses » (traduction française de la locution américaine start-up), comme l’a montré André Lévy-Lang par comparaison avec les États-Unis : structures de financement inadéquates, fiscalité hostile, rigidités du système de recherche publique et des structures universitaires largement coupées du monde de l’entreprise. Le montant investi dans le capital-risque est dans un rapport de 20 à 1 entre les États-Unis et la France, soit quatre fois plus environ que le rapport des populations ou des PNB. Il appartient à l’État de tirer les leçons de cette disparité préoccupante pour l’avenir.
Les succès de la France sont donc incontestables, mais relatifs. D’autre part, la France n’est évidemment pas seule à avoir connu une immense mutation au XXe siècle. La plupart des États occidentaux ont, certes avec des variantes, vécu des expériences comparables, en particulier les pays européens qui ont rejoint notre Union. On ne saurait par ailleurs sous-estimer les transformations inouïes d’une partie de ce qu’après Alfred Sauvy on a appelé le » tiers-monde « , en particulier en Asie de l’Est. Constater que nous avons beaucoup changé, en fait comme tant d’autres, ne doit pas servir d’alibi à un certain type de discours politique nourri d’autosatisfaction qui justifierait l’absence de réformes – ou de refondation, selon le mot actuellement à la mode – ou, pire, la multiplication de mauvaises réformes, inspirées par la démagogie, l’idéologie et une conception romantique de notre identité – ou encore des réformes déraisonnables par rapport à nos moyens actuels et potentiels.
Or ces risques existent en raison de l’inertie d’un État devenu obèse, alors même que l’État occupe en France une place beaucoup plus grande qu’ailleurs du fait de notre histoire. D’un côté, les statistiques sont effectivement assez rassurantes lorsqu’on ne se montre pas trop exigeant. Avec ou sans elles, nous avons l’impression d’une certaine richesse, qui nous permet encore de faire face sans trop souffrir aux aléas de la vie collective. De l’autre, bien des indices suggèrent que nous aurons bientôt mangé notre pain blanc.
À ce stade, il convient de s’entendre sur la terminologie. En Droit international, un État se caractérise par un territoire, une population, un gouvernement. Quand on parle en France, de la place de l’État, c’est en fait du gouvernement qu’il s’agit, avec ses trois branches exécutive, législative et judiciaire et ses différents niveaux, européen, national, régional ou local. S’interroger sur l’État en ce sens, c’est à la fois s’interroger sur les Institutions et leur organisation concrète – en particulier leurs objectifs et leur efficacité -, et sur la nature des faits sociaux et culturels sous-jacents, à l’instar de ce que Pierre Rosanvallon appelle » l’illibéralisme français « .
Dans la plupart des pays démocratiques, l’élargissement du suffrage universel est allé de pair avec les progrès du gouvernement représentatif. En France, c’est au nom d’un impératif de rationalisation – l’élimination des corps intermédiaires – que s’est instruit le procès de la monarchie dite absolue. Monarchie dont le caractère absolu était en fait tellement relatif que la Révolution est née de l’incapacité du pouvoir royal de réformer les corps intermédiaires. Telle est l’origine du mythe d’un État rationnel, débarrassé des corps intermédiaires à la base de la structure d’ordre de l’Ancien Régime – du mythe d’un État capable de formuler directement l’intérêt général, indépendamment de la délibération ou de l’expérience.
L’abolition des » privilèges » est associée dans l’idéologie dite républicaine à celle des corps intermédiaires. De là aussi le mythe de l’égalité et la figure symbolique des » citoyens » à la fois égaux et frères, rassemblés dans un même corps, celui de la nation. L’avènement de l’État rationnel est donc conçu comme la condition de la liberté. La liberté est pensée contre le libéralisme. Ainsi s’exprime la cohérence de notre devise nationale Liberté, Égalité, Fraternité. Cohérence en fait très marquée par la culture chrétienne. La marque est profonde en vérité, puisqu’on peut aller jusqu’à parler d’une sorte de souffle quasi religieux, sans lequel on ne saurait justifier comment l’État parviendrait à formuler l’intérêt général.
C’est cette conception abstraite de l’intérêt général – j’ai parlé précédemment de notre conception abstraite des Droits de l’homme – dont le marxisme-léninisme a fait un usage monstrueux. C’est elle qui explique que la société française ait manqué le rendez-vous avec le libéralisme politique et avec la social-démocratie. Cette conception imprégnait encore les fondements de la Cinquième République, et la définition que Malraux donnait de la politique : » Quelque chose qui s’appelle l’État va traduire les aspirations de quelque chose qui s’appelle la Nation. »
Dans la réalité, bien sûr, après la longue parenthèse qui va de la Révolution à la phase autoritaire du Second Empire, des corps intermédiaires sont réapparus, mais ils sont restés en porte-à-faux par rapport à l’État. On peut ainsi comprendre la pérennité en France de l’idéologie de la lutte des classes. L’État réel n’est pas l’État républicain abstrait. Il en résulte, dans la vision marxiste, que les classes laborieuses ne peuvent promouvoir leurs intérêts que par le combat contre d’autres classes, mais aussi éventuellement contre l’État lui-même. De là, une conception guerrière de la grève, toujours manifeste dans le secteur des transports, où, à la limite, la société tout entière et donc l’État lui-même acceptent de se laisser prendre en otage. De là, plus généralement en matière sociale, la suprématie de la culture du conflit sur celle du contrat, suprématie que des acteurs comme la CFDT ou le MEDEF ont essayé courageusement de remettre en question.
Denis Gautier-Sauvagnac se bat pour une certaine » décolonisation de la société civile » et, reprenant l’expression d’Alain Peyrefitte, pour l’avènement d’une » société de confiance « . » Paradoxalement, remarque Nicole Notat, les partisans les plus farouches de l’interventionnisme étatique [dans la régulation sociale] sont aujourd’hui les plus sûrs promoteurs de l’État minimum parce qu’ils condamnent l’État à l’inefficacité […]. Nous appelons à une réforme de l’État : la seule référence à la souveraineté populaire fondatrice de notre conception de la démocratie n’est plus suffisante […]. Les partenaires sociaux ne font pas la loi, mais la loi doit leur ménager un espace contractuel où ce droit social puisse s’élaborer. » Encore faudrait-il que les syndicats soient vraiment représentatifs. Moins de 10 % des salariés sont syndiqués (90 % en Suède et au Danemark, entre 25 et 50 % dans la plupart des autres pays européens). Cette faiblesse, rappelle Bernard Brunhes, s’explique par l’histoire et par la législation. L’appartenance à un syndicat ne fait bénéficier l’adhérent d’aucun service ni avantage spécifique. Les accords signés s’appliquent à tous les salariés quels que soient les signataires.
Du coup, ce sont les employeurs, les pouvoirs publics et les organisations de protection sociale qui fournissent leurs moyens aux syndicats, lesquels n’ont donc ni la liberté ni la puissance que leur donnerait une véritable base cotisante. La situation est aggravée par le fait que le dialogue naturel entre le travail et le capital se transforme trop souvent en un débat confus entre syndicats, ouvrant la voie à l’intervention de l’État ainsi entraîné dans sa ligne de plus grande pente, souvent bien loin de l’idée que l’on peut se faire de l’intérêt général.
La France est sans doute, de tous les pays industrialisés à économie de marché, celui où le patronat et plus généralement les patrons sont le moins écoutés par l’État, très méfiant à leur égard quelles que soient les majorités au pouvoir. En fin de compte c’est l’État qui, unilatéralement, et seul parmi les pays comparables, a décidé de fixer l’âge de la retraite à 60 ans et, plus récemment, la durée hebdomadaire du travail à 35 heures. Encore aurait-il pu le faire de façon suffisamment souple pour laisser le maximum de liberté aux partenaires sociaux au niveau de l’exécution.
Même si l’on admet que la durée hebdomadaire du travail relève de l’ordre public défini par la loi, observe Denis Gautier-Sauvagnac, la loi Aubry n’aurait jamais dû comporter 37 articles, couvrir 44 pages du Journal Officiel, s’accompagner de 12 décrets et être suivie de 2 circulaires, l’une de 165 pages, l’autre de 25. Il suffisait de s’en tenir à l’article 34 de la Constitution et de fixer la durée légale du travail à 35 heures en laissant aux partenaires sociaux le soin d’en définir les modalités d’application. Comme il était prévisible, c’est d’ailleurs dans le fonctionnement des administrations que les inconvénients des 35 heures apparaissent de la façon la plus aveuglante, l’État étant un piètre employeur et, en partie pour cette raison, le syndicalisme fonctionnaire ayant tendance, plus encore que les autres, à tomber dans le corporatisme.
Face à tant d’inerties et d’archaïsmes ancrés dans l’idéologie dite républicaine, le projet de » refondation sociale » paraît bien fragile. Et pourtant, il n’y a pas de tâche plus importante que de favoriser son aboutissement. Les réalités de la mondialisation modifient le cadre de l’action. Comme dans bien d’autres domaines, observe Bernard Bruhnes, ce sont probablement les frottements culturels entre partenaires sociaux des différents pays européens qui permettront de progresser en France, à condition d’accepter de repenser la société. » Au duo classique composé du manager et du salarié relève de son côté Nicole Notat se substitue un trio avec l’arrivée de l’actionnaire. » Si l’idée d’un » modèle social européen » a un sens, elle est à rechercher dans un fonctionnement harmonieux et donc contractuel des relations à l’intérieur de ce trio. Il ne s’agit pas de contrarier et encore moins d’abolir le marché, mais de l’humaniser, de l’organiser pour amortir les conséquences négatives des chocs. La même philosophie à la fois pragmatique et humaniste doit inspirer la mise en œuvre de la solidarité de façon générale.
La pusillanimité des discours politiques ambiants sur les retraites alors que les projections démographiques ne laissent aucun doute sur l’urgence des réformes – Jacques Dupâquier, Claude Bébéar et Jean-Michel Charpin l’ont bien montré -, contribue à jeter le discrédit sur la classe politique dans son ensemble. Certes, l’opposition historique des syndicats aux compléments de retraite par capitalisation n’est pas seulement idéologique. Elle s’explique aussi par des facteurs tels que la fragilité du capitalisme français pendant une bonne partie du XXe siècle – en tout cas de 1914 à 1970 – et la méfiance vis-à-vis des placements boursiers. Mais le moment est venu de dissoudre ces obstacles et pour cela de prendre fermement position, comme l’ont fait les Allemands.
La suspicion de l’État français vis-à-vis des corps intermédiaires se manifeste plus généralement à l’égard de la » société civile « . François Terré a rappelé que, de 1871 à 1901, 33 projets et propositions de lois sur les associations ont été élaborés. La question religieuse était naturellement au centre des débats. On était hanté par le problème : comment donner la liberté d’association sans menacer le régime républicain ? Cent ans après la fameuse loi, on dénombre près de 900 000 associations en France, mais la méfiance de l’État n’a pas désarmé. La reconnaissance d’utilité publique, nécessaire pour recevoir dons et legs, est soumise à un régime discrétionnaire et à une surveillance étroite. Contrairement aux États-Unis, par exemple, la fiscalité n’est pas favorable aux associations, trop souvent obligées pour survivre de recourir aux subventions publiques et donc, indirectement, au contribuable, au détriment de leur autonomie, ce qui est le but recherché par l’État. De plus, le statut d’association est souvent détourné par les administrations elles-mêmes, victimes de la rigidité des règles de la fonction publique. Quant aux fondations, leur rôle est encore extrêmement modeste, non seulement bien sûr par rapport aux États-Unis, mais même par rapport à nos voisins européens.
La conception républicaine et jacobine de l’État – Jean-Claude Casanova nous l’a rappelé – est manifeste dans l’Éducation nationale. Toujours la peur d’entités autonomes, distinctes du pouvoir exécutif. Certes, l’Université (au singulier) napoléonienne n’a pas résisté aux évolutions démographiques. Le pluriel est revenu avec la loi Liard qui rétablit les Universités en 1896. Mais l’explosion du nombre des élèves, étudiants et enseignants et l’éclatement de l’autorité, surtout à partir de 1968 et l’apparition des luttes catégorielles au sein du corps enseignant, n’ont pas fondamentalement altéré le caractère monolithique de l’Éducation nationale. Les activités d’enseignement et de recherche sont toujours considérées comme relevant du service public, mais en fait elles sont de plus en plus soumises, notamment en ce qui concerne la recherche, à un pouvoir syndical corporatiste peu compatible avec les critères d’excellence qui devraient s’imposer en la matière.
La République, enfin, n’a pas su faire bon ménage avec l’idée de décentralisation. Le général de Gaulle a posé le problème en 1969. Le 2 février de cette année-là, à Quimper, après avoir rappelé les raisons pour lesquelles la centralisation avait longtemps été une condition nécessaire à l’unité nationale, il observait : » Mais il se trouve, qu’à présent, celle-ci est resserrée, pour ainsi dire automatiquement, par les éléments nouveaux de l’évolution moderne : communications rapides, transmissions instantanées, information partout répandue, crédit généralisé. » L’emploi du verbe » resserrer » était particulièrement heureux. Depuis trente ans, avec les nouvelles industries de l’information et de la communication, notre unité nationale s’est encore davantage resserrée. De Gaulle poursuivait en affirmant que l’unité nationale exigeait désormais un développement équilibré de toutes les régions. Pour cela, la région devrait constituer » un cadre nouveau de l’initiative « , doté d’institutions nouvelles. Il n’allait pas, toutefois, jusqu’à proposer la suppression des départements que la Révolution avait créés quand elle avait ôté aux provinces leur place dans l’organisation administrative de la France.
Le fondateur de la Cinquième République ajoutait : » Pour que cette rénovation se réalise suivant les mêmes principes au plan de la nation en même temps qu’au plan de la région, nous devons transformer le Sénat, afin qu’il associe dans la préparation des lois les mêmes sortes d’élus et les mêmes sortes de délégués [que dans les régions] avec leurs compétences et leurs responsabilités. » Il concluait en annonçant un référendum dont l’issue, chacun s’en souvient, décida de son départ. Il a fallu attendre la présidence de François Mitterrand pour que soit reprise la question de la décentralisation, mais on n’a pas osé procéder à une véritable réorganisation qui eût impliqué la révision des collectivités territoriales existantes, avec des suppressions et des regroupements fondés sur la géographie contemporaine.
On a préféré empiler les échelons de l’administration territoriale (six à l’heure actuelle, de l’Europe à la commune) quitte à multiplier les sources de conflit et de coûteuses inefficacités. S’agissant des régions, on n’a pas voulu ou su aller au bout d’une logique qui exigeait la disparition d’une partie des impôts nationaux, le droit et le devoir pour les régions de lever leurs propres taxes. Là encore, le moment est venu de mener à son terme un processus si fâcheusement étiré dans le temps, faute de courage et de volonté politiques suffisants.
La question de la décentralisation est générique. Pour Jean-Marie Colombani, » la crise corse […] renvoie à la panne d’un projet français « . Il s’agit, conformément à l’esprit du discours de Quimper, de traduire dans les institutions les particularismes d’une région qui, selon l’heureuse formule de Braudel, est » une montagne au milieu de la mer « . Comme les Alsaciens, les Corses ne sont pas originellement de langue française, et l’attachement à leur identité linguistique est légitime. On peut penser, avec le directeur du Monde, que la Corse mérite effectivement un effort économique soutenu de la part de la métropole. Reste la question essentielle : est-il concevable qu’au nom d’une nécessaire autonomie on reconnaisse implicitement à une province française le droit de vivre en dehors de l’État de droit ?
La lutte contre la violence urbaine, l’un des fléaux de notre temps, doit également être abordée dans l’esprit de la décentralisation. Jean-Pierre Delalande a été l’un de ces hommes politiques de terrain qui insufflent l’espoir en démontrant par leurs actes qu’il n’y a pas de fatalité à la violence ; que le maire, premier responsable de la cohésion sociale de sa collectivité, peut – même avec des moyens limités – obtenir des résultats remarquables en coordonnant des actions d’insertion, d’éducation, d’urbanisme, d’aide sociale, de santé, d’environnement. Le rôle de la police est répressif, la prévention appartient aux élus locaux. La solution n’est pas systématiquement dans l’augmentation des crédits publics, mais d’abord dans l’investissement personnel des élus.
D’une manière générale, la décentralisation, c’est aussi l’acceptation – dans un cadre défini par l’État – d’une saine concurrence. Ainsi peut-on imaginer, avec Jean-Claude Casanova, le dynamisme et l’efficacité d’un système où les universités françaises seraient effectivement décentralisées et différenciées – comme le sont plus ou moins nos grandes écoles – donc avec une véritable autonomie pour la gestion, la quête de financements, le choix des étudiants, le recrutement et la rémunération des enseignants, la création d’unités de recherches.
Dynamisme et efficacité : voilà ce qui manque radicalement à notre État, en un temps où les acteurs du monde productif, eux, sont obligés de répondre à de puissants stimuli et de lutter constamment pour leur survie. Michel Albert a montré à quel point la machine fiscale française (qui englobe l’ensemble des prélèvements obligatoires au profit des administrations publiques : État, sécurité sociale, collectivités locales) constitue un » assemblage labyrinthique « . En 1999, le fisc a prélevé 45,7 % du PIB (34 % en 1974, déjà 42 % en 1981), un record national et international, à quoi s’ajoute une dette publique aussi élevée que chez nos partenaires européens (60 % du PIB).
Les 2 000 pages du Code général des impôts constituent un ensemble inextricable et font ressortir l’opacité et l’injustice d’un système non maîtrisé. Le contribuable français doit s’adresser à quatre administrations séparées : la Direction générale des impôts, la Direction générale de la comptabilité publique, la Direction générale des douanes, l’Urssaf. À égalité des montants encaissés, les coûts des prélèvements eux-mêmes sont trois fois plus élevés qu’aux États-Unis ou en Suède. On notera – sur le même registre – que le coût de fabrication d’un billet de banque par le secteur public est environ trois fois plus élevé que dans le secteur privé. La démographie condamne nos pratiques fiscales archaïques.
Le retournement du rapport entre actifs et inactifs se produira en 2006, mettant en péril la solidarité entre générations, comme l’a souligné Jean-Michel Charpin. En fait la limite du supportable semble bien avoir déjà été atteinte en matière d’imposition. Peut-on prendre le risque de la franchir et même de s’y maintenir sans s’interroger enfin sérieusement, en comparaison avec nos partenaires et concurrents, sur les conséquences à moyen et long terme pour notre avenir économique et social ? Dans le cadre d’une réflexion plus générale sur les mouvements de population où il développe aussi la nécessité de mieux penser l’immigration à l’échelle européenne, Claude Bébéar juge alarmante » la fuite de nos élites « . Le fondateur d’AXA attribue l’hémorragie à la fiscalité, mais aussi à une législation et une bureaucratie qui découragent l’esprit d’entreprise, sans oublier le caractère jaloux des Français. Or, ce sont les élites qui font le développement d’un pays, et leur formation coûte cher.
Nous sommes les seuls parmi les pays comparables à ne pas avoir entrepris une grande réforme fiscale depuis les années 1980, comme si le mal qui rongea l’Ancien Régime et le conduisit à sa perte n’avait jamais été éradiqué. Au début du siècle dernier, il avait fallu plus de dix ans pour faire voter l’impôt sur les revenus, qui existait depuis longtemps en Grande-Bretagne, en Allemagne ou aux États-Unis ! Chez nous, depuis la disparition de Maurice Lauré, point de spécialiste internationalement reconnu des problèmes fiscaux. Point de vrais débats en la matière, en particulier pour ce qui concerne les ressources des collectivités locales.
À la fin du XVIIIe siècle déjà, rares étaient ceux qui, comme Turgot, étaient convaincus de la nécessité de réformer les finances publiques en profondeur. Dans une lettre à Louis XVI, rédigée juste après sa nomination au poste de contrôleur général des Finances en 1774, Turgot rappelle au roi ses trois principes d’action : » Point de banqueroute, point d’augmentation d’impôts, point d’emprunts. » Pour y parvenir, écrit-il : » Il n’y a qu’un moyen. C’est de réduire la dépense au-dessous de la recette, et assez en dessous pour pouvoir économiser chaque année […] afin de rembourser les dettes anciennes. Sans cela le premier coup de canon forcerait l’État à la banqueroute. » Le moyen de résoudre cette équation apparemment insoluble, c’est évidemment la réforme, aussi bien du côté de la dépense que du côté de la recette et une plus grande confiance dans le marché, c’est-à-dire dans la liberté d’initiative.
Dès le départ, Turgot avait parfaitement vu le risque. Il adressait au roi ce puissant discours, que chacun pourra transposer dans le vocabulaire et les circonstances d’aujourd’hui : » Je serai craint, haï même de la plus grande partie de la cour, de tout ce qui sollicite des grâces. On m’imputera tous les refus ; on me peindra comme un homme dur, parce que j’aurai représenté à Votre Majesté qu’elle ne doit pas enrichir même ceux qu’elle aime aux dépens de la substance du peuple. Ce peuple auquel je me serai sacrifié est si aisé à tromper, que peut-être j’encourrai sa haine par les mesures mêmes que je prendrai pour le défendre de toute vexation. Je serai calomnié, et peut-être avec assez de vraisemblance pour m’ôter la confiance de Votre Majesté. Je ne regretterai point de perdre une place à laquelle je ne m’étais jamais attendu. Je suis prêt à la remettre à Votre Majesté dès que je ne pourrai plus espérer lui être utile. » De fait, Maurepas, le même qui avec la reine avait provoqué le renvoi de Maupeou et le rappel du Parlement de Paris, ayant réuni la coalition des mécontentements contre Turgot, celui-ci sera disgracié en 1776 et ses réformes annulées.
Aujourd’hui, outre celles précédemment mentionnées, quelles réformes seraient compatibles avec les préceptes de Turgot ? Pierre Joxe a posé le problème général de la réforme de l’État, particulièrement difficile chez nous, car au-delà même des facteurs idéologiques dont j’ai parlé, nous sommes hantés, depuis les guerres de religion au moins, par la crainte de la dissolution de l’État. Nous nous sommes dotés d’un droit administratif, séparé du droit commun, qui affirme la primauté de la puissance publique et qui incorpore des principes d’autorité et de centralisation finalement nuisibles à son efficacité.
Aujourd’hui, il est inévitable d’aborder la question de la réforme en se plaçant à un niveau supérieur au cadre national, en fait au niveau de l’Union européenne. Dominique Perben a exposé une conception rigoureuse de la mutation de la fonction publique qui conduirait à substituer au statut monolithique d’inspiration soviétique adopté à la Libération un système différencié de régulation par objectif et par contrat, et à réduire le nombre des échelons de l’administration territoriale. Incidemment, ne serait-il pas souhaitable de couper le lien entre élus et fonctionnaires et de créer, dans des conditions raisonnables, un statut de l’élu ? Jean-Pierre Boisivon a situé les enjeux de notre système éducatif au XXIe siècle : c’est à l’école que se joue la compétitivité des nations, des entreprises et des individus. La France consacre près de 7,5 % de son PIB à l’éducation (seulement 1 % à l’Université, contre 2,5 % aux États-Unis). Ces ressources ont presque doublé en francs constants en vingt ans quand le PIB progressait de 60 %. Mais pendant ce temps, l’accroissement du coût unitaire moyen de l’élève a été de 70 % en francs constants, sans résultats visibles sur la qualité de la formation.
Certes, les comparaisons internationales nous situent dans une honnête moyenne. Mais le taux d’illettrisme reste très élevé (8 % d’une classe d’âge à la sortie de l’école). La mobilité sociale a plutôt reculé, l’incivilité et la violence des jeunes se sont développées. Serge Feneuille attribue ces phénomènes à une inadéquation croissante du statut idéologique du savoir. Que l’État construise d’abord des hommes et des femmes instruits et éduqués, dit-il, et les entreprises sauront en faire des professionnels compétents. Par ailleurs 90 % des sommes consacrées à l’éducation sont allouées à la formation initiale, au détriment de la formation continue. On peut multiplier les exemples et conclure que c’est dans le management du système que se situent les réserves d’efficacité et de productivité : gestion des établissements, gestion des personnels, logistique pédagogique. L’Éducation nationale est devenue une formidable machine à démotiver ses collaborateurs. Elle administre des postes et ignore les personnes. Du coup, les syndicats se crispent sur des schémas idéologiques figés et sur une conception immédiate de leurs intérêts, au détriment du long terme. La machine est complètement bloquée.
De même, Jean de Kervasdoué observe que la non-gestion des services de santé a et aura, si rien n’est fait, des conséquences encore plus dévastatrices que la démographie. Daniel Laurent relève de son côté que le financement des hôpitaux par le budget global est une aberration, car on entretient des structures indépendamment de leurs performances. Les hôpitaux ne sont pas en mesure d’évaluer leurs coûts. Et, comme pour l’Éducation et l’Université, on n’a pas encore fait l’effort d’identifier clairement celles de leurs fonctions qui relèvent du service public.
D’une manière générale, il faut en finir avec l’attitude selon laquelle on ne peut résoudre les problèmes publics qu’en accroissant les dépenses et le nombre des fonctionnaires, sans rien changer aux structures. Ce n’est au contraire que par d’amples réformes structurelles qu’on dégagera les marges de manœuvre nécessaires pour adapter les effectifs et plus généralement les moyens là où ils sont notoirement insuffisants. Jean-Marc Varaut observe ainsi qu’entre 1985 et 1995 le nombre des juges a augmenté dix fois moins que le contentieux civil. La loi des 35 heures a encore allongé les délais déjà considérables, au détriment des plus faibles. La justice comme la gendarmerie et la police doivent sûrement recevoir des moyens supplémentaires, ce qui ne les dispensera pas, au contraire, de réformes.
Seule la réorganisation de l’ensemble des administrations et services publics permettra de réunir aussi les ressources nécessaires à une ambitieuse politique européenne et extérieure, à la défense nationale et européenne, à la promotion de notre culture et de notre langue. Dans tous ces domaines, il convient de bien formuler des projets bien pensés, mais cela ne suffit pas. Il est indispensable de les incarner dans des organisations appropriées, conduites avec les meilleures méthodes et techniques du moment, comme sont contraints de le faire, sous peine de sanctions, les entrepreneurs ou les militaires pour atteindre leurs objectifs. De ce point de vue, hommes politiques et hauts fonctionnaires doivent retrouver un esprit de conquête qu’ils semblent avoir perdu.
Au terme de son étude sur La disgrâce de Turgot, Edgar Faure écrit ces lignes : » On peut soutenir – et nous le pensons – que le grand malaise de l’Ancien Régime était, au moins dans son origine, d’ordre économique. Turgot était bien qualifié pour traiter le problème économique, puisqu’il était un des rares à l’apercevoir, et il n’eût pas manqué, dans la poursuite de l’action, de corriger les erreurs ou les outrances de la théorie. Mais la réforme économique d’une société exige certaines conditions politiques dans l’État. Ces conditions ne se trouvaient pas réunies, et quand elles le furent, quinze ans après, par l’embryon de représentation nationale des État généraux, alors, naturellement, il était trop tard et depuis longtemps. À défaut cependant d’avoir pu sauver le régime, Turgot en a‑t-il précipité la ruine comme on lui en a fait quelquefois le grief ? Si le grief est absurde, le fait est probable. À ce point où seule la plus vigoureuse réforme pourrait conjurer la Révolution, l’annonce infructueuse de la réforme ne peut qu’en accélérer […] le mouvement désormais incoercible. »
Ici, l’auteur rejoint Tocqueville. Et il ajoute » Il n’y a pas de politique sans risque, mais il y a des politiques sans chance. » Edgar Faure a évidemment raison. Mais tout est une question de préparation et de moment. Les Français, dans leur immense majorité, ne souhaitaient pas l’abolition de la monarchie. Louis XVI avait un caractère faible mais plus profondément il manquait de sens politique. Eût-il été mieux inspiré, il aurait fait en sorte de s’appuyer sur le Tiers-État. Quand le roi flottait en n’adhérant durablement à aucun projet et ne construisait pas les appuis nécessaires à l’aboutissement de toute œuvre politique, aucun technocrate, comme on dirait aujourd’hui, ne pouvait réussir.
Réformer, c’est s’adapter à la réalité. À défaut de savoir s’adapter, on disparaît. Ceux qui refusent d’évoluer et prétendent figer les situations enclenchent des forces dont ils perdent le contrôle et qui finissent par les engloutir. La pensée révolutionnaire veut que de gré ou de force la réalité épouse l’idée. Mais la réalité se venge et les révolutions tournent généralement mal. La Révolution française n’a pas fait exception.
Certes, la France de 2001 n’est pas celle de 1788. Et pourtant nous vivons le paradoxe d’un État trop étendu, où de plus en plus les fonctionnaires font la politique, un État mal géré et pour tout dire ruineux, en même temps trop faible, c’est-à-dire incapable de formuler le bien public et d’imposer son autorité à ceux-là mêmes qui sont supposés le servir. Un État qui, à force de vouloir tout contrôler, risque de ne plus rien maîtriser.
Le général de Gaulle pensait que les nouvelles institutions permettraient de réaliser une modalité démocratique de l’alliance, au XVIIIe siècle, de la philosophie des Lumières et du despotisme éclairé. Que reste-t-il de cette intention ? Quel homme d’État parviendra à formuler un projet à la fois réaliste et enthousiasmant, tendu vers l’avenir, et à bâtir le socle social sans lequel aucune réforme ambitieuse n’est possible ? Le destin de la Cinquième République se jouera dans les prochaines années en fonction de son aptitude, selon la belle formule de Jaurès, à » partir du réel pour aller à l’idéal « .