La science procède aussi de l’imaginaire





Le fait que la science procède non seulement de la pensée rationnelle mais aussi de l’imaginaire la rapproche des autres formes de création, artistique ou littéraire.
REPÈRES
Le débat rapporté ici a réuni :
- Catherine Cesarsky, astrophysicienne, ancien haut-commissaire à l’énergie atomique,
- Jean-Pierre Changeux, biologiste, professeur émérite au Collège de France,
- Thomas Grenon (83), directeur général du Muséum national d’histoire naturelle,
- Maurice Mourier, écrivain, membre du conseil d’administration de la Société des Amis du Palais de la découverte,
- Alexandre Moatti (78), ingénieur en chef des Mines, auteur scientifique, président de la Sabix.
L’IMAGINAIRE AU CŒUR DE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE
Jean-Pierre Changeux : La question de l’articulation entre la science et l’imaginaire est selon moi tout à fait pertinente, elle est même au cœur de la science ou plus spécifiquement de la recherche scientifique, ce mouvement permanent qui vise à acquérir des connaissances objectives sur le monde mais aussi à les faire progresser.
Mais qu’appelle-t-on connaissances objectives ? Depuis Claude Bernard et Louis Pasteur, on s’entend très largement sur les modalités qui permettent d’établir cette objectivité en articulant théorie et expériences. Les hypothèses, on le sait, ne prennent de réelle valeur que si des expériences permettent d’en affirmer la validité.

Louis PASTEUR
L’objectivité en science repose sur la complémentarité entre théorie et expériences.
Philippe Lazar : En parlant d’expériences, je suppose que vous n’excluez pas les observations en tant que modalités de légitimation des théories ?
J‑P.C. : Cela va de soi. Faute de quoi les géologues ou les astronomes ne seraient pas des scientifiques. « Faire une expérience », c’est pour moi mettre une théorie à l’épreuve en la confrontant à la réalité par des méthodes adéquates.
L’imaginaire est à la source du progrès des connaissances
Mais où se situe l’imaginaire dans ce processus ? Eh bien, il est partout. Il est évidemment d’abord dans la genèse desdites hypothèses, pour autant bien sûr qu’elles soient réellement nouvelles. Mais il est aussi dans les innovations techniques dont parfois seules l’audace et l’inventivité permettent de concevoir les moyens pertinents pour les valider. Faire appel à l’imaginaire (ou à l’imagination, faut-il vraiment faire la différence entre ces deux mots ?) est donc une condition strictement nécessaire au progrès des connaissances.
 Catherine Cesarsky : Et les véritables bonds en avant se font à partir d’intuitions fulgurantes dont nous ne savons pas exactement d’où elles proviennent.
Catherine Cesarsky : Et les véritables bonds en avant se font à partir d’intuitions fulgurantes dont nous ne savons pas exactement d’où elles proviennent.
J‑P.C. : On peut penser qu’elles sont engendrées par le travail que fait notre cerveau sans que nous en soyons nécessairement conscients.
 Maurice Mourier : Est-ce que le mot imaginaire implique dans votre esprit l’idée d’image ?
Maurice Mourier : Est-ce que le mot imaginaire implique dans votre esprit l’idée d’image ?
J‑P.C. : Oui, bien sûr, le travail que je viens d’évoquer prend incontestablement appui, contrairement à beaucoup d’idées reçues, sur d’authentiques images.
Ainsi Jacques Monod a bien décrit la façon dont il voyait, dans son espace conscient, une protéine tourner. Pour moi, qui suis de tempérament imaginatif, je suis également habité de la sorte mais peut-être parfois de façon plus abstraite.
Le mathématicien Alain Connes, lui, va encore plus loin : il a le sentiment que sa discipline lui permet de pénétrer par la pensée dans un monde peuplé d’objets préexistants qu’en tant qu’explorateur il découvrirait.
M.M. : Votre réponse va à l’encontre de ce qu’habituellement croient les littéraires, persuadés que les scientifiques ne fonctionnent pas par images, surtout les mathématiciens, c’est-à- dire les acteurs des sciences les plus abstraites qui soient. Ce ne peut être qu’une heureuse découverte que ce rapprochement, pour eux inattendu.
Les littéraires sont persuadés que les scientifiques ne fonctionnent pas par images
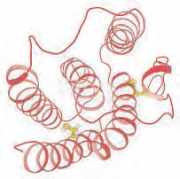
Jacques Monod voyait les protéines tourner. © ISTOCK
J‑P.C. : D’autres facteurs interviennent aussi bien sûr dans la dynamique évolutive qu’est la recherche pour lui permettre d’aboutir, à certaines étapes, à mettre en évidence de ces « singularités » de la rationalité qu’on appelle des « découvertes » (un terme que personnellement je n’aime pas beaucoup).
À ce propos, je veux insister sur un point qui est pour moi majeur : tout ce que nous pensons « découvrir » résulte en fait de l’activité de notre cerveau, de ce cerveau humain qui étiquette un monde qui, lui, n’est pas « naturellement » étiqueté. L’une des propriétés du cerveau, assez récemment mise en évidence, est qu’il fonctionne non pas comme un ordinateur nourri par un programme préparé à l’avance mais bien de façon projective : il se projette en permanence sur ce qui va se passer. Il engendre donc de façon spontanée ce que j’ai appelé des préreprésentations où l’imaginaire joue un rôle primordial.
Tout cela peut parfois conduire à de grands écarts par rapport à la rationalité, mais c’est à ce niveau qu’intervient un processus très puissant de contrôle : le concept de « science » est strictement indissociable de celui de l’existence d’une « communauté scientifique ». Seule cette dernière est à même de reconnaître le bien-fondé d’une découverte potentielle. Et cette règle, sévère, qui peut induire des controverses, s’impose nécessairement à tous.
J’ajoute qu’il arrive aussi que des découvertes débouchent sur des réalisations concrètes, et c’est bien sûr une confirmation complémentaire (à laquelle je suis personnellement très attaché) de leur validité et par là même de l’objectivité des connaissances en question.
LES MATHÉMATIQUES, UNE SCIENCE « À PART » ?
 Alexandre Moatti : Je ne sais plus qui a dit qu’une théorie qui ne s’appuie pas sur des faits n’a pas de valeur, mais que des faits sans théorie organisatrice n’en ont pas plus. Je vous rejoins donc complètement, s’agissant des sciences en général, sur la question de la complémentarité forte entre théorie et expériences.
Alexandre Moatti : Je ne sais plus qui a dit qu’une théorie qui ne s’appuie pas sur des faits n’a pas de valeur, mais que des faits sans théorie organisatrice n’en ont pas plus. Je vous rejoins donc complètement, s’agissant des sciences en général, sur la question de la complémentarité forte entre théorie et expériences.
Mais il me semble que les mathématiques échappent à cette règle et qu’une démonstration a valeur en soi. Une conjecture ne serait en quelque sorte qu’un appel à démonstration ultérieure.
Il y aurait donc une différence de nature entre les mathématiques, science cumulative (une démonstration acquise le reste), et les autres sciences, substitutives (une théorie peut en chasser une autre).
J‑P.C. : Qu’est-ce qui permet, à votre avis, d’affirmer qu’une démonstration est convaincante ? Suffit-il, comme certains le font, d’évoquer à son propos un critère de « beauté » ? Il est évidemment permis d’en douter.
C.C. : Il y a un mot qui s’applique particulièrement bien au regard critique qu’on peut porter sur l’activité des mathématiciens : c’est celui de rigueur. Et ce mot les insère, eux aussi, dans une communauté, celle qui est capable d’apprécier cette rigueur et donc de garantir l’authenticité d’une démonstration.
J‑P.C. : Oui, mais il y a quand même une différence de nature avec les autres sciences : au lieu de mettre ses idées à l’épreuve dans le monde extérieur, on le fait essentiellement dans son monde intérieur.

Alain CONNES
explorateur de l’univers des mathématiques.
Bien sûr, la démonstration a un rôle crucial, mais encore faut-il démontrer quelque chose et que ce quelque chose résulte bien d’une hypothèse – une hypothèse qu’en mathématiques on appelle habituellement conjecture –, et l’on ne peut pas faire l’impasse sur la genèse de cette hypothèse et sur son rôle. Le mathématicien la confronte pour ce faire avec tout l’acquis des mathématiques qui est dans sa propre mémoire, et ce qui est remarquable est que cela fonctionne.
J’ai beaucoup discuté de tout cela avec Alain Connes. Lui, comme je le disais à l’instant, a l’impression que son cerveau lui permet de naviguer dans un monde autre, qui existerait en quelque sorte en soi, et il n’a jamais voulu accepter l’idée qu’il fonctionnait, de ce point de vue, avec sa subjectivité. Ce qui ne l’empêche évidemment pas d’être un excellent mathématicien.
LE PROGRÈS
J‑P.C. : Ce qui me semble vraiment faire la différence entre les sciences et l’ensemble des activités littéraires ou artistiques, c’est le concept de progrès. Je le disais d’entrée de jeu, l’objectif de la science est non seulement de mettre en lumière des connaissances nouvelles mais aussi et fondamentalement de les faire progresser.
Le concept de progrès a‑t-il un sens en art ?
P.L. : Les connaissances scientifiques dont nous disposons aujourd’hui sont d’acquisition récente et de nature à bouleverser nos représentations du monde, leur « progrès » me paraît évident, n’est-ce pas ?
J‑P.C. : Bien sûr, et je ne suis pas du tout convaincu qu’il en soit de même en art. Une évolution, oui, mais un progrès ?
 Thomas Grenon : Je défends pour ma part l’idée qu’il s’agit véritablement d’un progrès, le cas échéant fondé sur des améliorations d’ordre technique, qu’on peut de surcroît dater.
Thomas Grenon : Je défends pour ma part l’idée qu’il s’agit véritablement d’un progrès, le cas échéant fondé sur des améliorations d’ordre technique, qu’on peut de surcroît dater.
J‑P.C. : Il est évident que l’évolution de l’art a bénéficié des progrès des techniques. Mais quand je compare par exemple le Parthénon à un chef‑d’oeuvre de l’architecture moderne…
P.L. : L’église de la Madeleine par exemple ! (Rires.)
J‑P.C. : Je parle d’un chef‑d’oeuvre. On est bien sûr frappé de l’évolution d’un monument à l’autre, mais il s’agit d’un renouvellement plutôt que véritablement d’un progrès. En quoi pourrait-on parler en l’occurrence d’une « amélioration », au sens où l’on peut employer ce terme par exemple lorsqu’on trouve un médicament plus efficace que ceux dont on disposait auparavant ?
M.M. : Je pense moi aussi que le concept de progrès n’a pas de sens en art. Les artistes contemporains puisent loin dans le passé les sources de leur inspiration, et cela est tout aussi vrai pour la littérature. Mais je ne vois absolument pas comment on pourrait parler de progrès entre François Villon et Claude Simon.
Être artiste ou littérateur aujourd’hui, c’est connaître tout ce passé, c’est être capable, d’une certaine façon, de le réutiliser, de le renouveler comme vous le disiez à l’instant, mais sans avoir la prétention de « l’améliorer ».
T.G. : Tout dépend du sens que l’on donne aux mots. Si l’on attribue une valeur morale au mot « progrès », je ne peux qu’être d’accord avec ce qui vient d’être dit. Mais si, en produisant une oeuvre, on ne s’est pas contenté d’imiter celles qui ont précédé mais qu’à partir de l’existant on a créé du neuf, je pense qu’on peut légitimement parler de progrès, c’est-à-dire d’avancée.
A.M. : Il faut s’entendre sur les mots : est-ce « progresser » que de se contenter de faire du nouveau ?

Peut-on progresser par rapport à la perfection ?
P.L. : Il me semble difficile de parler de progrès sans faire explicitement ou implicitement appel à un jugement comparatif de valeur, il ne peut s’agir de simplement constater l’existence d’une différence. La grotte de Lascaux – pour qui a eu la chance de la visiter – est absolument bouleversante de beauté ; comment pourrait-on « progresser » par rapport à elle ? En matière de science en revanche, les connaissances dont nous disposons aujourd’hui sont évidemment sans commune mesure avec ce qu’étaient les représentations de l’univers ou de la matière du temps de Cro-Magnon : le « progrès » est là manifeste.
N’y a‑t-il pas une sorte de perfection potentielle dans toutes les réalisations réussies de la littérature ou de l’art – je veux dire par là un authentique achèvement chaque fois atteint par les chefs‑d’oeuvre successifs –, alors que la science est par nature en permanence inachevée, ouverte sur l’avenir, et donc nécessairement en progrès continu ?
J‑P.C. : Je voudrais pour ma part souligner l’importance d’un mot qui vient d’être prononcé : celui de morale. Je pense qu’il est difficile de parler de la science sans évoquer ses dimensions éthiques et de la notion de progrès sans s’interroger sur ce que sont les visées sociales et politiques de nos sociétés. Mais ce serait un autre débat que d’aller aujourd’hui plus loin dans le développement de ces concepts.
RÊVER OU RÉFLÉCHIR ?
C.C. : En tant qu’astrophysicienne, j’ai eu souvent l’occasion de parler du ciel, des astres, de l’univers et de son évolution. Lorsque j’annonce à l’auditoire auquel je m’adresse que je vais aborder ces sujets, on me répond : « Vous allez nous faire rêver. » Et moi de rétorquer : « Mais non, je vais vous faire réfléchir. »

La beauté du ciel est objective.
Mon but premier est en effet de faire comprendre au public ce qu’est un raisonnement scientifique : comment nous formulons des questions et comment nous essayons d’y répondre. Nous ne savons pas encore très bien, par exemple, comment se sont formées les galaxies. Y a‑t-il eu d’abord un grand nuage de gaz qui se serait effondré sous l’effet de sa propre gravité et qui aurait ainsi produit ultérieurement des étoiles ? Ou bien n’y aurait-il eu au départ que de petites galaxies qui seraient entrées en coalescence et auraient fini par former les grandes, telles que la Voie lactée ?
Pour étudier ces problèmes, et tenter de répondre à ces questions, les astrophysiciens font des observations détaillées et pointues avec leurs télescopes au sol et dans l’espace. En parallèle, ils conçoivent des modèles numériques des galaxies qui incluent gaz et étoiles, et aussi l’invisible matière sombre.
Quand je raconte tout cela, une partie de mon esprit est occupée à se souvenir des équations qui régissent ces processus, des ordres de grandeur en jeu, etc., pendant qu’une autre est le témoin émerveillé de toutes ces étoiles, les voit s’allumer ou s’éteindre, est fascinée par la danse des galaxies qui se déforment, s’étreignent, se fondent les unes dans les autres pour finir par devenir des boules un peu déformées.
– Vous allez nous faire rêver.
– Non, je vais vous faire réfléchir
Alors que mon but n’est pas de faire rêver l’auditoire, voilà que moi-même je rêve. Quand je reviens à mon ordinateur je rêve d’une façon plus constructive. Je m’interroge sur la raison des différences entre les prédictions des modèles et les observations. Je me demande ce qui a pu être oublié, ce qu’il faudrait modifier, et me raconte à moi-même diverses versions de l’histoire de l’évolution des galaxies.
J’imagine, j’invente, et je réfléchis. Je demeure roseau pensant, partie prenante des aventures du cosmos.
J‑P.C. : Parler de la beauté des galaxies qui s’effilochent, comme vous le faites si joliment, me semble toutefois un peu dangereux : je pense à William Paley (1743−1805), auteur de Natural Theology : or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, que Charles Darwin a lu lorsqu’il était étudiant et à laquelle il s’est vigoureusement opposé par la suite. Paley s’extasiait sur la beauté du monde, de façon évidemment subjective, ce qui le menait à une conception totalement erronée de la réalité de l’univers et de l’évolution des êtres vivants.
Une multitude d’univers qui n’obéissent pas nécessairement aux mêmes lois de la physique que le nôtre
En fait, Darwin nous apprend que les choses ne sont pas si belles, qu’il y a des erreurs, et des imperfections partout. Ne prenez-vous pas le risque de vous rapprocher des visions anthropiques de l’univers ?
C.C. : Pas le moins du monde. La beauté du ciel est objective.
J‑P.C. : Mais ce n’est pas en scientifique que vous pouvez l’affirmer.
C.C. : Je veux bien, mais ce que je peux vous dire, c’est que, mes collègues et moi, avant d’aller nous enfermer dans la salle de contrôle du télescope, nous passons un moment à regarder le ciel et les étoiles avec nos yeux et à admirer le spectacle. Et je ne peux m’empêcher de penser que nos recherches n’en seront que plus fructueuses.

Le mont Sinaï. La beauté du monde peut jouer sur notre sensibilité mais pas sur la rationalité de notre esprit. © Daniel Fafard
J‑P.C. : Il m’est souvent arrivé à moi-même de travailler dans des paysages grandioses (je pense notamment à des articles que j’ai écrits au pied du mont Sinaï). Il est tout à fait possible que mon travail scientifique ait bénéficié de l’état mental que ce spectacle a ainsi induit en moi, mais je ne pense pas qu’il ait été de quelque façon que ce soit influencé en profondeur par mon opinion sur la beauté du monde.
Or, la théologie naturelle est précisément fondée sur le ressenti de cette beauté et c’est la raison pour laquelle je suis un peu gêné qu’on l’évoque en parlant d’activité scientifique.
C.C. : Je peux quand même vous rassurer en ce qui me concerne personnellement : mes propres convictions sont strictement à l’opposé de toute conception anthropique de l’univers, de cette forme particulière du créationnisme partant du principe que l’univers aurait été créé tel qu’il est pour que nous puissions le comprendre.
Ce que je dis est beaucoup plus simple : il aurait suffi d’une très petite variation des constantes de la physique pour que la vie telle que nous la connaissons, et en particulier la nôtre, fût impossible. Et la thèse à laquelle beaucoup de mes collègues aujourd’hui adhèrent est qu’il existe sans doute une multitude d’univers – dont le nôtre – qui n’obéissent pas nécessairement aux mêmes lois de la physique.
L’ÉVOLUTION DE LA SCIENCE, UN LONG FLEUVE TRANQUILLE ?
A.M. : Il me semble difficile de porter un jugement sur les scientifiques d’une autre époque à partir des connaissances que nous avons aujourd’hui. Des gens comme Cuvier ont fait de la science à leur manière, dans un certain paradigme, en l’occurrence celui de la Création.
J‑P.C. : Certes. Mais il n’empêche que c’est à partir du point de vue de Darwin que la science s’est enrichie, et pas de celui de Paley.
P.L. : Une remarque qui nous renvoie très directement à la question du progrès : on conserve Darwin, mais on a oublié Paley.
J‑P.C. : Évidemment. Il y a eu un progrès absolument considérable avec Darwin, qui n’efface pas le rôle intermédiaire de Cuvier (auquel son engagement luthérien ne permettait toutefois pas d’aller jusqu’au stade de l’appréhension de l’Évolution, ce qu’a osé faire Lamarck avant lui).

Cuvier, père de la paléontologie moderne
P.L. : L’exemple de Cuvier, si je vous suis bien, illustrerait donc le fait que le progrès scientifique peut parfois être porté par des acteurs dont l’imaginaire s’écarte résolument de ce qui va devenir le courant dominant ultérieur d’une connaissance validée.
Mais, cela étant et quelles que soient les circonstances, on ne peut parler de « mieux » que s’il y a une authentique amélioration des connaissances que nous appelons « rationnelles ».
J‑P.C. : Le problème du mot « mieux », c’est qu’il a une coloration d’ordre éthique ; j’ai bien compris que ce n’était pas dans ce sens que vous l’utilisiez mais l’ambiguïté demeure.
C.C. : Il s’agit d’une amélioration de la compréhension.
P.L. : Qui entraîne l’adhésion.
J‑P.C. : Mais pour entraîner réellement l’adhésion, encore faut-il que les faits qu’on ajoute au stock des connaissances permettent d’établir des cohérences nouvelles, en particulier par le croisement de disciplines différentes qui convergent dans leurs conclusions.
Ainsi, la théorie de l’Évolution a été confortée par des rapprochements singuliers entre la biologie moléculaire et la paléontologie.
LA SCIENCE-FICTION, UN AUTRE MONDE PARFOIS SI PROCHE
M.M. : La science-fiction consiste à partir d’un certain état de la science pour donner un prolongement imaginaire aux résultats acquis. Elle fonctionne comme une espèce d’à côté de la découverte scientifique en fantasmant un risque ou en anticipant l’une de ses conséquences potentielles, par exemple la possibilité (évidemment illusoire) de redonner vie à des dinosaures grâce au séquençage de leur ADN.
Elle se nourrit donc d’extrapolations secondaires à la science. S’agit-il pour autant d’une activité purement ludique ? Pas du tout. Elle peut par exemple être source de créations littéraires comme vient de le montrer brillamment l’écrivain Pierre Bayard dans son Il existe d’autres mondes, où il joue avec le chat de Schrödinger et où il explique pourquoi Raskolnikov agit de façon aussi étrange : « tout simplement » parce qu’il existe à la fois dans deux univers parallèles !
La science-fiction constitue un formidable inducteur de curiosité
Mais la science-fiction peut aussi se situer de façon fort intéressante très en amont de la démarche scientifique. Tout homme qui s’intéresse à la science a pu être cet enfant amoureux non pas seulement « de cartes et d’estampes » dont parle Baudelaire, mais bien de la connaissance susceptible d’être acquise, c’est-à-dire du monde et de ses mystères. Et c’est là que la science-fiction – et peut-être plus particulièrement l’une de ses formes, l’anticipation – peut jouer un rôle d’initiateur préscientifique fondamental.
Sauf vocation précoce d’un esprit qui ne serait « bon qu’à ça » comme le disait Beckett à quelqu’un lui demandant pourquoi il écrivait, l’intérêt pour la science peut commencer très tôt hors de toute vocation professionnelle. J’en fus moi-même un exemple quand, enfant passionné que j’étais par la lecture de textes parascientifiques, je me plongeais dans L’Univers et l’Humanité, cette espèce d’énorme « machin » qui voulait retracer la connaissance de A à Z, ou dans les oeuvres du bon abbé Moreux, ou encore dans l’Astronomie populaire de Flammarion.

Comment comprendre Flaubert en étant totalement inculte sur la science ?
L’appétit – je ne dirai pas scientifique car celui-ci réclame sans doute des connexions neuronales spécifiques – mais simplement l’appétit pour la connaissance des avancées scientifiques passe probablement plus aisément par la construction romanesque ou par l’image cinématographique, qui possèdent un pouvoir plus évident de séduction, que par un article même extrêmement clair et bien pensé.
La science-fiction constitue ainsi un formidable inducteur de curiosité et, comme la démarche scientifique est elle-même d’abord produit de la curiosité, elle prépare le terrain chez l’enfant par ce que j’appellerai une fièvre de connaître. En d’autres termes, je pense que la science-fiction devrait faire partie des matières obligatoires de tout cursus afin d’éviter de mourir idiot, ce qui est quand même gênant, mais aussi de maltraiter la plupart des grands textes de l’humanité qui se sont presque toujours intéressés à la question des confins de la connaissance.
J’ai trop connu de collègues littéraires pour qui toute science était lettre morte, trou noir, et cela me rendait le dialogue avec eux particulièrement difficile sur certains aspects de la littérature elle-même : comment comprendre Flaubert et La Tentation de saint Antoine – ce fabuleux voyage imaginaire dans l’infini – ou Bouvard et Pécuchet – qui est encore plus extraordinaire parce que s’attaquant à toutes les sciences en essayant de comprendre ce qu’elles veulent dire – en étant totalement inculte sur la science ?
Au portrait laudateur que j’ai tracé de la science-fiction il faut toutefois ajouter qu’un nombre très important de ses productions alimente de fait les approches mysticoïdes qui sont celles de l’intelligent design et autres fariboles : elle est donc aussi une forme de littérature de consommation courante qui a sans doute au moins autant de retombées négatives que positives.
C.C. : Je suis moi-même très sensible à la bonne science-fiction et j’adhère à tout ce que vous avez dit, Maurice Mourier, à ce sujet mais, s’agissant de l’astrophysique, je crois qu’aujourd’hui on pourrait si j’ose dire s’en passer, tant la réalité dépasse la fiction. L’expérience que j’ai des contacts avec des classes en témoigne clairement.
L’ALTERSCIENCE AUX MARGES DE LA SCIENCE
A.M. : Ce qui est intéressant dans les fausses sciences ou ce que j’ai appelé l’alterscience est la part de rationalité au sein de leur irrationalité (ce que Claude Lévi-Strauss a appelé la pensée sauvage), mais aussi leur foisonnement imaginaire – je pense par exemple au fantasme de « l’énergie libre » – cette énergie du vide dont l’existence même nous serait dissimulée par les grands trusts pétroliers.
Faut-il vraiment s’indigner de leur existence ou en avoir peur ? J’aurais tendance pour ma part à faire confiance en la matière à la capacité de discernement de mes semblables.

Un rôle (pour le moins ambigu) d’entraînement ?
Et j’irai même jusqu’à dire, quitte à être un peu provocant, que certains récits d’alterscience (qu’on songe par exemple à Planète et au Matin des magiciens, dans les années 1960) peuvent avoir jusqu’à un certain point un rôle positif d’entraînement en jouant plus sur l’imaginaire que les sciences elles-mêmes, très souvent arides dans leur présentation au public.
Par ailleurs, nous sommes à une époque où le mot « progrès » passe plus difficilement et où un scientisme trop affirmé peut se révéler contre-productif. J’évite aussi d’employer le mot « obscurantisme », qui est porteur d’une disqualification méprisante.
Cette position peut évidemment surprendre et ne fait pas nécessairement l’unanimité, mais, au fur et à mesure que j’ai étudié tout ce qui est hypertrophie scientiste, j’en suis venu à me dire qu’il fallait sans doute se méfier de tels discours, qui par ailleurs font le lit du climato-scepticisme.
Comme Maurice Mourier, je voudrais parler de la science-fiction, notamment de ces dystopies ou contre-utopies que sont par exemple 1984 ou Le Meilleur des mondes. Dans le premier de ces livres, la science a presque cessé d’exister dans le pays évoqué parce que « dépendant de formes de pensée empiriques qui ne pouvaient subsister dans une société strictement réglementée ». Dans le second ouvrage, elle est considérée comme dangereuse, « nous sommes obligés de la tenir muselée », disent les dirigeants, ajoutant : « Cela n’a pas été une bonne chose pour la vérité, mais ce fut excellent pour le bonheur. »
Que les sociétés en question soient faussement iréniques ou totalitaires, elles ont pour ambition de se passer de la science et nous pouvons nous demander si nous ne sommes pas en train de nous préparer un meilleur des mondes de cette nature en multipliant en toute occasion les « précautions ».
Un scientisme trop affirmé ne peut être que contre-productif
On peut aussi citer un bel exemple de recours à l’imaginaire chez les créationnistes – une totale aberration, bien sûr, du point de vue scientifique – en l’occurrence l’affirmation que la Terre a bien 6 000 ans mais que Dieu l’a créée avec une « apparence de vieillesse », les 13,7 milliards d’années qu’évoquent les astrophysiciens étant en fait intégrés dans ce qui a précédé cette Création effective.
Une idée qu’on trouve déjà chez Chateaubriand, dans Génie du christianisme (1802). Aussi peut-on dire que la science avance, et que l’alterscience ne fait que se répéter en la parasitant.
P.L. : Merci de cette brillante démonstration d’une intense présence de l’imaginaire chez les tenants de l’alterscience. Cependant le sujet de notre débat ne porte pas sur la seule question de l’imaginaire, mais bien sur son articulation avec ce qu’on appelle la science ou les sciences, c’est-à-dire en fin de compte, me semble-t-il, sur l’utilisation conjointe de notre capacité d’imagination et de la rationalité de notre esprit.
L’idéologie sur laquelle se fondent les pseudosciences ne masque-t-elle pas complètement la nécessité d’apporter une démonstration, au sens classique du terme, de ce que l’on affirme ?
A.M. : Vous avez raison de rappeler que la science se nourrit conjointement d’imaginaire et de raison, mais ce que j’essaie de dire est que l’alterscience tente d’une certaine façon d’introduire de la rationalité dans l’irrationnel, notamment quand elle émane d’ingénieurs ou de scientifiques, « d’hommes de science » disait Lévi-Strauss ; c’est en soi un phénomène intéressant, que je me suis attaché à étudier.
P.L. : Il n’empêche que subsiste une différence majeure entre les sciences et l’alterscience : les premières acceptent par définition que les faits observés puissent remettre en question les plus belles théories, alors que les secondes partent d’une vérité qu’elles croient absolue et tentent par tous les moyens d’adapter les faits observés à cet a priori.
J‑P.C. : La science est en effet, en permanence, un débat critique, ce qui n’est évidemment pas le cas des fausses sciences.
M.M. : Et la science a le droit de se tromper, ce qui n’est pas non plus le cas des fausses sciences.
RAPPROCHER ARTS ET SCIENCES, UNE VUE DE L’ESPRIT ?
P.L. : Tout ce qui s’est dit au cours de cette table ronde conduit en particulier à se demander si les barrières entre arts et sciences sont aussi étanches qu’on pourrait a priori le penser.
L’art et la science sont deux regards portés sur le monde que rapproche leur recours à l’imaginaire
T.G. : Je n’aime pas beaucoup pour ma part ni le mot « étanchéité » ni le mot « frontière » et j’ai aussi quelque mal avec le mot « progrès », sauf si on le prend dans son sens descriptif le plus banal, dépourvu de tout jugement de valeur.
Plus fondamentalement, et c’est pour cela que je pense qu’il y a en fait communauté de démarche entre eux, l’art et la science sont deux regards portés sur le monde, traduits dans l’un et l’autre cas par des langages spécifiques. Comprendre, rendre compte, faire partager à d’autres sa façon d’appréhender ce que l’on ne connaît pas, cette part de mystère que nous voudrions pour partie lever, et peut-être pour partie conserver.
La complexité croissante, au cours du temps, des langages en question rend évidemment plus difficiles les échanges, or cela vaut non seulement pour ce qui concerne le dialogue entre les sciences et les arts mais aussi au sein même des arts d’une part, et surtout des sciences d’autre part du fait de leur intense spécialisation.
Cette difficulté ne peut toutefois que stimuler un désir de communication et de coopération entre ces deux formes essentielles de l’activité créatrice humaine, certes distinctes mais dont nous avons bien montré qu’elles avaient aussi d’importants traits communs.






