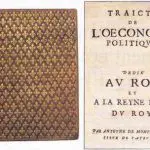L’Association : une révolution tranquille

Une très longue marche
Une très longue marche
Avant 1901, l’existence légale d’une association découle obligatoirement de sa reconnaissance par l’État. Sous l’Ancien Régime il n’y a pas d’association possible sans l’autorisation du roi. Un mandement de Philippe le Bel de 1305 adressé au prévôt de Paris lui enjoint de faire publier « des défenses à toutes personnes de s’assembler dans Paris au-delà du nombre de cinq, soit de jour, soit de nuit, dans les lieux publics ou secrets sous peine de prison ». Liberté de s’associer et capacité juridique sont alors intimement liées. Les lettres de patente qui autorisent l’association lui confèrent en même temps la personnalité morale.
L’édit d’Aguesseau de 1749 rappelle ce régime juridique : « …voulons qu’il ne puisse être fait aucun nouvel établissement de chapitres, collèges, séminaires, maisons ou communautés religieuses, même sous prétexte d’hospices, congrégations, confréries, hôpitaux ou autres corps… de quelque qualité qu’ils soient… dans toute l’étendue de notre royaume… si ce n’est en vertu de notre permission expresse, portée par nos lettres de patentes, enregistrées en nos parlements ou conseils supérieurs… déclarons nuls tous ceux qui seraient faits à l’avenir sans avoir obtenu nos lettres patentes… » (cité par Waldeck-Rousseau, 21.06.1901, JO débats, p. 115).
La principale raison d’être de cette interdiction est la volonté de limiter les biens de mainmorte : « …pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l’intérieur de notre royaume, nous font regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvénients de la multiplication des gens de mainmorte et de la facilité qu’ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles ».
C’est cette conception de la personnalité morale qui a été reprise par la Constituante inspirée des idées du siècle des Lumières, profondément individualiste et donc hostile à toutes formes de corps intermédiaires venant se glisser entre l’État et le citoyen.
L’Empire, tout aussi hostile, confirme cette tradition et la renforce encore ; c’est ce que traduit l’avis du Conseil d’État de 1805 : « …les établissements de bienfaisance ne peuvent être utiles et inspirer une confiance fondée, quelle que soit la pureté des intentions qui les ont fait naître, tant qu’ils ne sont pas soumis à l’examen de l’administration publique, autorisés, régularisés et surveillés par elle ».
Jusqu’en 1824, la reconnaissance d’utilité publique (RUP), ainsi définie, ne s’applique qu’aux établissements de bienfaisance ; ce n’est qu’à cette date qu’un décret l’élargit aux associations de toute nature, car, en vertu des dispositions de la loi Le Chapelier (1791), la reconnaissance d’utilité publique est la seule solution pour donner à une association une existence légitime. C’est ainsi que, sous le régime antérieur à la loi de 1901, toute association de plus de vingt membres devait obtenir une autorisation préfectorale, laquelle ne conférait aucune capacité juridique, mais avait pour seul but de soustraire ses membres aux dispositions de la loi réprimant le délit d’association non autorisée (art. 291 à 294 du code pénal).
C’est au cours des longs débats qui se déroulent au Parlement en 1900 et 1901 qu’une solution de rupture avec les principes anciens du droit public a fini par être adoptée : les associations simplement déclarées – plus d’autorisation administrative préalable – bénéficieront désormais du privilège essentiel jusque-là obtenu par la seule reconnaissance de l’État, de l’acquisition de la capacité juridique.
Toutefois, la capacité à recevoir des libéralités1 restera le privilège de la RUP, les pouvoirs publics, dans un climat de « guerre religieuse » ne l’oublions pas, gardant le souci de la maîtrise de la constitution des biens de mainmorte et la volonté de contrôler les établissements de bienfaisance. C’est pourquoi, au sujet des ARUP2, on parle de « grande capacité ».
En 1933, la capacité à recevoir des libéralités a été étendue aux associations à but exclusif d’assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale, capacité donnée pour cinq ans par arrêté préfectoral après enquête, et à la condition que les statuts comportent des dispositions analogues à celles des associations RUP. C’est ce que l’on appelle la « petite » capacité.
Un climat toujours hostile
Comment expliquer cette permanence d’une interdiction tout au long d’un siècle qui a connu la montée des autres libertés avec, certes, des hauts et des bas ? En 1881 c’est la liberté de réunion et la liberté de la presse, en 1884 la liberté syndicale qui est dissociée de la liberté de s’associer pour laquelle il faudra encore attendre. Pourquoi ? La première raison, nous venons d’en parler, c’est la crainte de voir une association accumuler, compte tenu de sa permanence, des biens qui seraient soustraits au circuit économique. Mais c’est aussi le principe de la libre concurrence, exigence de l’économie de marché qui domine tout le XIXe siècle sur le plan économique, qui condamne les regroupements sur une base professionnelle, car susceptibles de remettre en cause le principe du laisser-faire et du laissez-passer.
La seconde raison est d’ordre psychologique : c’est la peur que les associations inspiraient aux détenteurs du pouvoir. Tous craignaient de voir l’association utilisée par ceux qu’ils considéraient comme leurs adversaires et qui leur paraissaient faire peser une menace. C’est ce qui explique que tous les régimes qui se sont succédé, même les plus libéraux, se soient montrés extrêmement réticents à l’égard de la liberté d’association.
Quant aux positions des républicains qui proclament vingt ans plus tôt la liberté de réunion et de la presse, ils ont une raison supplémentaire pour s’opposer : ils ne retrouvent pas la liberté d’association dans l’héritage de 1789. Ce n’est donc pas une liberté dont ils se sentent les garants et les responsables, comme de celles qui sont inscrites dans la Déclaration des droits de l’homme.
Certains y verront encore une raison plus terre-à-terre : les républicains ne sont peut-être pas fâchés de pouvoir utiliser, contre ceux qu’ils considèrent comme leurs adversaires, les armes que l’interdiction de l’association leur procure et la possibilité de faire dissoudre, par l’administration, celles des associations qu’ils jugent dangereuses pour eux. En effet, l’article 291 du code pénal est largement appliqué en 1890 et en 1898 à toutes les associations politiques antirépublicaines, nationalistes et conservatrices.
Mais si l’on tarde encore à abandonner cette arme, c’est que l’on craint aussi que cet abandon profite à ceux que l’anticléricalisme de cette époque considère comme des ennemis particulièrement dangereux de la loi qui, en contradiction avec tous ses principes, impose aux congrégations un régime qui équivaut pratiquement à l’interdiction.
Une sacrée revanche
Avec la loi de 1901, c’est le régime de l’autorisation préalable qui disparaît, régime qui était la négation de la liberté.
Si cette loi a connu quelques avatars au cours du XXe siècle, tout particulièrement avec la loi de 1939 sur les associations étrangères qui a heureusement disparu en 1981, on ne peut passer sous silence, alors que la menace du rétablissement de l’autorisation administrative pesait lourdement, la décision fondatrice du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 :
elle consacre la liberté d’association au niveau le plus élevé de toutes les règles juridiques, le niveau constitutionnel.
L’incident provocateur d’une décision aussi fondamentale, c’est Simone de Beauvoir qui en est à l’origine.
Si elle n’avait pas décidé de reconstituer Les amis de la cause du peuple, M. Marcellin, ministre de l’Intérieur, n’aurait pas donné ordre au préfet de police de refuser le récépissé de dépôt des statuts ; ce refus n’aurait pas été annulé par le tribunal administratif ; cette annulation n’aurait pas entraîné le dépôt d’un projet de loi et son vote par le Parlement ; le Président du Sénat n’aurait pas saisi le Conseil constitutionnel ; lequel n’aurait pas pu prendre une décision aussi fondatrice des libertés.
Car, et c’est un aspect pour le moins surprenant, c’est la liberté d’association qui a entraîné avec elle, à ce niveau de la Constitution, les autres libertés fondamentales.
C’est ainsi que Simone de Beauvoir, il n’est pas interdit de lire l’histoire de cette façon, a provoqué la décision véritablement fondatrice de la protection constitutionnelle des droits fondamentaux dans l’histoire de la République française !
Une loi devenue désuète ?
Au cours des vingt dernières années, et plus particulièrement encore à l’approche de la commémoration du centenaire de la loi, pour des motifs divers et parfois contradictoires, des voix favorables à sa révision se font entendre. Certes, le contexte a profondément changé. Mais de là à parler comme certains le font aisément de loi désuète, inadaptée à la législation socioculturelle et socio-économique contemporaine, inadaptée encore, bien que ce problème mérite la plus grande attention, à la lutte contre les nouveaux mouvements sectaires qui connaissent depuis quelques années des développements préoccupants, c’est un pas que nous ne souhaitons pas franchir.
Nous n’avons jamais été convaincus par les arguments des uns et des autres malgré la sincérité de certaines intentions. Car aucune des raisons invoquées ne saurait justifier la révision d’une loi qui, ne l’oublions pas, confère, en premier, à l’association son caractère et son fondement essentiels, c’est-à-dire la liberté, et cette liberté ne serait-elle pas la plus haute justification de l’association ?
Lors du colloque organisé conjointement par le CNVA et l’Assemblée nationale à l’occasion du 90e anniversaire de la loi, le professeur de droit Jean Rivero s’exprimait ainsi : Il ne saurait y avoir de limite d’âge pour les libertés. Une loi de 90 ans doit garder tout son dynamisme et sa vitalité lorsque c’est une liberté qu’elle consacre. Et le professeur Didier Maus spécialiste du droit constitutionnel d’ajouter à propos de ceux qui sont enclins à la réforme : Une des grandes caractéristiques, un des grands avantages de la loi de 1901 est justement de ne pas contenir grand-chose.
C’est un bien, croyons-nous, qu’il nous appartient de préserver.
L’association est un contrat
À sa naissance, la liberté d’association revêt deux aspects : la liberté individuelle de tous ceux qui entendent se grouper, c’est la liberté de création de l’association.
La seconde liberté, ce n’est plus celle de l’individu, c’est la liberté du groupe qui implique que lui soient accordés les moyens indispensables pour atteindre son objet.
Or la loi de 1901 met l’accent sur la première, c’est-à-dire sur l’aspect individuel de s’associer, ce qu’indique bien son intitulé qui n’est pas « loi sur la liberté d’association », mais « loi relative à la convention d’association ». C’est bien un contrat qui relève du droit civil qui fonde l’association, un contrat qui jouit de la même liberté qu’un contrat de droit privé. Et cette liberté ne connaît que deux limites : conformément aux droits des contrats c’est le respect des lois de la République et d’une certaine moralité ; la seconde limite, elle, est inhérente à la notion même d’association : l’interdiction de la poursuite d’un but lucratif par les associés, c’est-à-dire le non-partage des bénéfices et le désintéressement de ses dirigeants, ce qui distingue fondamentalement l’association de la société de capitaux.
Un siècle de réalisations considérables
À l’approche du centième anniversaire de la loi, il m’est apparu important de tracer les grandes lignes de ce qui a précédé son vote tardif et de souligner les quelques avatars survenus au cours de ce siècle, dont le dernier, qui s’est retourné contre ses auteurs. La question qui vient immédiatement à l’esprit : cette liberté, qu’a-t-elle produit depuis bientôt cent ans, en termes de bien commun et de service de l’intérêt général ?
S’il n’existe pas de réponse exhaustive à pareille question, quelques chiffres nous permettront de comprendre le bouleversement qui a été rendu possible à partir du vote de 1901.
Tout d’abord, et ceci peut surprendre, malgré la longue attente et le difficile accouchement de la loi, le « boum associatif » n’a pas été immédiat.
Le nombre des associations enregistrées les premières années ne dépassait pas quelques centaines par an. Au cours des années 20, le chiffre de deux mille était atteint, mais c’est au cours des années 50 que le développement s’est accéléré avec la création de quelque cinq mille associations par an.
Si au début des années 70 le chiffre de 20 000 était dépassé, c’est à la création de plus de 60 000 que l’on assiste depuis le début des années 90.
C’est dire que le mouvement s’est prodigieusement accéléré au cours des trente dernières années, même si aujourd’hui il tend à se stabiliser. Ces éléments statistiques sont la démonstration de l’intérêt croissant de nos contemporains pour cette forme d’organisation pour entreprendre que constitue l’association. Ils sont aussi révélateurs du formidable vivier d’innovations et d’initiatives drainées par cet outil juridique.
Cependant, ces éléments ne permettent qu’une approche approximative de la réalité du parc associatif en activité, car chacun sait que s’il y a obligation de déclarer l’association à la préfecture pour qu’elle dispose de la capacité juridique3, la même obligation n’existe pas au moment de la dissolution, ou, ce qui est aussi fréquent, de l’abandon de l’activité et de la mort lente sans dissolution.
La diversification des secteurs au sein desquels les associations – d’abord dirigées et animées principalement par des bénévoles – interviennent, tous les secteurs de l’activité sociale, économique et culturelle sont couverts, autant que la croissance et la complexité de leurs activités ont conduit la plupart des associations les plus influentes à une forte professionnalisation.
Plusieurs études universitaires, et plus récemment celles de l’INSEE, aboutissent à des résultats voisins, c’est le chiffre de 750 à 800 000 associations en activité qui semble s’imposer.
C’est ainsi qu’aujourd’hui le paysage associatif ne s’est pas uniquement densifié, il est devenu plus complexe et plus diversifié.
Quand on sait qu’en matière d’emplois les associations représentent un effectif supérieur à la branche du bâtiment ou de l’industrie automobile – quelque 800 000 équivalents temps plein pour 1 300 000 salariés, 4,2 % de l’emploi total en France -, on mesure le chemin parcouru depuis le début du siècle4.
Mais ces chiffres ne sauraient cacher cette autre réalité qui est la diversité : sur les 800 000 associations, à peine 15 % d’entre elles salarient au moins une personne, c’est dire que l’écrasante majorité n’est dirigée et animée que par des bénévoles5.
Le poids économique du secteur sanitaire et social est de loin le plus important puisqu’il représente à lui seul plus de 50 % des salariés : 136 500 pour le sanitaire, répartis dans 12 500 associations, 310 000 pour le social dans 82 500 associations. La culture et les loisirs comptant un peu moins de 100 000 salariés. La masse financière gérée par les associations atteindrait quelque 217 milliards, soit 3,3 % du produit intérieur brut. Quant à l’estimation très approximative de la valorisation financière du bénévolat, elle est estimée à 74 milliards, ce qui ramène le poids économique des associations à un chiffre voisin de 291 milliards de francs.
Sur les ressources globales du secteur associatif, nous nous bornerons à ne citer que deux chiffres significatifs : 60 % en provenance des pouvoirs publics et des institutions sociales (plan national et local), alors que 7 % seulement proviennent des dons6.
.Ces quelques chiffres nous permettent de mieux appréhender le mouvement associatif d’aujourd’hui : sa réalité économique ne fait plus de doute, au point que certains s’interrogent parfois – pour ce qui concerne notamment les associations gestionnaires – s’il ne faut pas les classer parmi les entreprises ou encore parmi les administrations (rôle des financements publics).
Cette interrogation introduit la question essentielle concernant l’association, c’est celle de sa spécificité. Entreprise, oui, au sens étymologique d’entreprendre des actions, obéissance aux règles de la micro-économie, notamment de la loi comptable concernant les obligations et les seuils pour le commissaire aux comptes, mais aussi au sens du droit du travail, l’association est une entreprise qui a la responsabilité totale de l’employeur.
On pourrait multiplier les facteurs de rapprochement, mais gardons-nous d’oublier que si l’association gestionnaire est bien une entreprise au sens étymologique, elle se distingue fondamentalement de l’entreprise de capitaux dont la fonction est de produire de la plus-value, car c’est une société de personnes qui ne repose pas sur l’apport de capitaux ni sur des liens patrimoniaux, mais sur des liens de solidarité entre chacun de ses membres, et de ceux-ci, avec leur environnement. C’est ce que l’on appelle la non-lucrativité.
L’association et son projet
Mais ce qui la distingue encore, au regard du bien commun, c’est son projet et la méthode démocratique pour le mettre en œuvre, c’est dire sa capacité à mobiliser des bonnes volontés et des forces militantes.
Si l’on se réfère à la période de l’après-guerre, le mouvement associatif apparaît comme l’accompagnateur des évolutions profondes de la société française.
Qu’il s’agisse des congés payés et du rôle considérable joué par le tourisme social au cours des années 50 notamment, de l’épanouissement des jeunes dans les mouvements de jeunesse dont le scoutisme, de la promotion de la personne, du civisme, de la citoyenneté et de l’accès aux responsabilités au sein des mouvements d’éducation populaire, du développement du sport pour tous dans des milliers de clubs, de l’accès à la culture, de l’action sociale, de l’accueil des personnes en difficulté, des associations de consommateurs, de défense de l’environnement, du tiers-monde, des associations d’insertion et de lutte contre la pauvreté, des radios locales, des associations de développement local et d’aide aux personnes âgées… à chaque étape, dans ces multiples domaines, les associations ont largement démontré leur capacité à être en prise directe avec la société.
C’est pourquoi elles sont aussi le reflet, le miroir, et souvent sont à l’avant-garde, parce que leur forme d’organisation est souple et qu’elles s’adaptent aux réalités les plus diverses de notre histoire sociale. À l’écoute de la société, présentes sur le terrain, là où se constitue la demande sociale, elles ont vocation à la porter, à la faire connaître, mais aussi à apporter des réponses concrètes.
À regarder de près les prémisses de la loi contre les exclusions, il n’est pas nécessaire d’être grand spécialiste des questions sociales pour constater que, sans le mouvement associatif et son constant combat opiniâtre pour faire reconnaître l’accès aux droits pour tous et le devoir de solidarité vis-à-vis des plus démunis, le cheminement législatif, même s’il fut très long et chaotique, n’aurait vraisemblablement pas abouti.
Les pouvoirs publics l’ont si bien compris, surtout depuis les années de crise économique, d’un chômage croissant et d’une pauvreté galopante, qu’ils ne cessent de passer commande aux associations parce qu’ils ont repéré chez elles des savoir-faire et une proximité avec les problèmes réels des gens que ni l’administration, encore moins le secteur commercial, ne sont capables de développer.
C’est ce qui explique les chiffres de participation financière de l’État et des collectivités dans le financement des associations. Tout irait pour le mieux si la tentation permanente des « financeurs » ne consistait pas à passer commande comme ils le font dans le cadre des marchés publics à un prestataire de service, sans égard pour la spécificité du projet associatif.
Reconnaître ce projet et sa spécificité, c’est considérer que la méthode associative, qui repose sur le débat et la décision collective prise démocratiquement, apporte une « plus-value » en termes d’humanité, de citoyenneté et de responsabilité. Si l’association n’est pas en situation de justifier « ce plus », à quoi bon faire appel à elle ?
À moins que ce ne soit pour des raisons économiques, certes non négligeables mais pas à la hauteur des enjeux, l’apport du bénévolat contribuant à réduire les coûts des services rendus. Si ce phénomène devait se développer, nous assisterions progressivement à la banalisation de l’activité associative et progressivement à la perte de sens, tout au moins pour celles qui tendraient à oublier les fondements sur lesquels elles reposent : le projet collectif.
À l’approche du centenaire du vote de la loi, procéder à l’inventaire de la contribution associative en matière de liberté, de progrès social, de développement des solidarités et du civisme, de prise de responsabilité, de respect des droits… constitue un devoir de mémoire essentiel pour penser le nécessaire rebond des associations pour le XXIe siècle.
Certes, comme toutes les activités humaines, le monde associatif a été parfois secoué et malmené par des pratiques peu conformes à ses traditions et à sa vocation. Ce ne sont pas ces avatars aussi déplorables que choquants parce que contradictoires avec les valeurs du mouvement associatif, ses responsables sont les premiers à les condamner, qui sauraient freiner l’engagement des bonnes volontés pour le service du bien commun. Notre société dite développée a trop besoin d’hommes et de femmes de toutes origines, ayant la volonté d’un engagement tourné vers les autres.
La solidarité n’est-elle pas une des conditions essentielles du « mieux vivre ensemble » pour des hommes libres ?
______________________________________
1. Le terme de libéralité est plus conforme que l’expression « dons et legs » : depuis la loi du 23.07.87 toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels sans formalité particulière. Seules les donations, portant transfert de propriété et nécessitant un acte authentique, sont réservées aux associations RUP.
2. Association reconnue d’utilité publique.
3. Par essence, on peut appréhender avec une plus grande imprécision encore les associations dites de « fait » qui relèvent de la même loi puisqu’elles ne font pas l’objet d’une déclaration. Il faut souligner que pour les trois départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle c’est la référence à la loi locale de 1908 qui s’impose et que la déclaration doit se faire devant le tribunal d’instance.
4. Au cours des quinze dernières années l’emploi associatif a connu une croissance moyenne annuelle de plus de 4 %, ce qui constitue un record.
5. Nous citons ici les résultats des études conduites par Édith Archambault, professeur d’économie à l’université Paris I, Le secteur sans but lucratif, Paris, Économica, 1996.
6. Dans le Royaume-Uni où la tradition associative remonte au XVIe siècle, les fonds publics ne dépassent guère 30 %, mais la fiscalité des dons est plus généreuse que chez nous et le mécénat se pratique depuis longtemps.