L’automobile et la ville, une politique publique à repenser
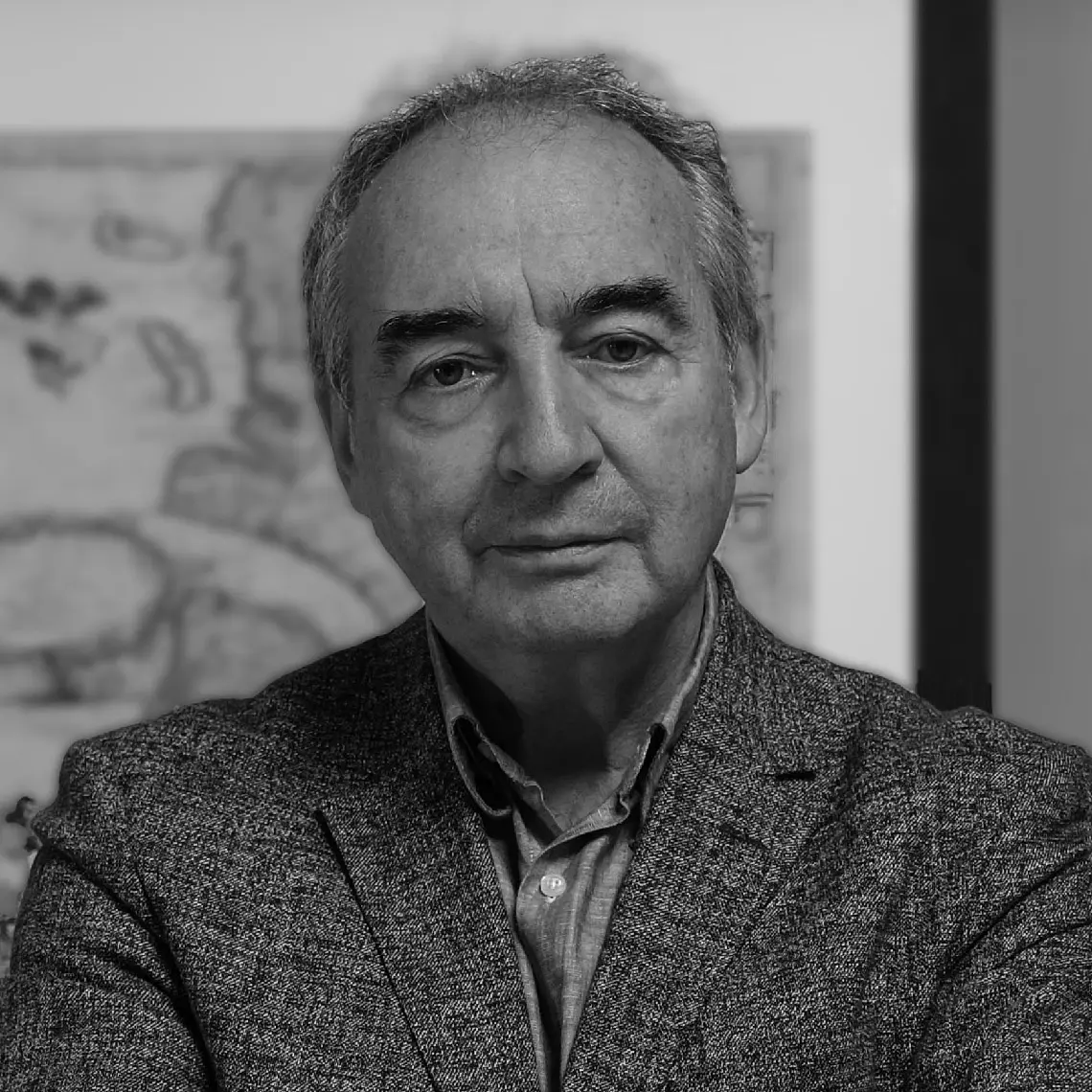
La vision d’un urbaniste sur le traitement de l’automobile dans la ville et sur les solutions à trouver pour enfin régler ce problème identifié mais jamais traité au fond.
Un demi-siècle après l’Essai sur l’automobile d’Alfred Sauvy, la voiture particulière est devenue omniprésente, toujours plus utilisée mais toujours davantage vilipendée… L’économiste-démographe dénonçait l’insécurité routière, la congestion urbaine, la pollution atmosphérique. À ces externalités négatives, le premier choc pétrolier de 1974 ajoutera l’enjeu énergétique. Et les préoccupations environnementales inédites du septennat (1974−1981) de Valéry Giscard d’Estaing sonneront un premier coup d’arrêt aux projets d’infrastructures routières en ville.
Il n’y a cependant jamais eu autant de voitures en France. La saturation du marché n’est pas encore au rendez-vous : les séniors ne délaissent plus leur auto en partant à la retraite ; les jeunes ne font que différer leur accès à l’automobile ; et le succès de l’habitat périurbain combiné à l’individuation des modes de vie encourage la multimotorisation. La schizophrénie perdure ! Jamais l’ambition de réduire le trafic automobile n’a été si présente dans les discours politiques et médiatiques.
Aux méfaits réévalués des pollutions locales de la voiture s’ajoute désormais l’impératif moral et légal de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ce « je t’aime moi non plus » brouille la lisibilité des stratégies collectives. S’agit-il d’une politique industrielle hégémonique, dictant sa loi à des politiques d’aménagement ? N’y a‑t-il pas plutôt à regarder du côté des failles de politiques de mobilité en mal de gouvernance ?
REPÈRES
C’est durant les années 1960–1970 que la voiture se démocratise en France, à l’instar des États-Unis de l’entre-deux-guerres. En 1953, 20 % des ménages français possèdent une voiture, ils sont 30 % en 1960, 60 % en 1973 et plus de 80 % à partir des années 2000. La dépendance automobile s’installe, entre investissements routiers étatiques ou départementaux, promotion du lotissement pavillonnaire et de l’hypermarché, et rôle moteur historique de l’industrie automobile dans l’économie nationale : la part de la valeur ajoutée de l’automobile dans la VA de l’industrie manufacturière atteint 10 % en 1972 (coïncidant avec les 18 000 morts de l’année du pic de la mortalité routière en France) et se trouve encore à 9 % en 2000. Le taux d’équipement dépasse aujourd’hui les 85 %.
La ville et la voiture, urbi et orbi
Du souci d’adaptation de la ville à l’automobile attribué à Georges Pompidou jusqu’aux quêtes contemporaines de modération du trafic automobile, un regard trop rapide sur 50 ans d’action publique urbaine pourrait laisser accroire que les villes françaises ont failli devenir Los Angeles et vont bientôt ressembler à des cités médiévales italiennes. La préoccupation de la gestion des flux (continuité, séparation) a une histoire, celle de la traction hippomobile avant celle de l’automobile, celles des voiries de Cerdà à Barcelone en 1860 ou des carrefours à giration d’Eugène Hénard (rond-point de la place de l’Étoile en 1906).
La procédure des plans de circulation, au début des années 1970, poursuivra ces démarches d’ingénierie du trafic à coups de sens uniques et de feux tricolores. Certes quelques élargissements de rues et d’avenues au profit de la circulation automobile, plus souvent des grignotages de trottoirs et surtout une forte augmentation des surfaces viaires consacrées au stationnement (en linéaire ou en confiscation d’espaces publics), se sont accumulés au fil des décennies, créant cette perception d’envahissement. Mais Haussmann et les bombardements des deux guerres mondiales ont plus fait pour l’extension des surfaces de voiries que les inconsidérés mais inaboutis (à quelques exceptions près) projets d’autoroute urbaine.
De fait, les transformations subies au nom de l’essor automobile par les villes françaises, dans leur tissu urbain constitué, concernent plus leur fonctionnement que leur morphologie ; une ambiance circulatoire réversible pour l’essentiel, même si le processus de reconquête prend quelques décennies : piétonisation des rues commerçantes de centre-ville dès les années 1970 ; tramways, et métros dans une moindre mesure, facilitant un nouveau partage de la voirie un peu moins favorable à la voiture, depuis les années 1980. Et c’est en 1996 que la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie fixe un objectif de diminution du trafic automobile au profit des autres modes de transport. Presque toutes les municipalités des grandes agglomérations souhaitent aujourd’hui poursuivre ce mouvement d’apaisement du trafic.
L’essentiel est ailleurs
Mais l’histoire officielle ainsi narrée des rapports entre la ville et l’automobile pèche, gravement, par omission. Car ce mouvement de croissance puis de réduction de la place de la voiture ne concerne que les villes-centres ou les centres d’agglomération. Et c’est ailleurs que les choses se passent, surtout ailleurs, non pas dans les espaces urbains historiques mais dans les territoires créés par l’automobile : banlieues désorganisées et réorganisées par la structure viaire des voies express et la métrique des vitesses à moteur, espaces périurbains des vies avec l’automobile.
La « bagnole » n’a finalement que peu transformé la ville existante, elle a en revanche développé les espaces dilatés de l’automobile du quotidien, là où se parcourt l’essentiel des kilomètres, qui font aussi l’essentiel des émissions de gaz à effet de serre de la motorisation individuelle. Or, à l’instar de l’ivrogne qui cherche ses clés sous le lampadaire parce que c’est là que c’est éclairé, nos politiques de déplacement s’intéressent aux villes et au transport collectif, pas au périurbain et à la voiture.
L’automobile, l’impensé des politiques de déplacement
Les mauvaises lunettes de l’action publique en matière de déplacements ont une explication. À la fin des années soixante, les transports collectifs urbains vont mal : les bus sont englués dans les embouteillages, il n’y a pas d’argent pour moderniser les réseaux, qui perdent peu à peu leur clientèle. L’invention du versement transport va fournir la manne nécessaire au développement des transports collectifs en site propre. Et l’idée de transfert modal (de la voiture vers le transport collectif – TC) va durablement structurer les politiques de déplacement. La logique est vertueuse : les transports collectifs se modernisent, ils deviennent donc compétitifs par rapport à la voiture, les automobilistes vont donc quitter leur véhicule pour prendre les TC, nouveaux clients participant au rééquilibrage des budgets consacrés aux transports collectifs urbains – TCU.
“L’automobile est hors des radars des politiques de mobilité.”
Formalisés en 1982, rendus obligatoires en 1996, les plans de déplacements urbains (PDU) entérinent cette vision en désignant les Autorités organisatrices de transport (AOT) comme maîtres d’ouvrage des PDU. En faisant du transfert modal l’alpha et l’oméga des politiques de déplacement, les responsables politiques et techniques ont oublié que le modèle de la ville compacte bien maillée par un réseau de transports collectifs efficace se trouvait en contradiction croissante avec la réalité de l’urbanisation, principalement déployée sur les territoires à faible densité des périphéries. Mais le dogme s’est installé, malgré les échecs de ce principe du transfert modal. Il perdure, fort du hold-up sémantique opéré par le petit monde des transports collectifs parlant désormais de mobilité… pour continuer à ne s’occuper que de TCU.
L’automobile se trouve ainsi hors des radars des politiques dites de mobilité. On s’essaye, plus ou moins efficacement et de manière plus ou moins juste socialement, à en réduire la place en ville, et on ne s’intéresse pas à son usage hors de la ville. Quelles bonnes questions se révèlent ainsi ignorées des agendas politiques ?

En finir avec la voiture individuelle ?
Nos voitures prennent de la place, en circulation comme à l’arrêt (90 % du temps !), et elles pèsent lourd. Dans les villes, où l’espace viaire est rare, le duo gagnant de la sobriété surfacique, c’est la marche de l’homme debout et le transport collectif massifiant les flux. Pas la voiture traditionnelle, surtout si son taux de remplissage est faible (ce qui est en particulier le cas pour les trajets domicile-travail). Pour contourner ces inconvénients de la voiture, de nombreuses villes asiatiques ont plébiscité le deux-roues motorisé (de plus en plus souvent électrique).
La traduction européenne de ce marché pourrait être la petite voiture urbaine, jamais vraiment promue par les stratégies industrielles, portées à la défense de l’automobile polyvalente. Indispensable à la vie quotidienne là où habitent la majorité des Français (hors des centres des grandes agglomérations), la voiture fragilise la résilience de ces territoires face aux crises socio-économiques et écologiques. L’industrie automobile focalise son attention, aidée par les pouvoirs publics, sur l’évolution des motorisations, ce qui ne répond en rien à ces problèmes de l’omniprésence automobile.
C’est à la transformation du système automobile lui-même qu’il faut s’atteler. Il s’agit de proposer une transformation radicale des usages de l’automobile, la voiture autrement, non plus voiture individuelle mais une automobile collective et publique ; collective car partagée, publique car régulée. Partagée selon des dispositifs variés, adaptés aux contextes territoriaux, socio-économiques et institutionnels. Régulée dans ses emplois, selon les moments, les lieux, les motifs, les taux de remplissage.
Coalitions d’acteurs
Les mutations à opérer ne jouent pas à la marge : un peu de covoiturage de courte distance, un peu d’automobiles en libre-service, un peu de taxis collectifs… Non, c’est bien une transmutation de système qu’il faut opérer pour peser quantitativement dans l’évolution des chiffres de la mobilité. Les traditionnelles AOT, même récemment transformées par la loi en autorités organisatrices de mobilité, n’ont ni la légitimité politique ni la culture technique et organisationnelle pour porter les projets ad hoc.
La mobilisation concerne l’ensemble des pouvoirs publics, départements, régions et État compris, par exemple pour assurer des voies réservées au covoiturage ; les entreprises et leurs salariés pour rationaliser les déplacements domicile-travail ; et tout ce qui participe d’une mise en réseau des offres et des demandes de déplacement, entre associations d’usagers et applications mobiles. Les innovations portées par le numérique constituent une autre aide précieuse dans le développement de services de mobilité sans couture. Intégrateur de mobilité peut constituer un nouveau métier pour logisticien malin, un business lucratif pour entreprise en quête de relai de croissance.
Des fabricants de pneus aux entreprises du ferroviaire, des géants de l’informatique aux start-up du numérique, les candidats ne manquent pas. Après tout, ne sont-ce pas les frères Michelin qui, voulant élargir le marché des pneumatiques via le développement du réseau routier, ont offert à la France bornes de jalonnement, cartes et guides ? Quid des constructeurs d’automobiles aujourd’hui ? Ne pourraient-ils pas, au moins, considérer que l’innovation technique ne vaut que pensée comme facilitatrice de l’innovation organisationnelle ?
Entre gouvernance de la mobilité et responsabilité sociétale des constructeurs d’automobiles
L’industrie automobile ne peut pas ne pas se soucier des politiques territoriales, de ce qui crée les conditions de ses marchés et de leurs évolutions. Les constructeurs devraient intégrer les acteurs locaux comme des composantes clés de leur système client, alors que leur marketing ne s’adresse historiquement qu’à l’acheteur individuel de voiture. Les acteurs locaux, c’est-à-dire les responsables politiques dans leurs exercices de prospective ; les employeurs, à la fois usagers et opérateurs du système de déplacement, à l’occasion de l’élaboration de leurs plans de mobilité entreprise-administration ; les habitants et les passants réunis pour des démarches de concertation.
Symétriquement, il convient de concevoir une gouvernance politique apte à favoriser sinon piloter la transition vers ce nouveau système automobile. Apte également, au-delà de la prise en compte de l’ensemble des modes de transport, à appréhender la mobilité comme fait social global, intégrant les questions de localisation, de distance et de temporalité. Cela peut se faire sans un énième grand soir institutionnel, si les pouvoirs en place apprennent à coopérer. L’avenir de l’automobile est bien l’affaire de la vie de la cité.
Références
Alfred Sauvy, Les quatre roues de la fortune, essai sur l’automobile, éd. Flammarion, 1968.
Gabriel Dupuy, La dépendance automobile : symptômes, analyse, diagnostic, traitements, éd. Anthropos, collection Villes, 1999.
Thierry Méot, L’industrie automobile en France depuis 1950 : des mutations à la chaîne, Insee Références 2009.
Mathieu Flonneau, Georges Pompidou, président conducteur, et la première crise urbaine de l’automobile, Vingtième Siècle, n° 61, 1999, pp. 30–43.
Jean-Marc Offner, Anachronismes urbains, Presses de Sciences Po, 2020.
Pourquoi faut-il des petits véhicules urbains à forte urbanité ? Comment les développer ?
J.-P. Orfeuil in rapport Keller-Baupin, Les nouvelles mobilités sereines et durables. Concevoir et utiliser des véhicules écologiques, rapport n° 1713 Opecst, Assemblée nationale et Sénat, janvier 2014.






