Le dynamisme de l’économie américaine : une simple question d’attitude ?

Ayant eu l’opportunité de vivre et de travailler pendant plusieurs années à l’étranger – notamment au Japon et aux Etats-Unis – j’ai toujours été particulièrement sensible à la manière avec laquelle chaque culture peut réagir différemment dans des situations semblables. L’observation de ces différences au quotidien permet de se construire une assez bonne compréhension de la mentalité de chaque peuple, et au delà, d’identifier les forces et les faiblesses relatives telles qu’elles ont pu être façonnées par les environnements culturels et socio-économiques. Je me propose d’illustrer cette pseudo-méthode en me concentrant sur le monde du travail aux Etats-Unis et en analysant comment le rapport au travail y est différent.
Le système éducatif
Il faut d’abord constater que notre comportement au travail est fortement influencé par ce que nous avons vécu à l’école. Le rôle du système éducatif, du moins sous une perspective économique, est essentiellement de produire de futurs travailleurs, et la manière dont le moule éducatif aura façonné et filtré ses travailleurs conditionnera leurs comportements dans le monde du travail.
Les différences, dès le plus jeune âge, sont fondamentales : dans le système français, on pose un problème précis à l’élève, on lui fournit des outils et son objectif est d’arriver à la solution à partir de ces outils – notez qu’il s’agit généralement d’une solution unique. Les élèves ne travaillent pas ensemble sur le problème, mais seuls. En pratique ils sont en concurrence puisque celui qui y parvient le plus rapidement est récompensé tandis que celui qui n’y parvient pas est perçu en situation d’échec. Les erreurs par rapport à la solution sont sanctionnées, et on décompte des points par rapport à une note maximale théorique.
Ce système, qui filtre une classe d’âge pour en sélectionner les meilleurs exécutants, les élèves les mieux appliqués et les plus disposés à jouer le jeu du système, conduit à une hiérarchisation de la population des futurs travailleurs, de sorte que, dès sa sortie du système scolaire, chacun est à peu près fixé sur son futur statut et ses prétentions. On préjuge ainsi du potentiel des individus. Ceux qui ont le mieux résolu leurs exercices à l’âge de vingt ans se retrouvent de manière quasi-systématique aux postes de responsabilité de la société.
A l’inverse de sanctionner l’erreur, le système américain va récompenser la créativité, favoriser l’expression et encourager la prise de risque. L’acquisition de connaissances, notamment dans les petites classes, est secondaire par rapport au développement de compétences comme l’écoute et le respect de l’autre, la confiance en soi ou l’argumentation d’une opinion. Dans ce cadre, des disciplines scolaires qui ne sont absolument pas discriminantes en France deviennent ici prépondérantes : les activités sportives, l’expression artistique, la participation à la vie communautaire à travers des charités ou des actions environnementales.
Des statistiques précises existent et classent le niveau scolaire dans chaque pays du monde, par exemple en se basant sur la proportion d’une classe d’âge de chaque pays à pouvoir résoudre une équation du second degré. De mémoire les meilleurs élèves sont asiatiques (coréens et hongkongais), les français sont plutôt bien placés et les américains sont ridiculisés dans les profondeurs du classement. Ce que ne voit pas ce type d’études, c’est justement les différences de comportement qui, indépendamment des connaissances, conditionnent les évolutions futures de ces élèves dans le monde du travail. Pour caricaturer à l’extrême, le stéréotype du français qui réussit bien dans son système scolaire c’est Agnan, le célèbre premier de la classe du Petit Nicolas, tandis que le stéréotype américain est un gaillard athlétique, au savoir certes peu encyclopédique mais en tout cas bien dans sa peau, grand communicant et plein de confiance en lui.
Des choix permanents
En tout domaine, la diversité de l’offre fait que l’américain est sans cesse confronté à des choix. C’est d’abord vrai au quotidien pour de la consommation courante : la concurrence commerciale est si vive que les tarifications et les prestations offertes changent en continu, et le consommateur, constamment sollicité, est fréquemment appelé à remettre en question ces choix, que ce soit pour sa compagnie d’assurance, sa banque ou son fournisseur de télévision câblée…
Mais cette omniprésence du choix existe aussi à un niveau beaucoup plus fondamental : par exemple on choisit dans quelle école on place ses enfants parmi une dizaine d’écoles possibles dans chaque quartier ; les critères de choix sont : les tarifs (l’école est bien sûr payante), les moyens mis à disposition, la politique d’enseignement, l’expérience des enseignants et le statut social des autres parents. On choisit de la même manière sa paroisse, c’est-à-dire la communauté à laquelle on choisit d’appartenir.
L’étudiant américain choisit entre effectuer des études longues (du type PhD) et acquérir rapidement une expérience pratique, quitte à se replonger plus tard dans les études (pour un MBA par exemple). Il choisit son université en fonction de ce qu’il est prêt à investir en frais de scolarité. A la première embauche, il n’est pas tant jugé sur son niveau d’étude que sur la pertinence et la cohérence des choix qu’il a fait.
Devenu travailleur, c’est lui et non son employeur qui choisit ce qu’il va verser en cotisations sociales (les assurances santé, chômage et retraite fonctionnent principalement par des versements volontaires). S’il juge ses revenus insuffisants, la flexibilité du marché du travail lui permet de choisir de travailler durant ses temps libres, par exemple en prenant un deuxième emploi en complément. S’il juge ses connaissances trop limitées par rapport à ses aspirations, il est alors libre d’obtenir un diplôme en cours du soir, ou de quitter son emploi pour reprendre ses études. On le voit son statut n’est pas nécessairement figé et conditionné par ce qu’il a accompli l’année de ses vingt ans.
A l’opposé, le système français ne stimule pas vraiment l’esprit de décision et d’indépendance. Au plus valide-t-on des choix universellement acceptés ; par exemple on ne choisit pas vraiment d’aller en classe préparatoire puis dans une école d’ingénieur, le système nous y conduit naturellement en fonction de nos « performances » scolaires. Et même le « choix » de l’école d’ingénieur est largement influencé par le classement des écoles. Plus tard dans l’entreprise le salaire et les évolutions de carrière sont plus ou moins dictés par une « grille », elle aussi universellement acceptée.
Faire des choix en permanence c’est autant d’occasion de s’assumer en tant qu’individu et de se distinguer des autres. Il en résulte pour l’américain un sentiment d’agir sur sa destinée tandis que le français pourra vite se sentir prisonnier d’un système qui dicte ses choix, même si ce système le traite bien.
Une différente valorisation du travail
Cette dynamique américaine des choix a aussi une importante composante financière. En France, un salarié va concéder de manière obligatoire une part non négligeable de son salaire en cotisations sociales et impôts et obtenir en échange un accès quasiment gratuit aux prestations fondamentales telles que la santé, l’éducation, la prévoyance retraite, etc. Le reste de son salaire, il l’utilise principalement pour réaliser trois fonctions : se loger, se nourrir et se divertir.
Le salarié américain va subir en proportion moins de prélèvements obligatoires sur son salaire, cependant sa responsabilité financière est bien plus grande que celle de son homologue français : avec la somme virée sur son compte bancaire il doit notamment payer l’école de ses enfants ($1,000 par mois et par enfant dès l’école maternelle!), payer ses frais médicaux, mettre de côté pour assurer ses vieux jours (pension plan) et pour payer l’université à ses enfants (college fund), sans oublier bien entendu se loger, se nourrir et se divertir.
Cette forte responsabilité financière se traduit logiquement par une importante valorisation du travail. En France, tout au moins dans l’univers des cadres où évolue la plupart de nos camarades polytechniciens, le monde du travail est avant tout un espace de structuration et de déploiement de la personnalité, un terrain d’action et d’occasions de conquête de la reconnaissance et de l’estime de soi. L’aspect financier y est certes important en tant qu’indicateur quantitatif du degré de reconnaissance, mais en pratique le cadre qui gagne moins que ses collègues n’a pas une vie bien différente. Aux Etats-Unis, cet aspect financier devient prépondérant puisqu’il conditionne des éléments fondamentaux tels que l’accès à des prestations médicales ou la possibilité d’envoyer ses enfants à l’université.
De cette mesure de la performance par l’argent découle une toute autre perception de la nature du temps passé au travail. Les rapports entre collègues sont cordiaux mais généralement superficiels et dénués d’émotionnel. Chacun se concentre sur son objectif individuel et respecte le temps des autres : on ne perd pas de temps à bavarder, les pauses café sont courtes et les réunions expédiées. Le résultat est impressionnant d’efficacité.
Cette approche intéressée par l’argent a le mérite de simplifier le rapport au travail et d’en ôter une grande part de subjectivité. Le revenu obtenu est directement lié à deux facteurs principaux : la nature du travail (elle-même liée au niveau de compétence de l’individu) et le temps passé à travailler. Pour accroitre ses revenus, il suffit donc de monter en responsabilité ou d’augmenter son temps de travail. Pour cette dernière solution, les possibilités ne manquent pas et sont peu limitées par les réglementations : on peut ainsi facilement travailler en heures supplémentaires, prendre un autre « job » pendant son temps libre ou ses vacances, ou encore créer une société et la gérer en plus de son travail.
En France, les contrats de travail interdisent généralement de cumuler plusieurs emplois. Le système de cotisations sociales, lié à une activité, n’accepte pas de couvrir une activité supplémentaire. Les activités libérales sont elles-mêmes si réglementées, notamment au niveau des charges et des horaires d’ouverture des commerces, qu’elles offrent à peine plus de flexibilité que les activités salariées.
Nous avons donc deux environnements fort différents qui conditionnent la notion de valorisation du travail. Dans le cas français, le travail, en continuité de l’éducation, est une composante fondamentale de structuration de la société. Sa valeur est une notion fortement subjective et les possibilités pour un individu d’agir pour faire évoluer cette valeur sont largement limitées par la complexité des mécanismes réglementant la durée du travail et les prestations sociales.
Dans le cas américain, le travail est simplement une source de revenus dont la valeur est dictée par une loi de l’offre et de la demande. La flexibilité du système donne notamment à chacun la liberté de pouvoir accroitre ses revenus en fonction des efforts supplémentaires qu’il est prêt à fournir. En échange de cette liberté, l’américain accepte une certaine précarité de l’emploi. La perte d’un emploi est perçue comme une conséquence directe d’un marché du travail régi par l’offre et la demande. Elle met en évidence le besoin constant de se remettre en cause et d’ajuster ses compétences sur un marché compétitif. La courte durée d’indemnisation des chômeurs constitue en outre une forte incitation à se réajuster rapidement. Pour reprendre une formule fréquemment employée, « la France a des amortisseurs là où les Etats-Unis ont des ressorts ».
L’entreprenariat
Au-delà de la condition salariale, ces valeurs que sont l’innovation, le dynamisme, l’initiative privée, le goût du risque et la recherche du profit sont surtout de formidables moteurs de création d’entreprise. A l’opposée de la conception française de l’état jacobin, ordonnateur de l’économie et qui a favorisé une culture de grande entreprise et de fonctionnariat, la vision américaine place l’entrepreneur au centre de la société. Pour Thomas Jefferson, c’était même un des fondements de la nation américaine : « La meilleure des sociétés est celle qui se compose du plus grand nombre possible d’entrepreneurs indépendants […] seuls responsables de l’organisation de leur travail et ne recevant par là même d’ordre d’aucun mortel ».
En France, « se mettre à son compte » représente généralement une rupture par rapport au système par défaut qu’est le salariat et cela comporte une forte connotation de risque et d’incertitude. Aux Etats-Unis, c’est le résultat d’une démarche naturelle vers une situation d’indépendance totale – c’est une manière d’acquérir sa liberté. Créer une entreprise est d’ailleurs une simple formalité administrative (il suffit de passer un coup de téléphone et de payer $400 par carte bancaire pour enregistrer une société) et les banques proposent facilement des financements. « Tenter sa chance » y est beaucoup plus accessible que cela ne l’est en France, dans les mentalités comme dans les faits. L’échec n’y est pas redouté de la même manière et il est courant de voir alterner des situations indépendantes avec des périodes d’activité salariée.
Contrairement à l’image de l’entrepreneur français, patron de PME, plutôt conservateur et qui gère son affaire en bon père de famille, l’entrepreneur américain se place aux avant-postes de l’économie américaine dont il symbolise la modernité. Sa vitalité, sa capacité à s’investir et son esprit pionnier représentent un immense potentiel de croissance pour l’économie américaine.
Conclusion
Dans les lignes qui précèdent, j’ai présenté nos travailleurs américains comme des individus sans complexe, confiants, responsabilisés dans leur choix et motivés. A l’inverse, j’ai caricaturé le français en un individu rescapé des filtres successifs d’une éducation-sanction, qui aurait suivi des voies toutes tracées pour finalement mériter d’être positionné dans telle ou telle case d’un système dont il est un acteur passif. Je concède que cette vision est partiale et largement incomplète. Elle exclue les atouts français (citons l’esprit cartésien, la richesse culturelle, le souci d’égalité) et masquent les limites américaines (l’arrogance, le désert culturel, l’individualisme et l’importance excessive de l’argent).
Cette approche, bien que grossière et exagérée, apporte cependant l’éclairage suivant sur le monde de l’entreprise aux Etats-Unis : l’américain est le produit d’un système éducatif qui favorise les interactions et encourage l’initiative, d’un environnement qui lui impose de prendre des décisions et de les assumer, de contraintes financières et sociales et d’une mesure de la performance par l’argent qui le motivent à se concentrer sur l’efficacité de son travail. Cette attitude et le rapport au travail qui en découle sont des atouts considérables pour l’économie américaine.


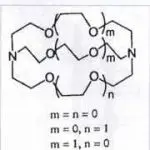
Commentaire
Ajouter un commentaire
Très bien vu
Je confirme ton analyse.
Petit détail : oui, l’école publique gratuite existe bien aux Etats-Unis, mes enfants y sont allés, et elle peut-être de bonne qualité.