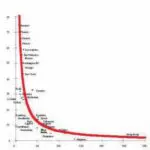Les mégapoles face aux risques et aux catastrophes naturelles


Qu’ils soient d’origine hydroclimatique (dont les catastrophes représentent 79% de l’ensembles des catastrophes naturelles du XXè siècle), sismiques ou volcaniques, les risques doivent être analysés en fonction de la vulnérabilité des espaces urbains qui, elle-même, dépend de multiples facteurs. Malgré la difficulté, la gestion des mégapoles doit tous les intégrer et égalament évaluer les effets induits d’une catrastrophe naturelle. Mais l’inégalité face aux risques continuera d’être forte entre villes de pays riches et des pays pauvres et le le risque de représenter un indicateur des inégalités sociales.
Au début du troisième millénaire, 47,2 % de la population est urbaine, 75 à 80 % de cette population se regroupe dans les grandes villes. En 2015 la planète devrait porter, dans les conditions de croissance actuelle, 33 villes dépassant 8 millions d’habitants, 33 mégapoles au sens strict, la plupart étant situées sur des espaces littoraux, ce qui renvoie à la question du réchauffement climatique et à ses effets sur ces villes littorales. Quatre mégapoles font exception : São Paulo, Mexico, Delhi et Pékin. Six seulement de ces grandes mégapoles devraient être dans les pays riches du Nord : Tokyo, New York, Los Angeles, Osaka, Paris et Moscou. Existe-t-il des risques spécifiquement urbains ? Le risque est-il inhérent aux systèmes urbains ? Est-il, dans ce cas, indicateur d’un dysfonctionnement de la ville et de son organisation ? Peut-on considérer que la ville ne fait qu’aggraver les effets des aléas qui s’expriment ailleurs et qui seraient d’origine exogène ? Quel sens faut-il donner à l’existence de risques en ville alors que la ville a été perçue pendant longtemps comme » l’espace protecteur « , le lieu sécuritaire dans lequel on se réfugiait à l’abri des murailles quand la campagne était parcourue par les bandes armées (au Moyen Âge notamment).
L’évolution des systèmes urbains actuels, notamment le processus de métropolisation ou la constitution de ce que les Anglo-Saxons appellent megacities, » villes géantes « , ne porte-t-elle pas en germe une vulnérabilité d’un type nouveau et donc de facto une augmentation des risques ? Ne faut-il pas distinguer des situations différentes entre mégapoles des pays riches et mégapoles des pays pauvres ?
Toutes les villes, et plus encore les mégapoles, se caractérisent par des risques induits, des risques différés, par une chaîne de risques qui associe risques naturels, risques technologiques, risques économiques, risques sociaux ou géopolitiques. Il est de plus en plus difficile de ne traiter que du risque naturel.
De nombreuses grandes villes sont soumises à des processus naturels que l’on nomme aléas, elles subissent plus ou moins régulièrement des catastrophes. Il faut distinguer risque et catastrophe. Le risque est un » objet social » qui s’analyse en termes de représentation, de perception du danger. Les catastrophes, au contraire, s’envisagent en termes de coûts, en termes de reconstruction, de réaménagement, de réhabilitation. La conscience du risque résulte en général du déroulement d’une crise ou d’une catastrophe ; à partir de cet événement souvent dramatique et qui peut se reproduire, on réalise ce que l’on nomme » un retour d’expérience » qui conduit à la prise de conscience du risque.
Le risque se décline en termes de prévention, il doit être intégré aux politiques d’aménagement du territoire tandis qu’il convient d’anticiper la catastrophe afin d’établir des scénarios adaptés permettant la gestion la plus rapide et la plus efficace de l’événement lors de son déclenchement.
Comment définir le risque naturel ? Le risque qui inclut l’aléa, et l’expression de cet aléa sur un espace vulnérable, est composé de deux pôles fondamentaux, l’aléa et la vulnérabilité.
La variété des aléas affectant les mégapoles
Ils se répartissent en deux groupes, les aléas hydroclimatiques et les aléas d’origine géologique (séismes, volcans, tsunamis, mouvements de terrain) (figure 1).
Les aléas hydroclimatiques : ils sont nombreux. Évoquons les tempêtes de neige à Montréal, à New York, ainsi que la canicule dont l’Europe nous a fourni un exemple récent. Les épisodes prolongés de sécheresse comme les précipitations très abondantes sont aussi source de danger pour les populations. Ces gros abats d’eau peuvent être dus aux ouragans qui balayent fréquemment les régions intertropicales et affectent les façades est des continents où se situent un certain nombre de grandes villes, en Chine, au Japon et des villes américaines (Floride). Liés à ces ouragans s’ajoutent l’effet de vents très violents, des inondations et des mouvements de masse ainsi que des phénomènes littoraux spécifiques de surcote. Les inondations en Europe peuvent certes être associées à des épisodes de tempêtes, mais dans la plupart des cas elles relèvent d’autres événements climatiques (série de perturbations d’ouest ou très fortes pluies d’automne en périphérie de la Méditerranée). Le processus de l’inondation, défini comme l’étalement du cours d’eau dans son lit majeur ou lit d’inondation, résulte donc simplement du débordement de ce cours d’eau, mais il peut également être dû à la remontée des nappes, au ruissellement pluvial ou au débordement des réseaux ; dans beaucoup de cas, ces causes se combinent et expliquent l’ampleur du processus.
Les catastrophes d’origine hydro-climatique constituent 79 % de l’ensemble des catastrophes naturelles du xxe siècle ; elles l’emportent largement sur celles générées par les processus géologiques (21 %). Statistiquement, les inondations ne sont pas à l’origine du plus grand nombre de victimes mais provoquent un grand nombre de sinistrés. Il reste qu’une seule inondation affectant une mégapole (Dacca par exemple) ou une région très peuplée en Chine peut entraîner de nombreuses victimes.
Les aléas sismiques concernent les grandes villes de la bordure pacifique où Los Angeles, San Francisco, les villes des Andes (Quito, La Paz…) et du Japon (Tokyo, Kobe…) sont menacées. Ces aléas sont importants sur le vaste domaine d’affrontement des plaques qui s’étire du Portugal en Chine : ainsi Lisbonne, Alger, Athènes, Istanbul, Téhéran… sont directement concernées. Liés aux aléas sismiques, il faut compter aussi avec les tsunamis. Les mouvements de masse peuvent également affecter des quartiers entiers de certaines grandes villes ; c’est le cas à Rio de Janeiro où l’installation de quartiers informels sur les pentes des » demi-oranges » recouvertes de grandes épaisseurs d’altérites aggrave l’instabilité de ces formations superficielles et favorise leur glissement.
Carte des zones d’aléas sismiques, volcaniques et cycloniques
Source : Y. Veyret, “ Géographie des risques naturels ” –
Documentation photographique, Documentation française, 2001.
L’aléa volcanique est parfois associé à l’aléa sismique, mais ce n’est pas systématique. Il concerne les villes andines, les villes japonaises, celles d’Indonésie. Un peu plus de la moitié des volcans actifs et 55 % des épicentres des failles actives ou très actives se localisent dans l’espace intertropical qui ne représente que 25 % de la surface des continents.
Les actions anthropiques peuvent aggraver, voire provoquer aléas et risques naturels. Ainsi la construction des barrages sur le Mississipi explique la diminution de la masse de matériaux arrivant à la côte et en conséquence le recul du delta, au moins localement. Cette situation augmente les risques d’inondation enregistrés par la Nouvelle-Orléans. La subsidence liée au pompage d’eau ou de pétrole peut aggraver les inondations dans certaines villes littorales comme c’est le cas à Bangkok. Il faut insister aussi sur le rôle du réchauffement climatique, qui en dépit des interrogations qu’il suscite encore, ne manquera pas d’avoir des effets gravissimes sur les mégapoles littorales.
La vulnérabilité
Outre les aléas, l’élément clé de l’analyse du risque est la vulnérabilité des espaces urbains et notamment des mégapoles. La vulnérabilité est humaine, socioéconomique, institutionnelle. Elle inclut l’existence ou l’absence de mesures de protection que certains pays prennent et d’autres non. Elle met en question la résilience de la société face à ces » crises » d’origine naturelle. Le fait que la population de certaines villes des pays en développement continue à accepter le risque et la catastrophe, encore largement considérés comme envoyés par Dieu ou le diable, est un facteur supplémentaire de vulnérabilité.
La vulnérabilité implique une approche systémique, indispensable mais complexe notamment quand il s’agit d’analyser la ville et plus encore la mégapole. La ville multiplie, amplifie, diversifie les facteurs de vulnérabilité, laquelle découle du fonctionnement même de la ville, de ses logiques d’organisation spatiale et des dynamiques territoriales. Les aspects économiques, sociaux et organisationnels, le patrimoine, les éléments environnementaux peuvent être des facteurs de vulnérabilité comme l’indique le tableau 1.
L’exemple des inondations permet d’insister sur quelques aspects de la vulnérabilité des mégapoles. Celle-ci tient à des raisons historiques – au fait que beaucoup de ces villes sont implantées au bord de l’eau par exemple -, à des raisons économiques et spatiales – l’espace est précieux ce qui conduit parfois à utiliser des terrains à risque. Des raisons techniques peuvent s’ajouter telles que l’interdépendance des réseaux souvent mal calibrés et incomplets (Le Caire ou Buenos Aires). La ville contribue à augmenter le risque en diminuant les possibilités d’infiltration des eaux, en concentrant les flux.
Dans bien des cas, l’ampleur de l’aléa ne justifie pas l’ampleur de la catastrophe : le facteur expliquant l’importance des dégâts, voire le nombre de victimes relève largement de la vulnérabilité.
La difficile gestion du risque dans les mégapoles
Gérer le risque en prenant en compte tous ces éléments est extrêmement difficile. C’est notamment le cas dans les mégapoles des pays pauvres où les flux de population originaires des campagnes viennent souvent s’installer dans des quartiers informels précisément situés dans les espaces les plus dangereux (Le Caire, Yaoundé, Rio de Janeiro, Istanbul…).
Les gestionnaires ont beaucoup de difficultés à maîtriser les questions foncières et très souvent ils ne disposent pas de législation applicable (ou vraiment appliquée) de prévention des risques. Dans ces mégapoles la pauvreté contribue à accroître le risque. L’indice de développement humain (IDH), créé par les Nations unies, est un marqueur de cette vulnérabilité (faibles revenus, analphabétisme, moyens réduits en matière de santé). Le risque renforce la ségrégation sociospatiale : les espaces à risque sont, dans la plupart des cas, consacrés aux populations les plus pauvres ; ainsi à Rio de Janeiro, les favelas les plus exposées sont sur les pentes instables des » demi-oranges » ou dans des bas-fonds mal drainés.
La gestion des risques dans une mégapole de pays riche n’est pas toujours aisée. L’existence de centres anciens à forte valeur patrimoniale en témoigne, ils sont rarement adaptés aux risques. Ainsi, la reprise des bâtiments anciens pour les adapter au risque sismique n’est pas forcément possible ; elle est, à tout le moins, coûteuse. Il en va de même dans les zones inondables des quartiers historiques de Paris. Mais que dire des réseaux (métropolitain, RER…) dont l’implantation s’est faite indépendamment de toute intégration du risque ?
La gestion des mégapoles doit donc intégrer tous ces facteurs et évaluer les effets induits d’une crise (catastrophes naturelles agissant sur certaines installations industrielles sensibles, effets économiques, dégradation de l’image de la ville…). Une telle évaluation se révèle particulièrement difficile et cela d’autant plus que les grandes métropoles fonctionnent désormais en réseau dans le cadre de la mondialisation. Les travaux récents du ministère de l’Intérieur portant sur l’agglomération parisienne en témoignent. Une grande inondation de type 1910 à Paris aurait des effets désastreux pour la population parisienne. Sur le plan économique, cela se traduirait par des pertes pour les entreprises dans l’agglomération mais les conséquences par le biais des effets induits affecteraient d’autres espaces français, européens voire mondiaux de manière difficilement chiffrable. De même des chercheurs japonais ont envisagé les conséquences qu’aurait un séisme de même intensité que celui de 1923 à Tokyo ; il en résulterait un nombre considérable de victimes et la nécessité, pour reconstruire la mégapole, de rapatrier les capitaux japonais épars dans le monde, ce qui aurait des effets difficilement calculables pour l’économie mondiale et serait peut-être responsable de l’effondrement de celle-ci.
À la suite ou parallèlement à des politiques de protection conduites depuis longtemps (digues, barrages pour prévenir les inondations) et qui dans bien des cas ont montré leurs limites, la prévention des risques a pris une réelle ampleur dans certaines villes des pays riches. Des zonages de l’espace urbain sont proposés, imposés par l’État en France, ou plus ancrés dans le local en Angleterre et au pays de Galles (l’Écosse dispose d’une autre organisation administrative en matière de gestion des risques). En revanche dans les pays du Sud, la prévention est peu développée faute d’un pouvoir suffisant pour établir et faire appliquer les réglementations d’urbanisme, par méconnaissance du fonctionnement de la ville et en raison souvent du poids du foncier.
Comment la mégapole réagit-elle à la catastrophe ?
On parle de capacité d’adaptation ou de résilience, définie comme l’aptitude de la ville à réagir aux perturbations que sont les catastrophes naturelles dans le but de retrouver un état proche de la situation de départ. Les facteurs qui favorisent la résilience semblent relever d’une bonne santé économique du pays et de la ville, d’une technologie suffisante, d’infrastructures et d’institutions efficaces. Il est évident que les capacités d’adaptation sont supérieures dans les pays riches à ce qu’elles sont dans les autres. Le port de Kobe a été reconstruit au plus vite après le séisme de 1995 pour maintenir les activités de commerce au Japon et plus précisément dans la ville, mais cela a été possible parce que le Japon a pu consacrer des finances suffisantes pour une telle réparation. Qu’en serait-il dans une mégapole d’un pays pauvre où certaines catastrophes naturelles engloutissent une part importante du PNB ? Peut-on aller plus loin que ce constat d’évidence ? La résilience, qui suscite encore de nombreux travaux notamment américains, est-elle un concept opérationnel pour la gestion du risque affectant les mégapoles ?
En conclusion, il est utile de rappeler que la gestion des risques naturels ne peut se suffire de réponses techniques mais implique une vision pluridisciplinaire qui la rend particulièrement difficile à aborder. Les nouveaux aménagements effectués dans une ville devraient être réalisés en intégrant les risques naturels. En revanche, quand la ville existe, la gestion du risque se révèle bien plus problématique. S’il est totalement utopique de penser atteindre le risque zéro, il faut tout de même rappeler l’inégalité criante face aux risques entre populations et villes des pays riches et des pays pauvres. Le risque est finalement un indicateur des inégalités sociales et des dysfonctionnements socioéconomiques et spatiaux.