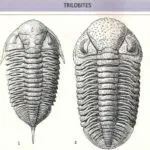L’Europe et l’emploi après Amsterdam (deuxième partie)
L’organisation des marchés du travail est fortement diversifiée selon les pays : elle y reflète le legs d’une assez longue histoire et les lignes de force de la culture nationale ; ceci se manifeste dans les cultures d’entreprise, dans le fonctionnement des relations entre les partenaires sociaux (et dans l’organisation même de ceux-ci), dans le dialogue entre ceux-ci et l’État, dans la mise en œuvre de l’État-providence, la liste pourrait être allongée1. Il en résulte que c’est essentiellement par des décisions de caractère national adaptées aux caractéristiques de la population et, grâce à cela, acceptables par celle-ci, qu’on peut cheminer un peu loin sur la première piste. Nous sommes là dans un cas type d’application de la subsidiarité telle qu’elle est requise par l’article 3 B du traité de Maastricht. Mais il faut vérifier, au niveau communautaire, que ces décisions nationales ne viennent pas perturber et fausser le jeu du grand marché, on va y revenir.
Il en va autrement pour la seconde piste. Du fait notamment de l’achèvement du marché intérieur, les économies des divers pays membres sont devenues de plus en plus interdépendantes et sensibles chacune aux politiques économiques menées par les partenaires. En même temps, des mesures prises dans un pays, par exemple pour stimuler l’activité économique, peuvent, pour un pays ouvert, perdre une partie de leur efficacité interne escomptée. Ce n’est alors que par une stratégie concertée et coopérative qu’on peut obtenir les résultats espérés des politiques économiques. Celle-ci doit être définie de façon communautaire, même si, du fait des disparités de structure et de situations conjoncturelles, le choix des instruments et leur ampleur même doivent souvent différer d’un pays à l’autre.
Enfin, pour la troisième piste, la réponse est inévitablement plus nuancée. L’objectif de la construction européenne est fondamentalement politique : donner au continent les moyens de définir et de réaliser le style de société répondant le mieux à ses valeurs fondamentales, lui permettre de jouer un rôle de premier plan dans les affaires mondiales, au service de la paix et du développement de la planète. Dans cette vision, les adaptations sociétales devraient être l’œuvre, non seulement simultanée, mais conjointe des États membres et des institutions communautaires : réfléchir en commun sur les évolutions souhaitables, lancer en commun des projets qui ne peuvent être menés à bien qu’à plusieurs (on en trouve de nombreux exemples dans le domaine de l’environnement) ou font jouer des synergies (on peut penser à certaines orientations de la recherche), mais à l’inverse laisser à chaque pays, en fonction de ses spécificités économiques, sociologiques et culturelles, le soin de s’engager plus ou moins vite dans certaines directions (par exemple sur la réduction du temps de travail ou la répartition des revenus). On se trouve ici dans un cas type où la subsidiarité se traduit par la concomitance de responsabilités aux divers niveaux décisionnels, dont il faut assurer la cohérence.
On va d’abord préciser le rôle possible de l’Europe, puis apprécier la portée des avancées réalisées en 1997 et prévues pour 1998.
I – QUEL RÔLE POSSIBLE POUR L’EUROPE ?
Le rôle possible de l’Europe peut être précisé sous quatre aspects principaux : l’autonomie surveillée d’organisation des marchés nationaux du travail, la complémentarité des politiques de structure, la coordination des politiques macroéconomiques, la stratégie extérieure de l’Union.
1 – Une autonomie d’organisation des marchés nationaux du travail ample, mais surveillée
Il a toujours été admis, tant par le traité de Rome lui-même que par la pratique communautaire, qu’il s’agissait là d’un marché ayant une certaine singularité parce que l’élément concerné, le travail, a une profonde spécificité et bénéficie de ce fait d’une politique propre, la politique sociale. L’article 118, qui fait partie du titre VIII, Politique sociale, dit que « la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les États membres dans le domaine social ». L’article 117 parle « du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives », l’article 118 B dit que « la Commission s’efforce de développer le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen, pouvant déboucher, si ces derniers l’estiment souhaitable, sur des relations conventionnelles ». Tous ces textes laissent une assez large autonomie aux actions nationales. (Il en va de même pour l’article 100, concernant l’harmonisation des législations ou réglementations.)
De même, dans la pratique, on a toujours admis que chaque État avait le droit d’intervenir dans la détermination des salaires, que ce soit par la fixation d’un salaire minimum et de règles pour la croissance de celui-ci ou, en sens inverse, par la suggestion de plafonds de hausse à ne pas dépasser lors des négociations entre partenaires sociaux et fixés par référence à la hausse possible de la productivité, de façon à assurer la compatibilité avec l’objectif macroéconomique de stabilité du niveau général des prix. Le marché du travail est trop le reflet d’un certain type de société pour qu’on ne doive pas laisser à chaque État membre une très large autonomie pour son organisation.
Toutefois, il faut veiller à ce que l’organisation des marchés du travail ne soit pas en contradiction avec l’objectif du marché unique ; il faut donc surveiller au niveau communautaire les décisions prises dans chaque pays qui sont susceptibles d’influencer le marché du travail. Si celles-ci découlent d’une volonté de modifier le fonctionnement de la société, elles peuvent a priori être considérées comme légitimes : ce sera le cas de ce qui touche l’État-providence ; si par contre elles sont l’expression d’une volonté de modifier les conditions de concurrence avec les partenaires, elles sont a priori à surveiller (par analogie avec le principe de l’article 92 de la surveillance des aides d’État) : ce pourrait par exemple être le cas d’une modification de conditions ayant une influence sur la localisation des entreprises (stimulation à des délocalisations compétitives). Mais, comme pour l’article 92 relatif aux aides de l’État, surveillance ne veut pas dire interdiction.
En résumé, la règle doit être : autonomie de principe des États dans l’organisation de leur marché du travail, mais autonomie surveillée ; il n’y a guère de place pour de strictes décisions à appliquer uniformément dans tous les pays et plus l’Union s’élargit, plus grandit l’aspiration au respect de la diversité pour un ensemble de règles qui touchent profondément l’individu sur des points aussi sensibles que les conditions d’embauche et de licenciement ou les modalités de négociation des rémunérations salariales. Toutefois la Communauté peut jouer un rôle de tout premier plan dans l’information et la stimulation d’initiatives et peut ainsi proposer aux Quinze d’adopter des résolutions menant dans les divers pays à des actions d’esprit comparable, mais dont les modalités peuvent être diversifiées pour tenir compte des habitudes et des cultures nationales.
La forte diversité des marchés nationaux du travail est ainsi unanimement reconnue, la nécessité, voulue par les populations, de la respecter, est largement acceptée d’où à plusieurs reprises l’affirmation par le Conseil que la lutte contre le chômage relève prioritairement des responsabilités nationales2.
2 – Marché intérieur et complémentarité organisée des politiques de structure
Si l’influence sur le volume global de l’emploi en Europe de l’achèvement du marché intérieur prête à controverse (les estimations de la Commission dans le rapport Cecchini ayant généralement paru excessives), par contre son impact possible sur un bon emploi (au sens d’un emploi efficace) paraît certain, par une stimulation à une bonne orientation des productions sous l’angle des localisations et d’un renforcement des spécialisations dans les domaines où l’Europe a des avantages comparatifs (notamment les techniques avancées) ; par contre, dans la mesure où, renforçant la concurrence, il pousse aux investissements de productivité plus encore qu’à ceux de capacité, son impact à court terme n’est pas évidemment favorable ; toutefois, à moyen terme, le solde à escompter est certainement positif. D’où l’utilité de continuer à se consacrer activement à son achèvement, pour que les adaptations des économies nationales se fassent dans un sens qui prépare correctement le futur ; cela implique notamment la poursuite du rapprochement des fiscalités (et tout particulièrement la fiscalité sur les revenus des capitaux) ainsi que la mise en œuvre de la politique de concurrence au service d’une véritable stratégie de développement à moyen ou long terme d’une Union toujours plus fortement immergée dans le contexte mondial.
De plus, dans tous les pays, de nombreuses actions ponctuelles en faveur de l’emploi visent à agir par le biais d’une modification des structures de production, sous les aspects aussi bien sectoriels que techniques.
De son côté, la Communauté met en œuvre (ou a vocation à mettre en œuvre) plusieurs politiques qui ont une influence (directe et voulue ou plus indirecte) sur les structures de production de l’économie européenne. Mentionnons notamment les politiques relatives à l’industrie, à l’énergie, à la recherche et au développement technologique, à la concurrence (art. 85 à 94), à la cohésion économique et sociale (fonds structurels), à l’environnement, ainsi que les réseaux transeuropéens, la politique de transport, la politique agricole, enfin la politique commerciale commune.
Dans de multiples domaines (à l’exception en principe de la politique commerciale extérieure), la subsidiarité ne se traduit donc pas par du tout ou rien, mais donne lieu à la coexistence d’actions nationales et d’actions communautaires : cela vaut en fait pour les principales politiques à impact structurel. Certes, l’importance relative du national et du communautaire peut différer d’un domaine à l’autre, et également d’un pays à l’autre, en fonction des réalités et des conceptions économiques, mais entre les diverses politiques nationales et entre celles-ci et les politiques communautaires, il faut veiller à éviter les incompatibilités et à assurer les synergies3.
Le souci d’éviter les incompatibilités apparaît en deux endroits principaux du traité : à l’article 92 (compatibilité des subventions à base de ressources d’État avec le bon fonctionnement du marché) et à l’article 100, qui concerne les réglementations édictées de façon autonome par les États membres. L’exploitation de synergies peut être visée par la recherche d’une double cohérence, d’une part au sein de chaque domaine entre les politiques nationale et communautaire, d’autre part entre les politiques menées dans les divers domaines. Ces deux aspects sont évoqués dans le traité : ainsi, par exemple, pour le premier (art. 130 H) « La Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d’assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire » ; pour le second (art. 130 R) « Les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté ».
Mais ces stipulations restent générales et aucun mécanisme n’est prévu pour organiser cette cohérence.
Cela tient à ce que, si le souci d’une suffisante cohérence entre les actions à impact structurel se manifeste depuis le début du fonctionnement de la CECA (Charbon-acier), c’est-à-dire depuis 1951, il se heurte à des divergences de vues. Tout d’abord, il y a l’opposition entre ceux qui regardent avec une extrême méfiance toute intervention publique à caractère structurel4 et ceux qui sont plus interventionnistes5. Il y a ensuite la difficulté de définir, dans une Europe largement ouverte sur l’extérieur, une stratégie structurelle en l’absence d’une politique étrangère. Enfin se manifeste une forte réticence à un financement communautaire de la part des pays contributeurs nets au budget de l’Union : cela explique la modicité du programme européen de recherche (quelques pour cents de l’effort global du continent) et surtout l’incapacité où s’est trouvée la Communauté (le Conseil des Ministres) de mettre en œuvre le programme de grands travaux concernant les réseaux européens, dont le principe avait cependant été accepté à plusieurs reprises par le Conseil européen (qui n’est pas l’institution décisionnelle en la matière).
De plus dans le traité de Maastricht, cependant rédigé à une période de fort chômage, nulle part n’apparaissait explicitement l’objectif de plus d’emploi et d’un meilleur emploi. On a donc depuis quelques années amplement débattu l’idée d’ajouter dans la pratique une considération supplémentaire relative à l’emploi. Ceci paraissait d’autant plus urgent que la persistance du chômage (même s’il y a des fluctuations annuelles) pourrait conduire la plupart des gouvernements à intervenir de plus en plus, accroissant le risque d’incohérences, d’incompatibilités, de contradictions avec l’esprit de l’économie de marché, base du traité. Dans le même temps, les interventions de la Commission, comme gardienne du traité, sur la base du titre V, chapitre premier (les règles de concurrence), seront de moins en moins acceptées par les populations si elles ne sont pas clairement expliquées et justifiées par les responsables, en montrant qu’elles sont bien conformes à l’objectif prioritaire pour ces dernières, l’amélioration de l’emploi.
3 – Une coordination poussée des politiques macroéconomiques
La politique macroéconomique utilise deux instruments essentiels, la politique monétaire (sous ses aspects interne et externe) et la politique budgétaire (volume, structure, ampleur du déficit des budgets publics). Aussi bien pour un bon fonctionnement du marché intérieur que du fait des interdépendances croissantes entre les économies des pays membres, il est de moins en moins possible de laisser chaque État européen définir à sa guise sa politique macroéconomique.
Le marché unique, dont la raison d’être principale est de favoriser la spécialisation la plus efficace des divers pays ou régions et l’exploitation complète des économies de dimension, ne joue pleinement ce rôle que si les opérateurs disposent d’informations comparables et d’égale qualité sur les conditions de production et sur la demande des diverses régions de l’Europe ; à côté d’un gros effort d’harmonisation statistique, cela suppose une très forte stabilité des taux de change, d’où la marche actuelle vers une monnaie unique, l’euro, et une politique monétaire unique, venant donc remplacer des politiques monétaires plus ou moins coordonnées.
Mais l’intensification des interdépendances entre économies nationales exige qu’on aille plus loin, pour deux raisons. Tout d’abord, on a toujours reconnu que plus les relations commerciales sont intenses, plus l’effet national d’une stratégie budgétaire nationale dépend de ce que font les voisins, et réciproquement, plus chacun est influencé par ce que font les autres : premier argument pour organiser au minimum une confrontation des projets, mieux une coordination.
D’autre part, les pays qui vont participer à l’union monétaire seront privés de l’instrument monétaire pour réguler leur économie. Les ajustements macro-économiques face à des chocs, extérieurs ou intérieurs, ne pourront se faire que, soit par une modulation des budgets, soit par un impact sur le volume de l’emploi ; en cette période de chômage, les pays chercheront souvent à utiliser l’instrument budgétaire, d’où une raison supplémentaire pour en assurer la cohérence par une certaine coordination.
Conscient de ces perspectives, le traité de Maastricht, prolongeant d’ailleurs le traité de Rome, a prévu que (article 103.1) « Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d’intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil », la procédure prévue comprenant, sur base d’une recommandation de la Commission, l’adoption par le Conseil européen des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté, puis des interventions plus détaillées du Conseil.
Mais ceci ne concerne que la politique économique, soigneusement distinguée de la politique monétaire. Reste alors à assurer la synergie des deux. Pour cela deux schémas alternatifs profondément différents S1 et S2 sont envisageables. En négligeant les nuances, on peut les résumer ainsi :
Les deux schémas diffèrent, on le voit, sur trois points :
- la hiérarchie des objectifs, dans la mesure (discutée) où ils sont substituables,
- la nature des décideurs fondamentaux : soit une autorité monétaire indépendante et une autorité politique (décidant le budget) enfermée dans certaines contraintes, soit une dualité d’autorités, dont les relations doivent être soigneusement définies à l’avance si on veut éviter des conflits,
- une fixation à l’avance de règles quantitatives, ou au contraire le recours à des choix ad hoc fortement inspirés par les réalités, économiques, mais aussi politiques, du moment6.
Par référence aux deux schémas décrits ci-dessus, la lettre du traité de Maastricht se situe entre les deux, mais plus près du premier S1, notamment du fait que les stipulations relatives à la politique monétaire sont beaucoup plus précises – et contraignantes – que celles relatives à la politique économique. Mais il est à peu près unanimement reconnu depuis au moins deux ans que l’organisation de la compatibilité des divers volets de la politique macroéconomique doit être améliorée. C’est là que les divergences se sont progressivement révélées.
Certains protagonistes se sont coulés dans le premier schéma ; insistant sur la priorité de la stabilité des prix et se méfiant à cet égard du laxisme des pouvoirs politiques (et de sa traduction en termes de déficit budgétaire), ils ont proposé – puis exigé – qu’on se mette d’accord à l’avance sur un cadre contraignant pour les politiques budgétaires futures.
Les autres, plus sensibles à l’idée que l’économie n’est pas une fin en soi, mais doit être mise au service d’un bon fonctionnement de la société, et très préoccupés par le problème du chômage, souhaitent que ce soit au terme d’une analyse politique que soit en définitive défini le type d’évolution économique qu’on souhaite pour la société, en l’occurrence pour l’Union européenne.
Les tentatives de rapprochement des points de vue, menées dans diverses enceintes (politiques ou académiques) depuis deux ans, buttent en fait sur un point : si à peu près tout le monde reconnaît qu’il est raisonnable, pour la définition de la politique économique, de se doter d’un certain nombre de garde-fous définis à l’avance et qu’il faudra respecter, le désaccord de fond porte sur l’ampleur de la marge de jeu que laissent ces contraintes : les uns la veulent très limitée, alors que les autres estiment que, dans un monde aussi mouvant que le nôtre, il faut être en mesure de s’adapter, et notamment de ne pas laisser les adaptations se faire de façon excessive par la variation d’une variable socialement aussi décisive que l’emploi.
Les uns se méfient de l’orgueil qu’il y a à vouloir pratiquer une politique prétendument adaptée aux besoins de chaque moment, les autres de l’orgueil qu’il y a à prétendre connaître et fixer à l’avance la marge de jeu qui sera suffisante. Tous se méfient d’un comportement trop prométhéen, mais pas de la même façon.
En ce qui concerne plus particulièrement l’emploi, il y a ainsi un manque d’accord moins sur le caractère important de cet objectif (reconnu par tous) que sur les meilleurs moyens de l’atteindre ; un des points les plus délicats porte sur le rôle de la politique budgétaire (et, en conséquence, sur le nécessaire degré de coordination des politiques budgétaires nationales) et sur l’articulation entre les politiques monétaires (demain la politique monétaire commune) et budgétaires ; en particulier, doit-il y avoir prééminence de l’une d’entre elles (la monétaire), menée au service de l’objectif prioritaire de stabilité des prix et entraînant des obligations imposées aux politiques budgétaires ou les met-on a priori sur un pied d’égalité et recherche-t-on de façon coordonnée leurs meilleurs contenus (l’idée du policy mix optimal) en fonction des réalités économiques du moment ?
4 – Une véritable stratégie extérieure de l’Union
C’est par ses deux volets économiques, le commercial et le monétaro-financier, que la stratégie extérieure de l’Union peut influencer l’emploi dans celle-ci.
L’organisation du commerce international est confiée à un organisme (d’abord le GATT, puis maintenant l’Organisation mondiale du commerce) qui a un mandat précis et limité : libéraliser au maximum les échanges internationaux. Ce mandat constitue pour lui – et c’est normal – son objectif unique, mais il ne peut en aller de même pour l’Union, qui doit équilibrer les objectifs d’efficacité économique au sens strict et d’autres objectifs, dont ceux d’emploi. La conception communautaire de la PCC (politique commerciale commune) devrait donc se définir comme un élément, parmi d’autres, dans une vision d’ensemble de l’évolution à moyen terme de l’Union.
Les attitudes sur ce point ne sont pas identiques entre experts et entre pays. Certains considèrent que l’objectif d’ouverture est prioritaire : seule celle-ci permet la spécialisation optimale des activités, conçue comme celle qui, pour un certain volume de facteurs de production, procure le volume maximal de production de biens et services ; toute limitation des échanges (toute mesure protectionniste) est ainsi génératrice d’une perte. D’autres ne nient pas la pertinence de cette vision, mais seulement dans un monde idéal, où les conditions de concurrence ne sont aucunement faussées par des interventions publiques facilitées par le poids inégal des diverses nations, et, tout en étant favorables en tendance à l’ouverture, ils insistent fortement sur l’exigence de l’égalité du respect des règles par tous les partenaires. D’autres enfin, très préoccupés du court terme, ne sont pas hostiles au maintien, plus ou moins temporaire, d’un certain protectionnisme.
Cette diversité de points de vue, provoquée à la fois par des différences d’analyse théorique et par la diversité des situations économiques entre pays, ne facilite évidemment pas l’adoption d’une position commune lors des négociations extérieures de la Communauté et affaiblit le pouvoir de négociation de celle-ci, il ne faut pas se le cacher.
À cette difficulté s’en ajoute une autre : l’organisation des relations commerciales (et financières) extérieures ne peut être indépendante de la politique étrangère et l’Europe en est encore à des balbutiements pour la définition de sa « politique étrangère et de sécurité commune » (la PESC).
Il ne faut se faire aucune illusion, ces tensions internes à l’Union, qui croissent avec chaque élargissement, ne sont pas près de disparaître. On pourrait toutefois espérer les atténuer si on s’imposait, lors de l’adoption de positions vis-à-vis de l’extérieur, d’en examiner, plus attentivement que ce n’est actuellement le cas, les effets concrets probables sur le fonctionnement interne de l’économie européenne, et tout particulièrement sous trois aspects :
- la restructuration de l’appareil productif et ses conséquences sur l’équilibre des paiements extérieurs et le taux de change,
- les effets, heureux ou néfastes, sur le processus menant à la cohésion économique,
- les effets, à court terme et à moyen terme, sur l’emploi.
Il faut enfin insister sur l’importance, pour les opérateurs économiques, de disposer d’une vue précise, et stable sur un terme assez long, de l’organisation mondiale des relations internationales. Cela implique que l’Europe s’abstienne de chercher, par des « coups ponctuels », à obtenir un gain temporaire par une modification des règles ; cela implique également qu’elle soutienne pleinement la mise en place et le fonctionnement de l’Organisation mondiale du commerce et qu’elle cherche par là à s’en faire un allié. Enfin le problème des relations économiques internationales entre grands ensembles se pose particulièrement pour le partenaire atlantique, avec lequel il faut établir un équilibre de partenariat7.
Sur le terrain monétaire, depuis 1971, le monde vit avec un « non-système monétaire international », créant une constante source d’incertitude sur les niveaux des changes. À cela s’est ajoutée, au cours du même quart de siècle, la complète libéralisation des mouvements de capitaux sur l’ensemble de la planète. Il s’ensuit que les taux de change sont de moins en moins représentatifs de l’évolution des fondamentaux économiques et de plus en plus la conséquence du jeu à court terme d’un nombre limité d’opérateurs financiers internationaux, seconde source d’incertitude. Deux attitudes alors sont possibles, selon la confiance accordée aux marchés.
Selon l’une, les marchés ont fondamentalement raison, puisque les opérateurs affirment qu’en appréciant la gestion économique et financière d’un pays, ils se préoccupent que celle-ci soit menée d’une façon saine et prudente, in a sound and prudent fashion (l’expression revient souvent dans la littérature et les discours). C’est aux gouvernements à adapter leur comportement de façon à ce que l’évolution économique paraisse saine ; les marchés feront alors confiance aux monnaies en question, et les taux de change seront stables ; l’alignement sur l’opinion des marchés devient une règle d’or.
Selon l’autre attitude, les choses sont moins simples. C’est sur l’interprétation des adjectifs saine et prudente que réside le débat : ces acteurs des marchés (financiers) concentreraient leur attention sur des équilibres financiers (les soldes des budgets publics, la balance des paiements) et fort peu sur des phénomènes réels comme le niveau de vie et surtout le chômage (sauf si celui-ci fait craindre une explosion politique), alors que ceux-ci sont prioritaires pour les populations. Certes les premiers sont loin d’être négligeables, ils peuvent favoriser les objectifs de croissance et d’emploi, mais ils ne doivent pas être regardés isolément des seconds, au service desquels ils doivent être mis. Autant il paraît bénéfique pour le bon fonctionnement de l’économie que les prix des marchandises et services se déterminent librement par l’offre des producteurs et la demande des utilisateurs (entreprises et ménages) de ces biens, autant il paraît incohérent qu’une variable aussi fondamentale pour la régulation, à court et à moyen terme, du fonctionnement et de l’évolution de l’économie soit déterminée essentiellement par le comportement d’acteurs motivés par des préoccupations de gains financiers de court terme.
Il faut alors réagir et corriger le mécanisme. Comment ? Deux pistes sont évoquées :
- selon l’une, on doit essayer de réduire l’ampleur de ces capitaux flottants, de façon à redonner aux Banques centrales la possibilité d’intervenir efficacement sur le marché des changes, malgré le volume limité de leurs moyens d’action. C’est ainsi que le prix Nobel James Tobin a proposé de prélever une légère taxe sur tous les mouvements de capitaux, ce qui aurait pour effet de faire disparaître de nombreux mouvements voulant profiter d’un très léger différentiel de rémunération entre places financières,
- selon l’autre, et dans la ligne des pratiques antérieures, on chercherait à renforcer les mécanismes publics de contrôle. On trouve une bonne expression de cette idée sous la plume d’un secrétaire américain au Trésor » le défi principal auquel le monde est confronté est de développer des mécanismes multilatéraux pour traiter les problèmes qui surgissent de la forte croissance de la rapidité et de la dimension des marchés financiers internationaux et pour minimiser le risque systémique sur ces marchés. Nos institutions doivent être rendues aussi modernes que le marché « 8.
Quelle que soit la piste retenue, aucun progrès ne peut être obtenu par des actions nationales individuelles ; par contre, lorsqu’elle aura créé l’union monétaire et progressé vers l’union politique, l’Union européenne pourrait peser d’un poids suffisant pour modifier l’état actuel des choses. Certes, rien ne garantit que l’Europe réussira à convaincre les partenaires mondiaux qu’il faut faire quelque chose ; du moins pourra-t-elle le tenter.
II – LES AVANCÉES RÉALISÉES AU COURS DE 1997 OU PRÉVUES POUR 1998 : AMSTERDAM, LUXEMBOURG, EURO
Tous les sujets qui viennent d’être évoqués ont été amplement débattus au cours des dernières années, aussi bien aux niveaux nationaux que dans des enceintes européennes (notamment le Conseil Ecofin), aussi bien dans les milieux académiques que dans les sphères politiques et ces débats ont mis en lumière la diversité des positions nationales dont on a esquissé ci-dessus les aspects essentiels. Toutefois, certains pas en avant – dont on va apprécier l’ampleur – ont été faits récemment, par le traité d’Amsterdam, adopté en juin et officiellement signé le 2 octobre 1997, puis lors du Conseil européen de novembre 1997, exclusivement consacré au thème de l’emploi. Enfin les décisions concernant l’euro, qui seront prises le 1er mai 1998, sont aussi susceptibles d’avoir un impact appréciable sur l’emploi.
1 – Les réponses d’Amsterdam : modiques, mais pas négligeables
Sur ce qui devait initialement constituer le contenu principal du traité, à savoir la réforme des institutions à adopter pour l’Union en vue des prochains élargissements, la montagne a accouché d’une souris : on a renvoyé après les négociations d’adhésion ce qui devait – fort logiquement – être décidé avant. Cela affecte l’emploi de deux façons :
- indirectement en reflétant une ambiance de désaccord et de méfiance latente entre partenaires qui empêche malencontreusement la création dans l’esprit des populations d’une vision claire et dynamique sur l’avenir de l’Europe et donc vient saper la confiance des décideurs ; il est grave que les négociateurs n’en aient pas eu conscience (ou n’en aient pas tiré les conséquences),
- directement, en n’augmentant guère le champ relevant de décisions à la majorité, donc en laissant un pays maître de bloquer toute décision, y compris, comme on va le voir, celles devant mener à une meilleure coordination des politiques.
Sur l’emploi proprement dit, nous disposons d’une résolution et de quelques articles pouvant avoir un effet important. Quatre éléments peuvent ainsi être considérés comme des possibilités d’avancées :
- l’exigence d’une meilleure prise en considération de l’objectif d’emploi ; si on pose en principe que « la responsabilité de la lutte contre le chômage incombe avant tout aux États membres », le texte reconnaît le besoin d’améliorer l’efficacité de la coordination et d’en élargir le contenu et on affirme que « l’Union européenne devrait compléter les mesures nationales en examinant systématiquement toutes les politiques communautaires pertinentes qui existent, en vue d’assurer qu’elles soient axées sur la création d’emplois et sur la croissance économique« 9 ;
- une amorce de progrès institutionnel ; le texte donne mandat au Conseil Ecofin « d’indiquer comment améliorer les processus de coordination économique dans la troisième phase de l’UEM ». On est certes loin de la création d’un « gouvernement économique » de nature politique équilibrant le pouvoir monétaire de la Banque centrale européenne, mais si se met en place un véritable forum d’analyse en commun des politiques économiques nationales et de définition d’une stratégie concertée en matière budgétaire, ce peut être un sérieux progrès ; certes, c’était déjà prévu dans Maastricht, mais insuffisamment pratiqué ; on peut progresser, si on le veut ;
- une amorce de mise en œuvre de l’article 109 du traité, en invitant « le Conseil et la Commission, en coopération avec l’Institut monétaire européen, à formuler des orientations générales de la politique de change à l’égard d’une ou de plusieurs monnaies non communautaires » ;
- une organisation monétaire favorable au marché intérieur ; entre l’euro, monnaie d’un certain nombre de pays (les » ins ») et les monnaies des pays ne participant pas tout de suite à la troisième phase de l’Union monétaire (les » outs »), la résolution confirme la mise en place d’un système monétaire (SME bis) qui garantit contre des dévaluations agressives et assure donc la stabilité des changes suffisante au bon fonctionnement du marché intérieur ; levant un élément d’incertitude, cette décision est un atout en faveur de l’emploi.
Par contre, l’adoption, annoncée à Dublin en décembre 1996, confirmée à Amsterdam, du pacte de stabilité, nous semble maladroite10 ; le souci de pousser à une discipline des États en matière budgétaire est très bon, le laxisme en la matière ne pouvant que perturber le fonctionnement de l’économie ; mais les règles fixées ne devraient pas devenir un carcan. C’est une erreur que de vouloir s’imposer à l’avance des règles très rigides pour le futur11.
Alors, Amsterdam : verre à moitié plein ou à moitié vide ?
L’absence ou l’insuffisance de progrès sur des points fondamentaux résulte certes d’une préparation maladroite, il faudra veiller à faire mieux la prochaine fois (qui est déjà annoncée). Mais surtout elle reflète l’absence de consensus entre les pays membres sur l’Europe qu’ils veulent faire : à Amsterdam, ils voulaient un accord, mais ne savaient pas sur quoi, d’où des négociations sans crise spectaculaire, mais sans résultat.
Il faut maintenant continuer à vivre ensemble, et donc tirer d’Amsterdam tout ce qu’on peut ; trois éléments nous semblent positifs.
Le sommet d’Amsterdam a été ressenti comme exprimant une volonté de progresser sur la voie de l’Union monétaire, en respectant le calendrier (avec notamment la sélection milieu 98 des premiers participants et la fixation, pour le 1er janvier 1999, des valeurs en euro des diverses monnaies actuelles) et en confirmant la création d’un SME bis. La voie est donc déblayée pour la mise en place de l’euro, un élément d’incertitude pour l’Europe est éliminé (ou atténué), ce qui ne peut qu’être favorable à l’embauche par les entreprises ; il faut espérer que certains hommes politiques, dans plusieurs pays, s’abstiendront de continuer, pour des raisons de politique intérieure, voire même de carrière personnelle, à entretenir un climat de doute.
Si le rééquilibrage entre politique monétaire et politique économique n’a pas encore été pleinement assuré, du moins le traité esquisse-t-il des pistes pour le renforcer ; il faut utiliser à fond les possibilités qui sont ouvertes ; des consignes ont été données au Conseil Ecofin, à lui de les gérer dans une optique constructive.
Enfin, – et c’est à mes yeux l’essentiel – l’expérience ayant confirmé que le nombre croissant de membres rend de plus en plus difficile la marche en avant (en boutade, plus on est de fous, moins on rit), il est donc prometteur que, à l’instigation franco-allemande, on ait introduit dans le traité l’idée des coopérations renforcées, c’est-à-dire la possibilité pour un nombre de pays inférieur au nombre des membres de l’Union, d’aller plus vite et plus loin que l’ensemble, pourvu que les autres puissent, le jour où ils le voudront, s’associer à l’opération. Certes, le franchissement de ce portillon est soumis à de substantielles limitations (dont plusieurs sont fort raisonnables pour éviter un éclatement de l’Union), il y a là néanmoins une possibilité nouvelle de progression à laquelle il va falloir très sérieusement réfléchir, dans un esprit positif et constructif12.
En politique, notamment lorsque de nombreux pays sont impliqués, le verre n’est jamais plein (sauf aux repas d’apparat) ; aux acteurs dégustateurs à valoriser au mieux le contenu. Clairement, Amsterdam n’est pas un plein succès ; c’est à nous à ne pas le laisser devenir un échec.
2 – Les petits pas de Luxembourg
Dans le traité, une porte était ouverte en vue d’une meilleure coordination et d’une orientation plus favorable à l’emploi des diverses politiques définies ou menées au niveau communautaire. Aussi, pratiquant la tactique des effets d’annonce, le Conseil européen d’Amsterdam a‑t-il prévu que se tiendrait avant la fin 1997 une réunion exceptionnelle du sommet européen, consacrée exclusivement au sujet de l’emploi. Qu’est-il sorti de ce sommet des 20–21 novembre ? La réunion a été ressentie comme positive (on a parlé d’un nouveau départ dans la construction européenne), du fait qu’elle manifestait un consensus pour enfin aborder explicitement au plus haut niveau politique de l’Union le thème de l’emploi et pour adopter unanimement certaines conclusions concrètes. C’est sur la portée de celles-ci qu’il faut s’interroger.
Certaines conclusions concernent des mesures ponctuelles : offrir à tout jeune avant qu’il n’atteigne six mois de chômage un nouveau départ sous forme de formation, d’aide à la reconversion ou de mesure propre à favoriser son insertion professionnelle et aider les chômeurs adultes avant qu’ils n’atteignent douze mois de chômage, grâce à un accompagnement individuel d’orientation professionnelle. Ce genre de mesures n’est pas véritablement nouveau, ce qui l’est, c’est le chiffrement du nombre de personnes qui devront être concernées au cours d’une certaine durée, c’est surtout la surveillance communautaire du respect par chaque État membre des engagements ainsi pris, qui peut stimuler les actions nationales par un effet d’émulation, et grâce à la confrontation des procédures et des résultats.
En définitive, ce sommet sur l’emploi va renforcer le processus de consultations et confrontations des politiques économiques en les rendant plus systématiquement attentives à l’emploi, ce n’est pas négligeable. Il va stimuler aussi le développement de confrontations d’un foisonnement d’initiatives locales, dont on pourra tirer de multiples enseignements, tout en respectant la responsabilité première des États dans la lutte contre le chômage ; tout cela n’est pas non plus négligeable.
Certains participants au sommet et divers commentateurs ont estimé que l’originalité du mécanisme mis en place se trouverait dans l’analogie ainsi créée entre les objectifs chiffrés pour l’union monétaire (les critères de Maastricht) et les cibles quantitatives prévues pour l’ampleur des actions précédentes ; on est même allé jusqu’à parler de la création d’une symétrie entre l’union monétaire et la politique sociale commençant à combler ainsi le déséquilibre entre l’Europe monétaire et l’Europe des travailleurs. C’est là qu’il faut éviter les formulations trop séduisantes, mais sources de confusion et génératrices d’espoirs mal fondés. La différence est en effet profonde. Certains critères de Maastricht concernent des résultats (le taux d’inflation), d’autres des éléments sur lesquels les gouvernements ont une forte possibilité d’action (le déficit budgétaire), le tout au service d’un objectif précis, la stabilité des prix, certes complexe, mais dont l’expérience de la dernière décennie a montré qu’on savait l’atteindre.
À Luxembourg, l’objectif visé était très clair, c’est la réduction du chômage. Mais on s’est (à juste titre) soigneusement abstenu de s’engager sur un chiffre global de résultat (on a tout au plus esquissé des ordres de grandeur, pour une période mal définie) et ce n’est que sur une panoplie limitée d’actions instrumentales qu’on a pris des engagements chiffrés, sans d’ailleurs annoncer – et sans savoir – quel sera l’effet sur le chômage ; cette prudence était tout à fait raisonnable, mais la portée des décisions doit alors être ramenée à ses véritables proportions.
Au total, si ce sommet se traduit réellement comme le stimulant d’une attention beaucoup plus forte accordée par les institutions communautaires au thème de l’emploi dans toutes les décisions qu’elles sont amenées à prendre, Amsterdam et Luxembourg pourront apparaître comme marquant une inflexion dans le traitement par l’Europe de son problème clé.
L’échéance décisive du 1er mai 1998
La confiance en l’avenir est un élément primordial pour les décisions des entreprises concernant tant leur volume global d’investissement que leur choix d’affecter prioritairement celui-ci soit à la recherche de la réduction des coûts par le recours à des techniques de plus en plus capitalistiques (et donc moins utilisatrices de travail), soit au contraire à l’extension des capacités de production, avec embauche de main-d’œuvre. Tout ce qui réduit l’incertitude sur le futur est a priori favorable à l’emploi. À cet égard, la prochaine grande étape de la construction européenne peut se révéler décisive, qui va consister à définir les participants à la 3e phase de la mise en place de l’Union monétaire et, en principe, à préciser diverses caractéristiques de l’euro (notamment les taux de conversion définitifs des monnaies nationales entre elles et la stratégie de change vis-à-vis du dollar).
Actuellement, les acteurs économiques s’interrogent sur le nombre et les noms des pays qui feront partie du premier groupe d’États membres participant pleinement à l’Union monétaire ; cette information peut influencer leur stratégie commerciale et les choix de localisation de leurs futures unités de production. Ils s’interrogent aussi sur les taux de conversion qui seront retenus entre monnaies nationales, qui influenceront les « avantages comparatifs » des diverses économies nationales.
La première décision, sur les ins et les outs, aura lieu le 1er mai 1998 ; elle va orienter tout l’avenir de l’Union. Sur la seconde, un Conseil Ecofin informel a prévu qu’elle aurait lieu à la même date, c’est très important ; mais les entreprises de production et les marchés des changes ne seront tranquillisés que si ces taux de conversion paraissent crédibles et que s’ils sont convaincus que les responsables publics – Banques centrales et gouvernements – feront, en pleine coordination, ce qu’il faut pour que ces taux soient maintenus jusqu’à la date où, aux termes du traité, ils deviendront irrévocables, c’est-à-dire le 1er janvier 1999 ; en d’autres termes, il faut qu’on croie à la plausibilité d’actions visant à éviter la volatilité des changes pendant la période intérimaire de huit mois séparant le 1er mai 98 du 1er janvier 99. L’annonce, le 1er mai, des intentions à cet égard jouera un rôle essentiel.
Ainsi donc, suivant la façon dont se préparera et se déroulera la réunion du Conseil du 1er mai, suivant que ses résultats donneront l’impression d’un compromis plus ou moins boiteux obtenu à l’arraché ou au contraire d’un profond accord sur les décisions prises, l’impact psychologique sur l’ensemble des opérateurs économiques pourra être fort différent et l’impact sur l’emploi également. Les responsabilités sont lourdes.
______________________________________
1. On trouve régulièrement une présentation des mesures prises dans les divers pays de l’Union européenne dans 4 publications de la DG V (Affaires sociales) de la Commission européenne à Bruxelles.
2. Déjà importante pour l’organisation générale du marché du travail, la prise en compte des diversités nationales – ou régionales – s’impose encore plus pour toutes les initiatives ponctuelles visant à améliorer les perspectives d’embauche.
On peut également signaler que l’abondante littérature tournant autour du thème de la fin du travail est assez spécifiquement française : dans l’édition française Le Livre de Jeremy Rifkin, que les Français lisent sous ce seul titre, avait en plus dans l’édition américaine un sous-titre beaucoup plus riche : The decline of the global labor force and the dawn of the post-market era.
3. Cf. Le Manifeste des 17 (professeurs titulaires de chaires Jean Monnet) : La cohérence des politiques économiques dans une Europe différenciée : une exigence pour les nouvelles institutions, Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, n° 399, juin 1997.
4. C’est la position officielle allemande, fortement nuancée dans les faits, car le rapport des subventions publiques au PIB est dans ce pays analogue à ce qu’il est en France.
5. Avec, au niveau des discours, le qualificatif de « colbertisme » attribué à la France.
6. Des options analogues se présentent depuis longtemps pour chaque pays, avec une assez forte variété de réponses ; ce fut notamment le cas, pendant une longue période, pour le degré d’indépendance de la Banque centrale. On ne saurait trop insister sur le fait que le choix ne peut pas être déconnecté des structures économiques, mais aussi des réalités socio-politiques. Ainsi, l’indépendance de la Bundesbank et la priorité mise délibérément (et exigée par la loi) sur la stabilité des prix ont fonctionné sans problèmes tant que la population allemande avait conservé, du fait des deux expériences historiques de 1923 et 1946–47, une très profonde allergie à l’inflation. La même attitude ne s’observait pas dans de nombreux autres pays.
7. Il ne sera sérieux d’envisager de créer une véritable zone de libre-échange Atlantique que quand l’Europe aura suffisamment renforcé ses institutions propres et développé son union politique, de façon à pouvoir parler d’égal à égal avec ce partenaire.
8. Robert E. Rubin, Speech at the Centre for Strategic and International Studies, Washington DC, June, 1995.
9. Le traité de Maastricht avait stipulé que « les exigences en matière de protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques de la Communauté ». On se décide enfin à accorder une importance analogue à l’objectif de l’emploi…
10. Le pacte de stabilité, adopté sous la pression de l’Allemagne, impose le respect en permanence du plafond de 3 % pour le déficit des finances publiques et des sanctions pour un pays qui le dépasserait, sauf s’il est en situation de récession.
11. Nous ne répéterons pas en détail ce que nous avons écrit dès janvier 1997.
Cf. Pierre Maillet, Le pacte de stabilité et de croissance : portée et limites du compromis de Dublin, Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, n° 404, janvier 1997.
L’évolution économique et politique des sociétés gagne à se faire à l’intérieur d’un cadre, c’est le rôle des constitutions ; mais celles-ci ne sont durables que si elles restent suffisamment générales et ouvrent les portes aux ajustements rendus nécessaires par les transformations des réalités socio-économiques, des psychologies, des désirs des populations ; le pacte de stabilité risque d’empêcher les politiques nécessaires à la réalisation des ajustements nécessaires, il ne peut alors que créer des tensions insupportables, qui le feront inévitablement voler en éclats ; ce n’est jamais habile de créer des règles et des lois qu’on risque fort de ne pouvoir respecter.
12. Donc en s’abstenant d’insister sur le recul qu’une telle possibilité manifeste par rapport à l’ambition d’une intégration rapide à tous : c’est du second best, c’est mieux que du first worst : le mieux est souvent l’ennemi du bien.