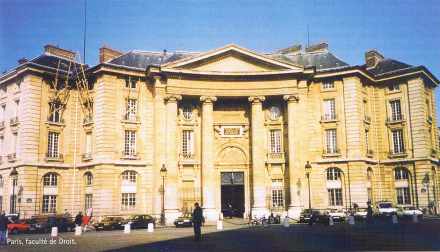Notre système d’éducation peut-il être un moteur de développement ?


La dynamique du statisme
Voici maintenant plusieurs décennies que la chronique quotidienne s’alimente de ce sujet obsédant pour les familles qu’est devenu celui de l’éducation. De fait, on peut difficilement contester cette évidence que la situation n’est pas brillante. Personne ne croit plus vraiment aux vertus de la culture, l’agitation est pratiquement continue dans les établissements, tourne souvent à la violence, les angoisses croissantes des familles et de leur progéniture ont pour réplique un déploiement d’états d’âme généralisé chez les personnels.
Pourtant, ce ne sont pas les rapports qui ont manqué, commandés par des ministres à des personnalités brutalement exposées à un univers pervers qu’elles découvrent avec effroi mais un peu tardivement. Ce type de recours n’ayant jamais eu d’autre finalité réelle que celle de faire gagner du temps au ministre du moment, il n’y a rien de surprenant à ce que les documents produits ont tous eu pour sort commun de faire l’objet d’un rapide classement circulaire.
Le premier d’entre eux dans la tradition, celui du professeur Laurent Schwartz, était pourtant aussi lucide que courageux mais il n’avait aucune chance d’être pris en considération dans le climat politique synchrone de sa publication. Quant à la plupart des autres, nous aurons le bon goût d’admettre que leurs auteurs n’ont pas vraiment osé mettre les sujets de fond sur la place publique et proposer des mesures inévitablement impopulaires, se contentant de vagues recommandations paradoxalement dévulnérabilisantes par leur insolvabilité.
En fait, on a spéculé constamment sur l’indulgence d’une opinion publique résignée à admettre qu’aucun programme sérieux n’est compatible avec la durée de vie moyenne d’un ministre ou de celle d’un gouvernement. C’est ainsi que s’est installée cette pratique de la fuite en avant à connotation anesthésique qui consiste en l’annonce de mesures aussi peu crédibles en termes de capacité d’organisation qu’insolvables en termes financiers. En somme, on s’est toujours dérobé devant l’assainissement d’une gestion devenue aberrante ou pris pour prétexte au statisme les réticences prêtées aux personnels envers une politique innovante.
Bref, le spectacle qui nous est offert ne traduit ni plus ni moins que le fait de subordonner notre politique d’éducation à la contemplation permanente de l’actualité sociale en prévision des prochaines élections. En d’autres termes, on peut légitimement considérer que ce monde politique complexe dont dépend notre système d’éducation n’est pas vraiment conscient du véritable enjeu de l’éducation, à savoir celui d’élever le niveau de civilisation de la nation. Il est vrai qu’une telle mission demande une telle capacité de réflexion qu’elle ne peut être que celle de professionnels distingués ayant les coudées franches. Mais il est bien connu que leur personnalité est peu compatible avec la déontologie d’un monde politique attaché à ses pouvoirs. Et il est de fait que la convention n’accorde aucune place aux vrais stratèges d’éducation et cela devient grave au moment où il faudrait beaucoup de continuité dans l’action et surtout ne pas se tromper de siècle dans ses jugements.
Ce n’est pas une réformite chronique qui réglera nos problèmes en attribuant une importance démesurée à des sujets tels que le poids du cartable, le calendrier des vacances, les rythmes du sommeil ou l’élimination de toute discipline perçue comme trop difficile. La politique de l’autruche coûte vraiment trop cher pour accepter qu’elle dure encore longtemps.
Nous avons eu un bel exemple de manque de jugement à propos du grand désordre de 1968 qui a fait vaciller l’État alors que la croissance se soutenait à hauteur de 6 % depuis des années et que le chômage n’existait pratiquement pas. La réduction du conflit a coûté cher. Cette savante véronique qu’aura été la loi d’orientation n’aura eu d’autre effet que celui d’occulter momentanément les vraies échéances d’une société en crise par une démagogie dont nous n’avons d’ailleurs pas encore soldé la note. Quant au prix que l’on a payé, réputé pour solde de tout compte, il n’était en réalité que celui du maintien d’un ordre établi passéiste, autrement dit du maintien en position de force de ces deux géants qu’étaient le patronat, dont l’État, et les syndicats.
Les causes du conflit ne concernaient pas directement ce face à face qui était déjà un sujet dépassé vis-à-vis de la déontologie internationale mais personne n’en était vraiment conscient et le résultat final aura été spectaculairement favorable au gigantisme. Moins que jamais on ne souhaitait briser la structure monolithique d’une Éducation nationale dont l’image était en tous points conforme à celle du système socioprofessionnel français pourtant déjà en retard sur son temps. Pérenniser le monolithisme d’un système d’éducation qui venait de démontrer son penchant à l’instabilité ne pouvait alors que conduire à terme à un désastre dû à l’hypertrophie non contrôlée des flux démographiques s’abattant sur des structures scolaires inadaptées.
Les vagues déferlantes d’effectifs ont submergé les collèges, puis les lycées et inondent maintenant les universités et les écoles, bouleversant des structures peu préparées à de tels séismes. Il n’est de secret pour personne que l’Éducation nationale affecte depuis longtemps la physionomie d’un gourmand de plus en plus insatiable. Personne ne peut plus maîtriser une demande qui s’emballe et qui entraîne inexorablement l’État, mais aussi les assemblées territoriales, locales et les familles, vers une situation d’insolvabilité de plus en plus évidente.
Pourtant, dès avant les années 70, les stratèges de l’OCDE s’étaient déjà accordés sur le fait que le gigantisme était incompatible avec la déontologie des sociétés postindustrielles naissantes et la fameuse maxime de Schumacher Small is beautiful recueillait l’assentiment général. Les grandes entreprises de taille mondiale, telles que la General Motors, fragmentaient les effectifs qu’elles employaient en créant autant de filiales que nécessaire pour assurer la stabilité de leur groupe. Cela se fit sans concession et surtout sans perte de puissance, bien au contraire.
Concernant l’Éducation, les rapports du moment donnaient pour prix d’esquive à tous les maux potentiels des sociétés occidentales l’affectation de 3 % de la production intérieure brute au poste de l’éducation. L’option proposée était hardie pour l’époque, coûteuse, et fatalement peu explicite sur les options à retenir du seul fait de la diversité des situations nationales.
En ce qui concerne notre pays, on doit aujourd’hui se rendre à l’évidence que les choix qui ont traduit l’adhésion financière de nos gouvernements successifs aux thèses des mages officiels ont reposé sur des dispositions inadéquates entremêlant conservatisme et démagogie. Nous devions déjà faire face à l’extension du paupérisme de la société qu’il était presque inconvenant de dénoncer quand un nouveau fléau est rapidement apparu, aggravant une situation qui se détériorait pernicieusement mais continûment. Ce fut le chômage, qui commença à inquiéter et le cap des 5 % était alors présenté comme une éventualité apocalyptique.
Le fait brut est que nous investissons actuellement sur le seul poste de l’éducation le double de ce pourcentage de la pib qui nous était présenté comme miraculeux, consacré à des programmes dont on peut redouter qu’ils ne soient en grande partie stériles. Quant au chômage, étroitement lié à l’éducation, il n’est pas déraisonnable de l’évaluer à hauteur du triple du seuil qui nous était présenté comme fatidique. Et l’on ne peut guère fonder d’espoir sur la poursuite d’une politique d’éducation à la petite semaine aussi ruineuse qu’objectivement peu probante. Elle résulte de programmes issus de plusieurs ministères, trop souvent mal ciblés et toujours assortis de procédures effroyablement compliquées sans préjudice de frais d’infrastructures inouïs.
Voici trop longtemps que nous nous bornons à poursuivre à grands frais et par des artifices sans résultats convaincants les effets de cette cause profonde de nos ennuis qui n’est autre que l’inadaptation de nos structures à la mondialisation des économies et à la sociologie qui en découle. Il nous faut cependant procurer des ressources à soixante millions de personnes, et cela dans un contexte de concurrence internationale sauvage. Cela implique donc d’accroître notre créativité et notre productivité dans des domaines solvables pour assurer à la nation le train de vie auquel elle aspire.
C’est par excellence la mission principale d’un système d’éducation que celui de projeter sur la société les ressources humaines dont elle a besoin, dotées d’une éthique moderne et organisées en profils et en flux convenables. Nous disposons pour ce faire des moyens potentiels en hommes et même, quoi qu’on en dise, en ressources financières. Encore faut-il les libérer et construire une synergie entre les moteurs de notre économie et les options fondamentales de notre politique d’éducation.
Mais force nous est de constater qu’une pareille perspective est hypothéquée du seul fait de l’invraisemblable poids de procédures éculées dont on ne s’affranchit pas suffisamment vite. L’équilibre de notre société est métastable et il n’est pas impossible qu’il ne se rompe un jour si nous n’y prenons pas garde. À moins de briser rapidement l’archaïsme de nos structures, on voit mal comment leur maintien et le traitement souvent vieillot et timoré que l’on dispense à nos enfants pourront contribuer à redynamiser la société. L’objet de cet article est de montrer comment on a pu en arriver là et peut-être comment sortir d’une situation devenue insoutenable.
Éducation et développement
1. Le mécanisme du développement
Il n’est pas donc pas inintéressant de se faire une représentation de l’élévation du niveau de civilisation d’un pays. Dans cette perspective, nous évoquerons l’observation classique selon laquelle les pays les plus développés ont évolué selon un processus immuable. Ce dernier s’est schématiquement déployé sur trois phases fondamentales dont la durée d’exécution s’est comptée en termes de siècles pour la première, cependant que les deux dernières n’en auront finalement exigé qu’un seul. Il reste que la dispersion des niveaux de civilisation à laquelle on assiste actuellement dans le monde ne fait que traduire la rapidité des diverses nations à s’être adaptées aux bouleversements successifs.
Elle mesure donc a posteriori les initiatives anticipatrices déployées en temps voulu par les gouvernements sous la pression des événements et sur le support de leurs systèmes d’éducation. En effet, si ces derniers avaient pour mission de maintenir le patrimoine culturel national, ils étaient en outre censés assurer sa progression en captant la connaissance d’où qu’elle vienne, son assimilation par la population devenant ensuite une affaire d’organisation pédagogique et donc un gage de progrès. Toute dérogation à ce programme a eu pour prix un décrochage culturel souvent irréparable.
2. L’éducation en France dans l’ère primaire
Ce fut naturellement la première préoccupation des hommes que celle de satisfaire leurs besoins vitaux. Dans un contexte aussi restreint, une économie peut se construire sur des circuits de production et de consommation, déborder le strict cadre national, intégrer un artisanat et même des arts plastiques qui peuvent être prestigieux. Mais on ne compte pas les pays qui ne sont jamais parvenus à s’extraire du stade d’une économie à aussi faible valeur ajoutée et certains souffrent encore de la faim.
Une telle typologie ressemble beaucoup à celle de l’Europe dans une période allant grossièrement du Moyen Âge au premier Empire, au second en France. Le pouvoir politique prenait alors appui sur un petit nombre de personnes qui possédaient à peu près tout. En clair, le revenu de la terre, c’est-à-dire le travail des paysans, alimentait une économie relativement stable assise sur la spéculation.
À cette époque, la France disposait d’une élite prestigieuse. Les lycées existaient en petit nombre et l’honnête homme à la française qu’ils produisaient était cité en exemple. Les encyclopédistes maîtrisaient pratiquement une culture qui privilégiait à parts égales science et littérature. Voltaire traduisait Newton. Les arts et l’artisanat étaient florissants et un tel état de fait s’est prolongé jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle dans un confort réservé à un petit nombre d’élus.
Cette situation n’avait de chance de prendre fin que s’il existait un noyau novateur suffisamment puissant dans le pays pour provoquer la mise en œuvre d’une politique porteuse d’espérance pour un plus grand nombre qui, au cas particulier, ne pouvait être que celle d’une industrialisation.
Nos Grandes Écoles existaient dues aux initiatives des derniers rois, de la Convention et de l’Empire et s’intéressaient alors aux applications. Elles auraient sans doute eu la capacité d’agir constructivement, mais la classe dirigeante encore jacobine a longtemps tardé à comprendre son siècle. Elle fut enfin convaincue d’investir par les banquiers. Mais la France du moment était analphabète et il aura fallu attendre la République et Jules Ferry pour que la population française sache enfin lire, écrire et compter, bref soit ouverte au progrès et puisse y participer. Avec deux générations de retard. L’inertie de notre pays devant le traitement des problèmes d’éducation est une constante de notre histoire.
3. L’éducation conduite dans l’ère secondaire
C’est sur de tels préalables que, vers la seconde moitié du dix-neuvième siècle, un certain nombre de nations, telles que les États-Unis, le Japon, l’Angleterre, l’Allemagne ont investi les produits d’une épargne d’origine agraire dans des programmes industriels. L’accès de la France à l’ère industrielle a été plus tardif puisque survenant un demi-siècle environ après celui de l’Angleterre. Pour combler son retard, notre pays a donc dû importer un certain nombre de technologies, telles par exemple que celle du chemin de fer, mais, fait bien plus grave encore, s’est rendu a priori et pour très longtemps dépendant de l’étranger par le biais de moyens de production qu’il a bien fallu importer et surtout de la culture qui les accompagnait. Cela fut possible car les banquiers du moment disposaient de moyens financiers considérables et accordaient toute priorité à la modernisation du pays.
On sait que les économies qui se sont construites sur le modèle industriel ont eu pour effet principal de drainer en milieu urbain les masses humaines venant de la campagne, et de les organiser en cohortes destinées aux usines. Il était dès lors fatal que l’on vise à promouvoir ces dernières au rang d’une clientèle solvable. La réduction des coûts de production supposait donc une stratégie visant à stimuler la consommation. Cela revient à dire qu’il fallait organiser le marché et par conséquent la vie des citoyens en les persuadant, autant que possible, que les options proposées devaient faire leur bonheur.
Ce modèle économique s’imposa aussi bien en France que dans tout autre pays occidental, et cela quelle que soit l’idéologie dominante. Ainsi le taylorisme naquit-il chez Ford d’abord pour satisfaire aux besoins des agriculteurs et ensuite pour élargir ces méthodes à l’ensemble du marché. » L’automobile sera populaire ou ne sera pas. » Le développement de l’industrie automobile allemande pendant l’ère hitlérienne a été dû au lancement de la Volkswagen, voiture populaire construite en grande série au profit des ouvriers dont le salaire gageait le financement des chaînes. L’Union soviétique elle-même n’a pas échappé au taylorisme, et se faisait paradoxalement une gloire de l’avoir porté au summum de la perfection dans les années trente. L’enseignement technique actuel porte encore les stigmates de l’ère industrielle. Les Centres d’apprentissage, devenus CET puis LEP et LP, les écoles nationales professionnelles devenues lycées techniques ont été conçus et équipés sur le modèle de l’usine taylorienne qui n’a plus cours aujourd’hui en France. Nous l’avons largement externalisée.
Il est difficilement croyable que notre système d’éducation n’ait guère évolué jusqu’à la fin des années cinquante. Quelques grands centres urbains de province avaient le privilège d’une université unique. Quant à la Sorbonne, elle était alimentée par la jeunesse aisée de la France entière, fascinée par le charme du quartier Latin. Les licences décernées par les facultés des lettres ou les facultés des sciences étaient dédiées aux aspects fondamentaux de la connaissance et leur nombre se comptait en termes d’unités.
Jusqu’aux années 1960, les enseignements de sciences physiques ne se prolongeaient pas par ces sujets dits » triviaux » comme le calcul scientifique ou l’électronique. Et pour clore ce triste portrait, l’enseignement supérieur comptait en tout et pour tout deux mille personnes, tous personnels confondus. On comprend pourquoi les thèses étaient distribuées aussi parcimonieusement.
Il est exact qu’un effort gigantesque ait été entrepris vers les années 70 où l’on se glorifiait de construire un CES par jour. Cette initiative était d’autant plus louable qu’elle était assortie d’une modeste tentative de diversification des enseignements par le biais de filières plus ou moins préprofessionnalisantes dont l’extension des obligations scolaires et les lois de 1971 avaient conditionné le lancement. Il reste que, dans la majorité des cas, des sommes considérables ont été investies dans ce qui n’était que la dilatation homothétique d’un système dont on a négligé de repenser le modèle. Bien plus, les partis architecturaux retenus aussi bien pour les établissements du second degré que pour les universités ont irréversiblement perpétué une image taylorienne de l’école-usine dont on sait qu’elle est de plus en plus mal supportée. Il faudrait peut-être bien veiller à ce qu’une augmentation du personnel de surveillance ne lui donne pas la physionomie d’un univers carcéral.
4. Les dominantes de l’éducation dans l’ère postindustrielle
Les développements qui précèdent avaient pour but de montrer combien peut être complexe la sociologie d’un pays développé où un glissement spontané vers une condition postindustrielle est constamment ralenti par la persistance de mythes hérités tout aussi bien de l’ère primaire que de l’ère secondaire. La recherche d’une condition de notable par le diplôme persiste et cette pratique est aussi stérile pour la nation que son coût est excessif. Il en a résulté que l’industrie n’a pas évolué suffisamment tôt par défaut d’être soutenue par un système d’éducation convaincant. Sans doute a‑t-on tenté de la doter d’une organisation parallèle ayant pour finalité affichée la culture technique, mais les résultats en sont décevants. On ne s’improvise pas éducateur comme cela.
À titre de comparaison, et seulement pendant les années 1977–1980, les États-Unis ont perdu dix points en volume de la part qu’ils avaient dans la production industrielle des pays de l’OCDE et cela en application des dispositions prévues par les conférences de Lima et de Lomé visant à transférer au tiers-monde une partie de la production. Ramenée à une vision domestique, cette information se traduit par la perte d’un tiers de la production nationale, et cela, tout en gardant le pnb le plus élevé du monde.
C’est dire l’extraordinaire transfert d’activités qui s’est fait en direction du secteur postindustriel et la fantastique organisation qui aura été nécessaire à la réalisation d’un pareil programme dans lequel les universités, et le système scolaire dans son ensemble, auront joué et poursuivent encore un rôle décisif depuis une trentaine d’années.
L’incapacité d’un système d’éducation à s’adapter à la conjoncture qui vient d’être décrite, et notamment dans sa partie technique, a pour conséquence redoutable que son rôle se limite à générer un véritable tiers-monde interne de riches, qui sera probablement banalisé à terme dans le tiers-monde tout court. En d’autres termes, les pays récemment engagés dans une stratégie de développement fondée sur une activation du secteur tertiaire supérieur par le secteur secondaire supérieur ont à faire face à d’énormes problèmes humains dont les solutions sont encore mal cernées, mais qui, de toute façon, exigent la remise en cause de leur système d’éducation.
Ils sont condamnés à la recherche d’une nouvelle distribution des qualifications et à redéfinir les profils des postes à responsabilité sous peine de s’exposer à des situations potentiellement destructrices de leur civilisation. L’uniformité n’est plus permise. Telle est finalement, parmi d’autres, la situation française qui nous intéresse au premier chef. Des choix prioritaires s’imposent à mettre en œuvre avec détermination et acharnement. Attendre encore serait suicidaire.
La nécessité d’un nouvel humanisme
En synthèse de ce qui précède, on peut résumer l’historique de l’Éducation nationale à une suite de réformes dont les régimes transitoires se superposent, ne s’éteignent jamais et poursuivent toujours un objectif aussi utopique qu’anachronique. En effet, l’action persistante des divers ministres n’aura eu d’autre finalité que celle de réinsérer dans la voie réputée royale le plus grand nombre d’égarés. Ces dispositions qui se voulaient généreuses furent nombreuses : suppression des classes de rétention du premier degré en 1973, création des classes de transition, systématisation des passerelles, mesures Stoleru, etc. Certes, il n’est pas d’intention plus louable que celle d’engager la lutte contre l’échec scolaire. Mais une telle attitude serait plus convaincante si elle admettait aussi une lutte contre l’échec de l’école qui n’a jamais su conférer à l’intelligence concrète les lettres de noblesse qu’elle mérite.
Les enseignements à vocation professionnelle de bas de gamme ne sont alimentés que par une sélection par l’échec scolaire classique et non par l’identification de qualités intrinsèques reconnues et susceptibles de consécration. On peut même étendre cette remarque aux formations de haut de gamme, celle des ingénieurs par exemple, où nos centres d’excellence dispensent des enseignements théoriques dont la principale qualité est d’être presque parfaits mais peu durables par défaut d’avoir été suffisamment corrélés au contexte physique qui leur a donné naissance. L’enseignement du calcul différentiel rendra en principe un étudiant capable de résoudre une équation du même nom mais il ne saura pas spontanément en reconnaître l’origine dans l’observation du fonctionnement d’une automobile. Pour être caricatural, nous sommes un peu dans la situation de la Chine antique qui recrutait ses mandarins sur des concours de poésie.
Le rendement d’une politique refusant l’idée que le concret peut non seulement nourrir l’abstrait mais le faire prospérer ne peut qu’être faible par nature. Ainsi notre enseignement technique, tous niveaux confondus, n’a pas fait l’objet d’une conception monolithique telle que chaque élève trouvera sa place naturelle dans la grille des emplois. La triste réalité est que les produits des LP ou lycées techniques ne sont pas préparés dès le stade de l’école à œuvrer de concert avec les ingénieurs et cela a des répercussions sournoises dans la vie de l’entreprise.
Par défaut de place à la rentrée dans les établissements techniques, on réaffecte actuellement dans les classes de lycée des enfants qui venaient d’en être écartés et l’appareil scolaire s’alourdit encore de ces » déchets » recyclés qui se répartissent ensuite sur tous les niveaux. Force nous est d’admettre que ces expédients n’ont pour résultat que celui d’affaiblir la voie royale qui n’en avait pourtant pas besoin et méritait une sérieuse réactualisation de son potentiel de logique et de son patrimoine de connaissances.
À aucun moment, les initiatives prises en matière d’éducation n’ont eu pour objectif déclaré que la consécration sociale pouvait être atteinte par des voies nouvelles. Tout se passe donc comme si les stratèges d’éducation ne percevaient pas les courants sociologiques de leur époque.
Leur comportement semble davantage être inspiré par des complexes de culpabilité que par une vision lucide et prospective de la mouvance générale des nations. Ils ne remettent pas en cause les finalités classiques de l’éducation et acceptent donc les concessions nécessaires pour élargir le cercle des privilégiés à de nouveaux candidats à la conformité. On croit que là se trouve le prix de la paix sociale et l’on se donne ainsi bonne conscience.
Un exemple typique de cette mentalité aura conduit aux nouvelles formations d’ingénieurs principalement dispensées en formation continue. Les entreprises les utilisent volontiers pour récompenser certains de leurs agents particulièrement méritants. On se demande alors pourquoi, sinon pour les motivations précédemment évoquées, elles ne les nomment pas tout simplement cadres. Le résultat serait le même pour les intéressés et l’on protégerait utilement un titre d’ingénieur qui se dévalorise.
Il est parfaitement compréhensible que les familles souhaitent la réussite sociale de leurs enfants et que d’honnêtes acteurs économiques aspirent à une reconnaissance de leur valeur. Mais il n’est pas indispensable de référer la promotion sociale à des diplômes dont la plupart, et ils sont nombreux, sont sans relation aucune avec les réalités.
La seule voie raisonnable de progrès est à rechercher dans un nouveau souffle qui ne peut qu’être d’ordre culturel et qui rénoverait la notion d’humanisme telle qu’elle est encore comprise aujourd’hui. Et dans cet esprit, il serait grand temps d’introduire la dimension technologique dans nos enseignements fondamentaux, notamment au niveau du collège en cessant de confondre technologie et technique. Chacun a en mémoire les funestes tentatives conduites dans le passé sous le fallacieux prétexte d’une introduction de la » technologie » qui culminait au niveau de l’arrêt de porte ou à celui de la targette.
On se souvient également de ce vaste programme d’équipement des collèges en ateliers Alti, situés dans des baraques démontables et équipés de machines conçues à la façon d’un mouton à cinq pattes sans doute mais à fiabilité modérée. Compte tenu des coûts exorbitants d’une telle politique et du maigre intérêt qu’elle aura suscité chez les élèves, on peut parfaitement comprendre que l’on ait abandonné ce projet en cours de réalisation. Là encore on se trompait de siècle. Le collège est un lieu d’acquisition de culture générale et de sensibilisation aux dominantes de l’environnement.
Les personnels chargés du programme précité n’étaient pas ceux dont on avait besoin pour le conduire. Ils étaient des techniciens et il n’est pas d’approche plus dissuasive de l’apprentissage de la technologie que celle de l’apprentissage de la technique. Ces enseignants n’ont pas démérité, ils ont tout simplement été piégés car ils étaient condamnés à l’échec en transmettant leur savoir technique, celui d’un métier que la plupart des enfants ne pratiqueraient jamais.
Il est grand temps de penser à ce que l’honnête homme d’aujourd’hui ait dès le stade de son adolescence quelque chance de comprendre pourquoi le vent souffle, comment fonctionne la montre qu’il a au poignet, ou tout autre phénomène de la vie courante qui, dans l’état actuel des choses, demeurera encore un profond mystère pour lui. Il est urgent d’apprendre aux enfants à raisonner en termes d’analogies et s’accoutumer à la notion de bilan. La description du fonctionnement d’une centrale nucléaire relève du même mécanisme de pensée que celle d’un supermarché quand on évalue les entrées et les sorties des deux systèmes, qui sont d’essence différente mais qui n’en sont pas moins des entrées et des sorties.
Ceci est un vaste programme sans doute quand on prend en considération les masses à traiter et l’effroyable densité d’illettrés qu’elles comportent. Mais ce serait peut-être un excellent moyen de lutter contre ce fléau en provoquant l’effort par la curiosité et de toute façon on ne peut plus attendre. On peut certainement susciter l’adhésion des élèves et donc leur ouverture d’esprit à la condition de penser d’un seul tenant la progression devant couvrir le premier cycle et faire en sorte qu’elle puisse servir de plate-forme à un second cycle sérieusement recharpenté. Les échecs précédents ne devraient pas peser comme une hypothèque sur un projet de cette ampleur dont l’impact sur la société entraînerait d’emblée un apaisement durable de certaines tensions persistantes entre composantes sociales qui ne se comprennent pas.
Dans l’état actuel des choses, il n’est pas raisonnable d’attendre de notre système d’éducation qu’il soit un véritable moteur de développement, et on ne peut que le regretter. Mais ce n’est tout de même pas l’Apocalypse. L’institution scolaire peut tout de même fournir des acteurs à un développement inclus dans la banalisation mondialisée des actions industrielles. Mais on ne peut pas dire que les projections de diplômés sur la société soient a priori créatrices d’activités originales et donc d’emploi. La raison en est qu’elles ne sont pas cohérentes.
Bien sûr, on ne doit pas se résigner à désespérer de l’institution scolaire et se forger l’idée que tout espoir est interdit. Les actes de désespérance se multiplient ça et là et il faut rapidement y mettre un terme en attendant des responsables l’annonce d’une stratégie de combat. Mais dans cette perspective, on doit se faire à l’idée qu’un engagement solidaire de la nation envers une politique rénovée, cohérente, énergique et assortie d’emblée du maximum de chances de succès deviendra aussi indispensable qu’il devra être durable. Il n’est donc pas impossible qu’il faille en arriver un jour à organiser un référendum sur le sujet, précédé d’une campagne loyale d’explication de nature à rallier les suffrages.