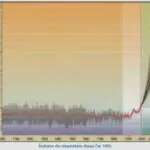Peut-on dissocier croissance matérielle, progrès et besoin de sens ?

Alpha et oméga en matière d’indicateur économique, le PIB est souvent présenté aujourd’hui comme le véritable baromètre de nos sociétés. La reprise de sa croissance est accueillie avec un profond soulagement. Si par malheur, elle vient à fléchir, le pire est à craindre et tous les maux s’abattent : chômage en hausse, baisse de la consommation, émeutes en banlieues, déprime généralisée… Le PIB en est venu à mesurer le bien-être de nos sociétés, contrairement à sa vocation première, plus modeste.
Le PIB, victime de son succès
Rappelons que le PIB est la somme des valeurs ajoutées de toutes les productions annuelles de biens et de services d’un pays, qu’elles proviennent des entreprises ou des administrations. Sorte de chiffre d’affaires global, il se nourrit des comptabilités des acteurs économiques. Le prix à payer pour obtenir un bien ou un service crée une valeur ajoutée monétaire qui sera enregistrée dans celles-ci, qui alimenteront ensuite notre produit intérieur brut. Le PIB mesure donc des productions (matérielles ou non) mais il peut également, cela se montre aisément, être vu comme les revenus distribués et enfin comme un indicateur de l’activité économique. Tout ceci n’en fait évidemment pas un indicateur de bien-être. Les comptables nationaux ne le revendiquent pas et il n’a pas été conçu pour cela.
Or le PIB n’incorpore aucune donnée relative à la destruction des ressources naturelles ni aux capacités d’autorégulation de la nature. Et ceci pour une raison fondamentale : la nature ne faisant payer ni ses services ni les biens qu’elle nous livre, leur prix n’apparaît pas dans nos comptabilités. La nature ne nous envoie également pas d’avocat pour se faire indemniser des préjudices que nous lui faisons subir. À nouveau, sans coût ni facture, pas d’impact sur le PIB. Dès lors, sa croissance ne nous informe en rien sur la destruction de la planète. Le PIB peut aller bien alors que la planète va mal : la Chine en fait l’amer constat en ce moment.
Quand Jacques Chirac dit, à Johannesburg « la maison brûle et nous regardons ailleurs » on pourrait ajouter « non seulement nous regardons ailleurs, mais nous mettons consciencieusement de l’huile sur le feu de la maison ». L’une des raisons majeures, c’est donc que nos indicateurs de richesse nous conduisent dans le sens inverse de ce que nous devrions souhaiter, si nous prenions au sérieux la réorientation nécessaire des modes de croissance et de développement, qu’on l’appelle développement durable, soutenable, humain, etc. C’est exactement comme si nous étions dans la situation d’un marin qui aurait décidé un changement de cap mais dont les instruments de bord resteraient réglés sur l’ancien.
Pour comprendre le succès du PIB, et donc ce qu’il va falloir faire pour sortir de sa tyrannie, en faire la critique technique est, sinon nécessaire, bien insuffisant : un détour anthropologique s’impose, car derrière le culte de la croissance illimitée du PIB, c’est notre rapport au monde qui est en jeu.
D’où vient la soif de croissance matérielle de nos pays industrialisés ? Désir et besoin
Nous sommes confrontés à la rencontre entre deux plaques tectoniques : le défi écologique, sur lequel nous ne reviendrons pas, et le défi anthropologique. Au plan anthropologique, nous ne sommes pas des êtres rationnels, se contentant de la satisfaction de nos besoins. Nous sommes aussi à l’évidence des êtres de désir. Car si le besoin est, par essence, autorégulé par sa satisfaction (la faim n’est par exemple jamais illimitée), le désir, parce qu’il se situe sur l’axe vie/mort, est quant à lui dans l’ordre de l’illimité.
Et, insistons sur ce point, l’énergie du désir est plus forte que celle du besoin. Si nous n’étions que des mammifères rationnels, nous utiliserions alors notre conscience pour satisfaire rationnellement nos besoins. De ce point de vue, aussi bien la tradition libérale libre-échangiste que la tradition socialiste planificatrice auraient toutes les deux raison. Dans un cas, puisque le besoin s’autorégule, un marché d’offre et de demande limité aux seuls besoins s’organiserait facilement. Dans l’autre cas, une planification intelligente devrait aussi fonctionner. Mais la réalité est que, parce que nous sommes doués de la conscience de la mort, nous ne sommes pas simplement des êtres de besoin, mais des êtres de désir illimité.
Si ce désir est orienté vers l’ordre de la vie ou de l’être, le caractère illimité du désir ne menace pas l’humanité. Ainsi en va-t-il de la beauté, de l’amitié, ou de la sérénité. En revanche, dès qu’il est orienté vers la possession, alors le désir engendre non seulement la rivalité avec autrui – par création artificielle de rareté dans un jeu à somme nulle – mais également une frustration permanente de l’ordre de la toxicomanie : après l’apaisement vient la frustration et donc l’addiction. René Girard a bien démontré les effets ravageurs sur le plan social du désir orienté vers l’avoir. Gandhi l’avait également souligné en déclarant : « Il y a suffisamment de ressources sur cette planète pour répondre aux besoins de tous mais il n’y en a pas assez s’il s’agit de satisfaire le désir de possession de chacun ».
Les limites sociales et écologiques à la satisfaction du désir de « toujours plus » sont aussi évidentes que difficiles à accepter individuellement. Le pollueur, l’excessif, l’abusif, est toujours « l’autre ». Et il est vrai que, menées à leur paroxysme, les rivalités d’argent et de pouvoir conduisent aux totalitarismes.
À titre illustratif, le rapport du PNUD de 1998 comparait, en termes de ressources, les besoins vitaux de l’humanité avec ce qui était dépassé, futile, voire dangereux (armes, drogues, publicité…). Il apparaissait alors que les besoins primaires représentaient 40 milliards de dollars de chiffre d’affaire, tandis que la publicité ou le stupéfiants en dépensaient 400, et l’armement, 800. On parle aujourd’hui d’environ 700 milliards pour la publicité et 1 100 milliards pour les armes. Besoin « d’être » contre désir d’avoir.
Abondance et pénurie : l’écoligion
Contrairement à une idée reçue, le primat actuel de l’économique dans nos sociétés (amplement constaté dans les débats des élections présidentielles), n’a pas de rapport avec une réalité sociale de faiblesse générale du pouvoir d’achat, ou, dit autrement, de manque sur le plan matériel. À l’évidence, nos sociétés occidentales ont résolu la question de la pénurie matérielle (mais pas celui de la répartition équitable « des richesses », ce qui est un tout autre débat). Keynes disait que la question de l’abondance était plus compliquée que celle de la rareté. Il craignait la dépression collective des sociétés ayant surmonté ce qui faisait la hantise de nos ancêtres : la crainte obsédante de la famine.
Comme souvent, il s’est montré visionnaire : la lutte contre la dépression n’est-elle pas à l’origine de l’hyperconsommation (comme dit Lipovetsky), elle-même issue de notre incapacité à faire face à nos vrais besoins ? Être heureux et aimer ne vont pas de soi. Il est plus facile de répondre à « comment survivre » plutôt que « pourquoi vivre », ou de surdévelopper le « comment vivre ensemble » plutôt que de trouver des réponses collectives – et non dogmatiques – au « pourquoi vivre ensemble ». La facilité est alors souvent de former des rapports déshumanisés, en passant, pour reprendre la formule célèbre : « du gouvernement des hommes à l’administration des choses ».
Pourquoi, dans nos sociétés matériellement surdéveloppées ayant parfaitement les moyens d’éradiquer la pénurie, l’économie est-elle restée aussi importante, voire obsédante ? Les anthropologues ont montré que les sociétés dites primitives, a priori « condamnées à la sueur de leur front » à lutter contre la pénurie consacrent aux activités économiques beaucoup moins de temps que nous1 !
Cette prégnance de l’économie, sans rapport avec la moindre nécessité, est, à mon sens, de l’ordre du religieux. On pourrait parler d’une « écoligion ». Après l’affaiblissement des grands systèmes religieux et idéologiques, il me semble que nous comblons notre besoin de sens par une « parodie », un divertissement pascalien. S’il est banal de dire que l’hypermarché est le temple des temps modernes, c’est sans doute plus profond qu’il n’y paraît. Nous sommes à ce rendez-vous de civilisation que Max Weber avait bien vu dans L’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme où il avait écrit : « Nous sommes passés de l’économie du Salut au salut par l’économie ».
Notre vocabulaire semble d’ailleurs à lui seul le montrer. Le « bénéfice » n’est-il pas étymologiquement ce qui fait du bien ? Le profit, ne renvoie-il pas à une expression moins comptable et issue du monde de l’être : « profite bien de la vie » ? Quant au bilan comptable n’est-il pas le double moderne de la comptabilité des péchés au moment du jugement dernier ? Les paroles obscures de l’ancien président de la Banque Fédérale américaine, qui aimait rappeler que ceux qui avaient compris ce qu’il disait ne l’avaient donc pas compris, ne rappellent-ils pas celles de la pythie ? N’est-ce pas lui à nouveau qui a parlé de « l’exubérance irrationnelle » des marchés ? Les comportements des marchés sont-ils vraiment rationnels ? Enfin dernier exemple, bien connu lui aussi : les propriétés du marché, imaginés par Adam Smith sous le terme de « main invisible », ne sont-elles pas un peu miraculeuses, celles d’un ordre divin ?
Ces analyses nous montrent que se passer du PIB ou le compléter ne sera pas simple. On ne remplace pas une idole simple et structurante par des chiffres moins connus, même remplis d’intelligence. Et ceci d’autant que la force du PIB réside justement dans sa fausseté : il donne l’illusion que le bonheur est simple et mesurable. Y renoncer supposerait donc de renoncer à cette illusion. Si le PIB, tout comme l’écoligion dont il est issu, a une telle force émotionnelle c’est parce qu’il constitue une promesse de bonheur facile et d’avenir radieux : en travaillant, on gagne une promesse d’intensité future, on transforme du temps mort en argent, on sacrifie le présent au nom de la promesse qu’on en profitera demain.
La solution pour sortir de cette impasse ? La sagesse
Au-delà des enjeux techniques qui ne sont pas minces sur le choix d’autres indicateurs alternatifs ou complémentaires, je voudrais ici attirer l’attention sur ce qui me semble être les vrais enjeux de la « mesure de la croissance ».
Tout d’abord un enjeu démocratique. Le nécessaire débat démocratique sur les choix des systèmes de chiffrage ne peut avoir lieu que pour autant qu’il soit restitué dans le champ public par les spécialistes qui en connaissent la teneur. C’est l’essentiel du travail que j’ai fait lorsqu’on m’a confié la mission sur les nouvelles approches de la richesse2.
Nous avons ensuite besoin des éléments d’élaboration démocratique qui refondent la qualification – la question prioritaire, celle du sens à donner aux chiffres – parce que la quantification n’a de sens qu’au service de la qualification.
Quand on est dans ce que Vincent de Gaulejac a appelé le dérapage de la quantophrénie, on finit par croire que la réalité est réductible aux chiffres. Or ce qui compte vraiment dans la vie a pour caractéristique de ne pas pouvoir se quantifier. Chiffrer l’amour, par exemple, nous approche dangereusement de la prostitution. Ce qui fait la valeur fondamentale pour chacun de nous – valeur signifie en latin la force de vie face à la mort -, ce n’est certainement pas la valeur ajoutée comptable ou financière, mais la force de vie supplémentaire.
Confrontés à la question culturelle fondamentale du besoin d’indicateurs alternatifs, il nous faut une qualité de débat démocratique qui restitue les choix de société implicitement cachés derrière ces choix d’indicateur. La vraie question n’est pas seulement « ce qu’on met dans nos comptes », mais « ce qui compte vraiment dans nos vies ». Elle devient une question politique : l’art de vivre ensemble devient centrale pour la survie de l’espèce humaine, au moment précisément où elle a la capacité de s’autodétruire. Si Homo Sapiens n’est pas une origine (il semble plus demens que sapiens) n’est-ce pas un projet, une possibilité, une nécessité ?
____________
1. cf. Marshall Salins, Âge de pierre, âge d’abondance, Gallimard,
2. « Reconsidérer la richesse ».