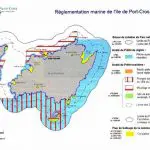Plaidoyer pour l’océan : de la science vers le politique



Les nouvelles approches scientifiques sont aujourd’hui essentielles pour mieux comprendre l’état de santé de l’océan et donc orienter les prises de décision politiques pour sa préservation. Pour cela, il faut chaque jour construire le dialogue science to policy entre deux mondes qui se parlent trop peu et qui ont des temporalités différentes. La gouvernance multilatérale de l’océan oscille entre avancées et désillusions, ambitions et incohérences des pays. Aujourd’hui, l’objectif est d’établir une feuille de route opérationnelle pour l’océan à 2050 qui se traduise par des actions locales à impacts significatifs sur la santé de l’océan.
Comment les discussions politiques sur l’océan ont-elles évolué ces dernières années ? et en quoi consiste le dialogue entre science et politique sur l’océan ?
Patricia Ricard : Le dialogue entre la science et le politique sur l’océan consiste à faire se rejoindre deux mondes. D’une part, la démarche scientifique de compréhension de l’environnement marin et, d’autre part, la démarche de développement des décideurs politiques et économiques, dont les résolutions se voient désormais infléchies par cette même connaissance scientifique dans le cadre du changement climatique.
Au fil de l’histoire du rapport de l’homme à son environnement, le dialogue science-politique sur l’océan a peiné à se construire. Il a été accéléré par l’iconographie de la catastrophe : contamination au mercure à Minamata en 1956, poursuite des baleiniers par Greenpeace, marées noires du Torrey Canyon, catastrophe de Fukushima. Ces images se sont heurtées de plein fouet à la démocratisation fulgurante de l’accessibilité à un océan résonnant avec nos fantasmes d’évasion et de tourisme. Peu à peu la notion de l’océan, « bien commun » de l’humanité menacé, a pris place dans une conscience environnementale globalisée.
Romy Hentinger : L’océan a longtemps été le grand oublié des négociations sur le climat ou la biodiversité. Fort heureusement, l’océan et sa biodiversité sont désormais considérés pour atteindre les objectifs climatiques, son rôle dans la régulation du climat est reconnu dans le cadre des conférences des parties (COP). Chaque année, davantage d’États mènent des actions pour protéger l’océan dans leurs plans nationaux. Une véritable avancée, quand on se rappelle qu’il a fallu attendre 2015 pour que l’océan soit mentionné explicitement dans le préambule de l’Accord de Paris lors de la COP21 !
Quels traités internationaux mobilisent les discussions autour de l’océan ?
RH : Aujourd’hui, la communauté internationale se mobilise autour d’un objectif ambitieux pour la biodiversité océanique, mais atteignable si la volonté politique est au rendez-vous : protéger 30 % de la surface de l’océan d’ici 2030 (actuellement seuls 8 % de l’océan et 1 % de la haute mer sont réellement protégés). Sur le plan du droit international, le traité sur la biodiversité en haute mer, dit traité BBNJ, a déjà été signé par 84 États depuis son adoption en mars 2023, c’est historique ! La haute mer, qui représente 64 % de la surface de l’océan, sera bientôt régie par un texte contraignant dans lequel se retrouvent les notions de patrimoine mondial de l’humanité, de partage équitable des bénéfices des ressources génétiques marines collectées en haute mer, de renforcement de capacités des pays du Sud et de soutien à la recherche internationale.
Ces avancées ont été le fruit d’un dialogue politique croissant avec les scientifiques et organisations de la société civile, qui ont partagé les dernières connaissances pour alerter et porter la voix de l’océan dans les différents processus de gouvernance. Ce dialogue science to policy doit être d’autant renforcé que nous sommes aujourd’hui dans un momentum pour l’océan, entre des points de bascule de notre environnement, des cadres de gouvernance contraignants qui voient le jour, des positions d’États plus engagées, mais aussi des avancées technologiques qui permettent aujourd’hui un suivi et une science de haut niveau pour aider à la décision publique.
Qu’en est-il des initiatives locales ?
PR : La mer Méditerranée, souvent qualifiée d’« océan modèle », nous offre un retour d’expériences interpelant. Depuis les années 1960 sur la façade française méditerranéenne, des avancées majeures ont vu le jour en matière d’aménagement du littoral et des espaces marins, de protection de la biodiversité marine, d’assainissement et d’épuration et de restauration des milieux. Toutes ces actions concrètes et éprouvées ont été possibles grâce à la concertation et à la coconstruction des parties prenantes et un dialogue société civile-science-politique apaisé et constructif. Paradoxalement, l’internationalisation des débats dans des cadres contraignants, supranationaux, le temps court des politiques et le temps lent des structures onusiennes, limitent et ralentissent les actions de terrain.
L’accélération des urgences donne plus de voix aux ONG et médias, plus de dilemmes aux gouvernements et moins de capacités d’action aux gestionnaires locaux. Les traités issus de difficiles consensus sont des victoires historiques mais, dans l’attente des ratifications et traductions réglementaires, l’effondrement du « Système océan » s’accélère. Ce décalage de perspectives relègue malheureusement au second plan l’action locale et les initiatives concrètes. Le texte semble désormais l’emporter sur l’action.
En tant qu’ancien point focal du GIEC pour la France, pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent son rôle et son dialogue avec le politique ?
Éric Brun : La Convention-cadre des Nations unies pour le changement climatique (CCNUCC) régit les accords internationaux pour lutter contre le changement climatique, notamment l’Accord de Paris. Cet accord mentionne explicitement le rôle de la science, en particulier pour comptabiliser les émissions nationales de gaz à effet de serre, pour fixer les objectifs de réduction des émissions compatibles avec l’objectif de réchauffement climatique à ne pas dépasser et pour contribuer au bilan mondial de cet accord établi tous les cinq ans. Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), créé avant la CCNUCC, et ses rapports sont mentionnés explicitement dans l’Accord de Paris.
Dans les faits, les rapports du GIEC, dont les résumés sont approuvés à l’unanimité par la quasi-totalité des pays du monde, sont présentés formellement aux Parties signataires de la CCNUCC ou de l’Accord de Paris qui en reprennent certains contenus scientifiques dans les décisions prises chaque année lors des COP (Conference of Parties) ou bien dans le premier bilan mondial publié en 2023. Les rapports du GIEC traitent l’océan sous différents aspects, notamment du point de vue physique compte tenu de son rôle primordial vis-à-vis du système climatique (circulation océanique, bilan et stockage d’énergie et de carbone, échanges avec l’atmosphère, variabilité interannuelle du climat…).
« Le GIEC ne traite presque pas de sujets liés à la pollution de l’océan ou à son exploitation. »
Les impacts du changement climatique sur l’élévation du niveau de la mer, sur l’acidification, sur les cycles biogéochimiques et les écosystèmes sont également traités dans les rapports d’évaluation ou bien dans des rapports spéciaux, comme ce fut le cas en 2019 avec le rapport spécial sur l’océan et la cryosphère. Pour cela, le GIEC fait appel à des auteurs experts scientifiques de ces domaines. En revanche, le GIEC ne traite presque pas de sujets liés à la pollution de l’océan ou à son exploitation, sauf pour les aspects liés à la géo-ingénierie. Ces sujets sont évidemment cruciaux pour l’avenir de l’océan, mais leur lien avec l’évolution climatique est trop ténu ou trop indirect pour qu’ils entrent dans le périmètre des travaux du GIEC.

Quel est aujourd’hui le consensus scientifique adressé au politique et comment les messages scientifiques peuvent trouver un écho efficace au sein de la CCNUCC ?
EB : Aujourd’hui, le consensus scientifique est indiscutable sur la réalité et la gravité du changement climatique. Fondées sur des modèles et le réchauffement déjà observé, les projections du niveau de réchauffement mondial en fonction des émissions futures ne sont plus sujettes à suspicion, d’autant que les projections présentées dans les anciens rapports du GIEC se sont, hélas, vérifiées lors de la dernière décennie.
Le 7e cycle du GIEC a commencé en juillet 2023. Une participation active d’experts océanographes aux réunions dites de scoping permettra d’identifier quelles nouvelles connaissances scientifiques devront être évaluées d’ici 2028 dans les prochains rapports du GIEC. Une attention particulière sera sans doute donnée au rôle de l’océan dans l’action climatique, notamment la décarbonation, ce qui permettra d’alimenter en connaissances scientifiques le processus dit Ocean and climate change dialogue qui est désormais un événement récurrent lors des COP de la CCNUCC.
Il faudra être très vigilant sur l’intégrité scientifique de messages que pourront porter certains pays sur la géo-ingénierie fondée sur l’océan ou bien sur la comptabilité des émissions dites négatives de gaz à effet de serre induites par certaines actions anthropiques sur les écosystèmes côtiers. Compte tenu de son mandat, il est certain que le GIEC ne traitera pas de façon approfondie la question de la pollution et de l’exploitation de l’océan, au-delà des aspects les plus liés à la lutte contre le changement climatique. Le cadre de gouvernance pour traiter de façon exhaustive et intégrée ces sujets reste donc à définir.
Comment la science peut-elle devenir plus accessible dans son dialogue avec le politique ?
PR : Il nous faut développer des outils de pilotage, la science fondamentale doit nourrir la science de la durabilité : il est nécessaire de combiner une science descriptive avec des méthodes d’approche axées sur la recherche de solutions. Les comités de pilotage et instances interdisciplinaires multiacteurs jouent un rôle essentiel en favorisant l’acculturation des différentes parties. Ainsi, les feuilles de route de demain devront valoriser la science au service des solutions. Elles doivent servir de cadres entre toutes les parties prenantes afin de traduire la connaissance disponible en action indispensable.
La prochaine conférence des Nations unies pour l’océan aura lieu à Nice en 2025, quelles sont vos attentes pour ce prochain grand rendez-vous ?
RH : Cette conférence doit être celle des engagements – par exemple la ratification du traité BBNJ ou d’un consensus pour un moratoire sur l’exploitation des grands fonds marins – et pas un nouveau catalogue de bonnes intentions de la part des États. En tant que fondation qui construit chaque jour le pont entre science et politique, nous espérons que l’appropriation de la connaissance scientifique par les États sera centrale.
“La prochaine conférence des Nations unies pour l’océan aura lieu à Nice en 2025.”
Nous espérons également que le lien entre santé environnementale et santé humaine sera discuté de manière plus systématique, mais aussi l’importance du continuum terre-mer pour la définition des réglementations et des politiques de gestion cohérentes entre les différents milieux (terrestres, fluviaux et marins). La pollution plastique est un exemple de l’impact de la terre vers la mer. Dans le cadre du futur traité contre la pollution plastique actuellement négocié à l’ONU, la réduction de sa production doit être la priorité, en agissant tout au long de la chaîne de valeur du plastique, pour éviter de penser le plastique que comme déchet en bout de chaîne.
Comment intégrer dans ce dialogue les acteurs du secteur privé et de la finance ?
PR : Le modèle du carré magique dans le cadre de financements publics-privés apporte une dynamique partenariale intéressante. Ce carré associe les quatre piliers de la transition : la science, qui œuvre à la coconstruction de la connaissance et à sa diffusion ; l’économie, qui permet de développer l’innovation en soutenant la création de nouvelles filières ; la société civile (ONG, syndicats, médias), qui anime l’acceptation sociétale et la pression réglementaire ; et enfin l’institution et le territoire, qui veillent à l’adaptation législative et à la transition des territoires.
Cependant, le secteur privé n’a pas encore complètement trouvé sa place dans cette dynamique vertueuse. Si les entreprises françaises sont déjà engagées dans la durabilité, leur responsabilité environnementale envers l’océan se heurte à l’absence d’indicateurs de performance. Le recours à la philanthropie serait plus efficace et pertinent mais reste trop rare en faveur de l’océan. Par ailleurs, on peut noter des effets de levier vertueux entre financements privés sur financements publics. Comment la finance peut-elle faire rimer durabilité et rentabilité et transformer les obstacles en tremplins de transformation durable ? Les sciences du vivant et les sciences de la durabilité nous proposent des solutions vertueuses prenant en compte les solutions fondées sur la nature ou bio-inspirées.
L’océan est le miroir de nos usages et nous renvoie l’image de nos erreurs ; il est temps d’inverser nos gestes, car l’océan sera l’accélérateur de nos dérèglements ou le socle de notre résilience.