Pour une économie qui lie sans enchaîner
Keynes avait raison
X‑Action : La revue Transversales s’arrête souvent sur le paradoxe d’une économie de l’abondance qui compte de plus en plus de défavorisés. Comment expliquer et éclairer ce paradoxe ?
Patrick Viveret : L’économie est actuellement dominante, mais elle est incapable de se substituer au lien social, qui se distend de plus en plus. Dans ses « Perspectives économiques pour nos petits-enfants », dernier chapitre de ses Essais sur l’économie et la monnaie, J.M. Keynes constatait déjà en 1930 : Sauf catastrophe majeure, la richesse globale à la fin du siècle sera multipliée par huit. Sa prédiction était prophétique, car elle s’est réalisée malgré la catastrophe majeure de la Seconde Guerre mondiale. Globalement, les problèmes de production, de moins en moins importants, deviennent seconds derrière les questions essentielles : « Pourquoi vivons-nous ? Que fait-on des hommes ? » L’économie devrait être désormais, ajoutait Keynes, une discipline comme la dentisterie : essentielle en situation critique, elle est marginale dans la vie courante.
Les conditions objectives de la production se trouvent atteintes, et les rapports des hommes entre eux deviennent donc prioritaires. Pourtant, crainte ou désarroi, l’économie garde une place dominante, fondée sur l’obsession d’une croissance continue. Celle-ci, malgré la production croissante de richesses, n’a pas mis fin à la misère : l’écart entre les plus pauvres et les plus riches sur la planète, qui était de 1 à 30 en 1960, est passé de 1 à 82 en 1995. La croissance cherche bien plutôt à satisfaire une sorte de loi de nature, qui n’a plus de raison d’être. En créant les conditions de l’abondance, elle est prise à son propre piège, qui conduit à marginaliser l’économie elle-même.
Une économie vide de sens
On peut comparer cette évolution à un phénomène de régression infantile, où l’on voit des adultes angoissés se raccrocher à des réflexes d’enfants. Incapables d’affronter les grandes angoisses dues aux mutations de notre temps, les collectivités humaines se fabriquent des repères sur des bases périmées, autour de l’obsession de la production : la productivité est devenue une véritable religion. Mais, alors que l’adulte angoissé se tourne vers la psychanalyse, la société occidentale soigne sa dépression nerveuse collective par la guerre économique, qui aggrave encore la difficulté. Nous sommes, en réalité, confrontés à une guerre économique mondiale, dont les causes sont beaucoup plus sociales et culturelles que proprement économiques. D’où l’hypothèse de Keynes, reprise sous une autre forme par Georges Bataille et d’autres acteurs, sur les racines psychiques de ce phénomène paradoxal.
Le citoyen, créateur de sens
Ni les révolutions, ni les solutions toutes faites ne peuvent changer cet état de choses : obsédées par l’idée de l’ordre, elles mènent à tous les totalitarismes. Il faut une sorte de conversion, qui nous concerne tous. Les entreprises elles-mêmes en ont conscience, puisque leur propre stratégie prend maintenant en compte des considérations éthiques.
Si l’analyse est complexe, la stratégie à définir ne l’est pas moins. Je pense à un » réformisme radical » : un souci de réforme qui repère les objets de transformation, reste disponible, se laisse surprendre par les événements ; mais un réformisme radical et non empirique, qui prenne les événements à la racine, sans négliger leur complexité. À société complexe, il faut des stratégies fines.
Un exemple nous en est donné par l’existence des » monnaies plurielles « . Un séminaire récemment organisé par Transversales, et dont le numéro 58 de la revue rend compte en détail, montre la variété des expériences conduites jusqu’ici en la matière. Techniquement parlant, elles ont toutes été des réussites : les systèmes d’échanges locaux (SEL), les réseaux de troc en Argentine, les banques du temps italiennes, le système américain des time dollar, et autres. Je me permets de citer l’éditorial de la revue : Nés pour l’essentiel d’un dysfonctionnement majeur de nos économies qui creusent les inégalités et rendent une portion croissante de la population insolvable, ces mouvements rendent d’abord des services éminents dans le domaine de la réinsertion et de la lutte contre la pauvreté. C’est au nom de la reconnaissance de cette fonction qu’ils ont pu bénéficier jusqu’ici d’une compréhension globalement intelligente de pouvoirs publics et de la Banque de France.
La mutation contemporaine est tout à la fois géopolitique, technologique, culturelle et sociale. Elle est en outre systémique, car ses causes et effets interagissent pour engendrer de nouveaux bouleversements, porteurs d’espoirs mais aussi de régressions. Pour penser ensemble tous ces éléments, il faut une capacité d’analyse et d’action, qui lie d’un même mouvement une logique de résistance et une capacité dynamique d’anticipation et de solidarité. Telle est l’ambition de Transversales Science/Culture et du Groupe de réflexion inter et transdisciplinaire (GRIT), qui comptent dix ans d’existence. En partenariat avec les forces scientifiques, culturelles, sociales, civiques et politiques qui adhèrent à la perspective d’un humanisme renouvelé, la revue cherche à jouer un rôle d’éclairage, de défrichage et d’anticipation.
Le Centre international Pierre Mendès-France (CIPMF) est, au-delà des courants et des clivages, un lieu de rencontres et de débats entre innovateurs et décideurs qui désirent maîtriser les effets de la mondialisation, et offrir une alternative aux sentiments de peur ou d’impuissance. Il entend publier, sous forme de cahiers, les résultats de ses travaux. Un premier cycle de cahiers veut préciser les problèmes majeurs de la planète et les points de consensus ou de dissension. Un deuxième cycle voudrait proposer des pistes concrètes pour un renouvellement de l’action politique.
Transversales : 01.45.78.34.05. CIPMF : 01.45.78.34.03.
Fax commun : 01.45.78.34.02.
Mais des blocages d’ordre fédéral, juridique, politique en ont imposé l’arrêt – parfois temporaire (la banque suisse WIR fonctionne toujours et donne satisfaction). Si la monnaie jouait son rôle de facilitateur d’échanges, il n’y aurait pas d’insolvables (sauf cas pathologiques). Mais, comme l’ont montré André Orléan et Michel Aglietta dans leur livre La violence de la monnaie, celle-ci est ambivalente. Elle est à la fois facteur de pacification et d’échange, et vecteur de violence et de domination.
Une esquisse de stratégie
Que peut-on faire pour lever les blocages ? Avant tout, demander aux pouvoirs en place, qu’ils soient publics ou privés, une attitude de « réactivité positive ». En 1930, la rigidité des pouvoirs publics a fait échouer des solutions qui auraient pu atténuer la crise. La souplesse des entreprises, comme l’explique Robert Reich au cours d’une entretien récemment publié dans Le Monde, doit être aussi bénéfique aux salariés qu’à l’employeur. Et le « désaccord fécond » que nous pratiquons à la rédaction de Transversales est une alternative à la violence. C’est d’ailleurs pourquoi je ne crois pas trop aux théories complètes, « clefs en mains ».
Il faut aussi montrer que d’autres voies sont possibles. Le système, je l’ai dit, est plus malléable qu’il n’y paraît ; il présente des interstices dont on peut tirer parti. Microsoft, qui a commencé comme un gag d’une bande de copains, a compris que le piratage de ses logiciels était le meilleur moyen d’assurer leur diffusion : ce n’était pas de la logique économique classique. Et, le jour où Apple a voulu faire les choses dans les règles, elle a failli en périr. L’avenir de telles entreprises dépend, pour une part, de leur capacité de ne pas se prendre au sérieux.
Le modèle qui marche le mieux relève de ce que j’appellerai les « coopérations ludiques ».
Enfin, les citoyens doivent se prendre eux-mêmes en mains – surtout dès lors que l’État, trop rigide, tend à se désengager. Il existe beaucoup de « nouvelles places publiques », « d’espaces dépollués », répondant à une logique dont les médias ont peine à rendre compte. Ainsi en est-il, par exemple, de la petite ville de Parthenay (Deux-Sèvres), dont les habitants dialoguent sur Internet, et dont le maire incite à développer l’innovation sociale et civique. La relation entre personnes devient fondamentale, sous peine de solitude et de vertige, auxquels on tente d’échapper en se refabriquant des contraintes du travail. La citoyenneté active devient un impératif : les questions de société sont maintenant plus complexes qu’au lendemain de la guerre, elles sont désormais transversales et pluridisciplinaires. Les mouvements doivent intégrer l’expertise et l’intelligence collective. On ne pèse plus sur les décideurs qu’avec de bons dossiers, ce qui est assez nouveau. Les écologistes sur la question de l’enfouissement des déchets, le mouvement ATTAC avec son conseil scientifique et son autoformation interne l’ont bien compris.
X‑Action : Que proposeriez-vous, pour conclure ?
Patrick Viveret : Il me paraît nécessaire d’en appeler à une sorte de mobilisation des citoyens, par tous moyens d’expression et en tous lieux. Je crois plus à la créativité de la base qu’aux remises en question chez la plupart des élites, trop marquées par un mode de vie et de pensée dont elles ne croient pas possible de sortir. Et il faut agir vite, d’autant plus que les risques de catastrophes existent : en témoignent le surendettement des ménages américains, ou la situation en Russie. Mais, au-delà du pessimisme qui paralyse, nous devons avoir l’ambition d’être acteurs pour surmonter la crise. L’expression chinoise du mot « crise » utilise les deux idéogrammes « danger » et « opportunité » : sage conseil qui devrait nous tenir en alerte pour nous garder de l’un et nous saisir de l’autre.


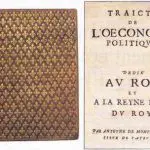

Commentaire
Ajouter un commentaire
des mots pour ne rien dire
Cet article, comme la plupart des productions de son auteur, est un ramassis de slogans creux indigne d’être publié dans cette revue.
Je propose que la fenêtre de notation étende les choix possibles à « zéro étoile » et à une à cinq poubelles.