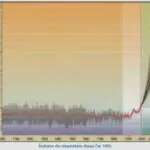Quels leviers pour gérer les biens publics ?

La gestion des biens publics ou biens collectifs pose un problème économique qu’un célèbre article de Garret Hardin1 permet de poser clairement. Si plusieurs bergers font pâturer leurs animaux dans un pré commun, sans en payer le moindre coût, l’intérêt immédiat de chacun (faire pâturer le maximum de bêtes) pourra s’opposer à l’intérêt général (limiter le nombre de bêtes qui pâturent) et pour finir s’opposer à l’intérêt de chacun, mais à plus long terme. Le « système » laissé à lui-même, sans échange ni coordination entre les bergers, conduit sûrement à la destruction du pré par surpâturage. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé pour la morue de Terre-Neuve : surpêchée elle finit par s’épuiser, au plus grand tort des poissons, des écosystèmes, de la collectivité publique et… des pêcheurs eux-mêmes, dont le gagne-pain disparut avec la morue.
Les économistes ont beaucoup planché sur ce paradoxe. La solution la plus simple, que l’histoire a d’ailleurs consacrée en matière de pâturage, est la privatisation des terres. Le propriétaire peut raisonner en intégrant la valeur de capital du pâturage sur un horizon long. Mais cette solution n’est pas toujours applicable. Peut-on privatiser l’atmosphère terrestre ? Dans ce type de situation, il est devenu classique en économie publique de proposer des outils, qui contribuent à redonner un prix à l’accès à un bien collectif qui n’en a pas spontanément. Ces outils sont les taxes, les quotas, et les « politiques et mesures » (dont la réglementation et les normes techniques ont constitué la plus grande part jusqu’à aujourd’hui). Nous allons voir dans la suite comment il est possible de les combiner pour le cas très actuel de la réduction des émissions de gaz à effet de serre au plan mondial qui nous servira d’illustration principale.
Donner une valeur au carbone
La théorie définit les biens publics comme des biens « non-rivaux » (l’usage par un agent n’affecte pas l’usage par un autre agent) et « non-excludables » (il est impossible d’empêcher un quelconque agent d’user de ce bien). Il en découle dans la pratique un certain nombre de caractéristiques spécifiques : ce sont des biens, des services ou des ressources qui bénéficient à tous mais dont le coût de production ne peut être imputé à une entreprise ou un individu particulier. C’est le cas des ressources naturelles et plus généralement des services écologiques2.
Les deux types de cas sont les ressources naturelles (eau, énergie, matières premières) et les capacités de recyclage naturel, abordées en général sous l’angle de la pollution qui les mobilise. Dans les deux cas, la nature nous offre ces services gratuitement et elle ne peut le faire que de manière limitée. Toute exploitation croissante ou simplement constante de ces services sans reconstitution conduit inéluctablement à leur disparition. Ce risque était ignoré ou passait pour lointain à nos ascendants. Pour certaines ressources vitales, elle devient d’actualité pour nous et nos descendants proches. Comment faire alors pour corriger le tir ?
En donnant un prix au polluant ou au déchet3 dont on veut limiter l’émission
Donner un prix à un polluant ou déchet, le marché ne le fait en général pas pour une raison simple : lorsque c’est la nature qui recycle, elle ne se fait pas payer pour le service qu’elle nous rend. Nous ne recevons aucune facture et n’avons donc pas à payer le prix de ce service. Cette gratuité pousse, nous l’avons vu, à une hausse sans cesse croissante de l’usage des capacités naturelles. Pourquoi se priver d’un vrai service qui ne coûte rien ? Or la capacité de recyclage de la nature est en fait toujours limitée.
Pour le CO2, les physiciens du climat nous disent que nous pouvons émettre dans l’atmosphère l’équivalent de 2 à 3 milliards de tonnes de carbone par an. Nous en émettons aujourd’hui au niveau mondial plus du double, et continuons à faire croître nos émissions. Pour changer de trajectoire et nous limiter volontairement sans imposer de despotisme, il faut, comme le suggèrent tous les économistes, donner un prix aux émissions de carbone4.
Comment faire ? La taxe est la solution la plus simple et la mieux connue. Elle fut la première théorisée par un économiste, Arthur Pigou en 1920.
L’idée de quotas négociables est apparue beaucoup plus tard, à partir des apports de Ronald Coase en 1960 sur les droits d’accès à l’environnement, dont John Dales propose en 1968 la mise sur le marché. Rappelons-en le fonctionnement en quelques mots, toujours sur le cas des gaz à effet de serre. Il s’agit de plafonner leurs émissions, en donnant (ou en vendant aux enchères) un droit (ou quota) à chaque pollueur, et en organisant un marché de ces droits. Tout émetteur peut alors faire ses arbitrages : investir plus pour polluer moins (et accéder ainsi à des quotas qui ont une valeur marchande), si ses coûts de dépollution sont inférieurs au prix de marché, ou, dans le cas inverse, polluer plus et devoir se procurer des droits. Une pénalité dissuasive doit évidemment être prévue si le pollueur émet plus que le total de ses droits (alloués et achetés). On comprend aisément que ce système crée une rareté (si le total des quotas alloués ou cédés est inférieur aux émissions actuelles) et un prix de marché. En théorie, l’objectif de réduction est donc atteint tout en minimisant les coûts de dépollution des pollueurs. L’avantage principal des permis négociables est de découpler la fixation d’objectifs publics des moyens de l’atteindre, délégués au marché, supposé réaliser l’objectif quantitatif à moindre coût. La première application de ce système eut lieu aux États-Unis pour le dioxyde de soufre (voir encadré) mais c’est le protocole de Kyoto qui le mit en vedette au plan international.
Les quotas : pas sans défaut, mais sans doute incontournables
Le système de quotas a l’avantage de fixer une quantité à ne pas dépasser ; si cette quantité est bien évaluée (en général à partir de données scientifiques ou techniques) elle peut être fixée par la puissance publique et offrir ainsi une garantie sur l’atteinte « physique » de l’objectif. En revanche, le prix des quotas que le marché va fixer est inconnu à l’avance. La taxe présente l’avantage et l’inconvénient symétriques : son coût est connu mais son effet quantitatif en matière de réduction des émissions est inconnu à l’avance. Les deux inconvénients symétriques ne sont évidemment pas sans conséquences économiques et environnementales.
Un exemple de mise en place de système de permis d’émission : le Clean Air Act
Ironie du sort, le protocole de Kyoto, que les États-Unis (responsable de 22% des émissions mondiales de CO2) ont refusé de ratifier, s’inspire d’une réussite américaine, le Clean Air Act, qui a incité les Américains à pousser dans la négociation du protocole ce mécanisme au détriment d’une taxe carbone.
En 1990 en effet, le Clean Air Act Amendement crée, pour les compagnies productrices d’électricité responsables de 70 % des émissions de SO2, un système d’échange de droits d’émissions de ce polluant (ainsi, pour mémoire, que de NO2). L’objectif est de diminuer de 40 % les émissions du SO2 en 2000 par rapport à 1980 (25 millions de tonnes), soit une réduction de 10 millions de tonnes. Les pénalités sont dissuasives puisqu’en 1995 elles étaient fixées à 2 000 $/t SO2, soit au moins le triple du coût marginal estimé de réduction des effets de serre, et bien supérieures au prix moyen des permis (150 $). En 1995, 8,7 millions de permis d’une tonne ont été distribués et seulement 5,3 millions de tonnes de SO2 ont été émises. L’objectif initial a été largement dépassé.
Les expériences de quotas et de taxes commencent à être assez nombreuses pour qu’on puisse compléter utilement l’analyse des avantages-inconvénients. La taxe a évidemment des impacts majeurs sur deux registres principaux : l’équité et la compétitivité. L’aspect redistributif est évident : la taxe, imposée sur des consommations énergétiques, touchera les ménages de manière directement proportionnelle à leur consommation, elle ne sera ainsi pas progressive. D’autre part, une taxation nationale (rappelons qu’au sein de l’Union Européenne, les États ont gardé la maîtrise de leur fiscalité, avec des règles spécifiques pour la TVA et la TIPP) peut alourdir les prix de revient des entreprises concernées et les handicaper ainsi face à la concurrence des entreprises étrangères non soumises à la taxe.
Concernant les quotas, une analyse peut être menée à la lumière de l’expérience de la première phase du système européen des quotas (2005−2007), installé par une directive de l’Union Européenne concernant exclusivement les « gros » émetteurs de CO2, de l’industrie et du secteur électrique. La première difficulté structurelle est bien évidemment celle de la méthode à retenir pour la fixation des quotas. Dans cette première phase, ce sont les gouvernements des pays qui ont été chargés, au nom de la subsidiarité, de négocier avec leurs industriels le montant des quotas, sans coordination au niveau européen. Le niveau total fut fixé trop bas et sur la fin de cette première période le cours du CO2 très faible. Deuxième problème : des quotas ont été gardés pour les « nouveaux entrants », au motif qu’il ne fallait pas brider le développement économique. Il en est résulté de fait une subvention au charbon car de nouvelles centrales au charbon se virent allouer des quotas gratuits.
Or un quota est un actif, dont ces allocataires ont injustement bénéficié. Troisième problème, le système adopté en 2005 n’a pas prévu la conservation des certificats pour les « sortants », créant ainsi une désincitation à la fermeture des installations, même très polluantes. Enfin dernière difficulté majeure : le système ne portait que sur un horizon très court (2005−2007) sans possibilité de transferts des droits (bancabilité) sur la période suivante. Or, dans le domaine concerné, celui de l’énergie principalement, les décisions les plus importantes au plan environnemental sont les décisions d’investissement qui ne se prennent que sur des périodes longues.
Une contrainte sur une durée courte n’a pas d’impact sur les décisions. Il a manqué à cette première étape un élément de visibilité sur la contrainte à long terme pour les industriels
On le voit dans cet exemple illustratif, le « diable est dans les détails ». Un système de quotas a des avantages clairs sur la taxe mais n’est certainement pas dénué d’inconvénients, qui dépendent largement de la manière dont le dispositif est organisé. Profitons-en ici pour tordre le cou à une idée reçue. Taxes et quotas sont tous les deux des dispositifs d’économie de marché régulée. Quoi qu’en disent certains, l’un n’est pas a priori plus libéral que l’autre, tous deux supposent le libre jeu des acteurs, mais sous une contrainte imposée par une puissance publique. À l’usage, les quotas supposent même une administration et un contrôle plus poussés, pour la vérification des quantités émises (supposant des audits techniques) ou pour la réglementation précise de l’ensemble. Mais on pourra aussi arguer que la mise en œuvre d’une taxe impose aussi la prise en compte d’aspects techniques, telle par exemple la nécessaire révision pour prise en compte de l’inflation.
Des quotas pour le concentré, une taxe pour le diffus
À ce stade, il apparaît aujourd’hui essentiel de s’orienter en France5 vers un dispositif articulant d’une part le système européen des quotas d’émission pour l’industrie lourde, et d’autre part une taxe sur le CO2 ou Taxe de Lutte contre le Changement Climatique pour tout le reste, les émissions diffuses : transports, bâtiments, industrie légère et services.
Le système européen des quotas peut sans doute demeurer la base de la régulation environnementale pour les industries grosses consommatrices d’énergie et le secteur électrique. Ce marché constitue une expérience sans précédent de régulation environnementale internationale ; il est devenu le point d’amarrage potentiel des autres régions du monde – ou, pourquoi pas, de certains États américains – dans la constitution d’un futur marché mondial du CO2. Abandonner cet acquis serait risquer de perdre la proie pour l’ombre. On voit mal pourquoi il faudrait prendre ce risque aujourd’hui. Ce qui est à l’ordre du jour c’est l’amélioration de l’existant pour l’attribution des quotas – et probablement la préparation d’un « benchmarking » européen -, la durée du dispositif, la régulation des entrées et sorties, la possibilité d’un recours plus prononcé aux enchères6, etc.
Mais ce marché ne couvre qu’un peu moins de la moitié des émissions en Europe et un peu plus du tiers en France, où le secteur électrique est faiblement émetteur de CO2. Il n’est pas aisément généralisable aux secteurs où le nombre des émetteurs est élevé comme ceux des industries légères, des services, de l’habitat et des transports. Dans ces cas-là, il faudra très probablement passer par l’instauration d’une taxe sur le carbone. Cette taxe fera évoluer les technologies, les infrastructures et les comportements, mieux et plus sûrement que les seuls discours ou appels à la morale. Elle suscitera à l’évidence la création de nouvelles activités, qui deviendront rentables face à une énergie de plus en plus chère : l’efficacité énergétique dans tous les secteurs, à commencer par le bâtiment, le secteur de la réparation et du recyclage, celui des énergies renouvelables.
Nouvelles activités, donc nouveaux emplois. Tout comme la hausse de la TIPP et les contraintes environnementales sont l’une des causes de l’innovation dans l’industrie automobile, la taxe que nous préconisons aura des effets vertueux sur tous les secteurs concernés.
L’introduction de cette Taxe de Lutte contre le Changement Climatique devra cependant répondre à plusieurs caractéristiques, si l’on veut qu’elle soit efficace et acceptable. Elle doit tout d’abord être différenciée selon les secteurs, car elle devra déclencher des changements techniques et de comportement d’ampleur comparable dans chaque activité. Il suffit pour s’en convaincre de considérer qu’une taxe de 100 € par tonne de CO2 ne représenterait – en raison du facteur amortisseur de la fiscalité existante – qu’une augmentation de 25 centimes par litre d’essence, alors qu’elle entraînerait au moins un doublement du prix de l’énergie pour l’industrie légère… On voit bien qu’une taxe uniforme à ce niveau n’aurait qu’un impact minime sur les transports, alors qu’elle serait à court terme jugée intolérable dans l’industrie.
La taxe doit également être progressive pour qu’elle soit acceptable et qu’elle permette de gérer correctement les transitions en encourageant les comportements d’anticipation ; mais son niveau doit finir par être significatif. L’expérience montre que des taxes trop faibles n’ont qu’un faible effet incitatif et n’atteignent pas le but recherché. Dans notre cas, il faut probablement viser à terme au moins une multiplication du prix de l’énergie par facteur un et demi à deux. Il ne s’agit bien sûr que d’une indication, mais en ordre de grandeur, une taxe de 400 €/tCO2, introduite linéairement, conduirait à une multiplication par deux du prix des carburants, avec environ + 3 centimes par an jusqu’en 20507. Dans le secteur de l’industrie légère, le doublement à terme du prix de l’énergie fossile serait obtenu avec une taxe de 100 €/tCO2 et dans le secteur résidentiel-tertiaire par une taxe de 200 €/tCO2. Dans ce dernier cas, on passerait pour le fioul à un prix d’environ 60 € pour 100 à 110 litres, soit une augmentation annuelle d’un peu plus d’un euro les 100 litres.
Le triple dividende de la taxe carbone
La prévention du dérèglement climatique est bien évidemment la motivation première de cette proposition, cependant deux autres raisons poussent à penser que cette taxation des émissions est la moins mauvaise des solutions qui s’offrent à nous.
Tout d’abord l’Europe fait face à un risque géopolitique majeur en matière énergétique. Sa dépendance à l’égard du pétrole et du gaz, dont la production domestique va inéluctablement décroître dans les prochaines décennies, ne pourra être réglée par le seul recours à l’énergie nucléaire (long et difficile à déployer) ou par un retour au charbon (plus polluant8 aujourd’hui que le gaz et le pétrole, et dont 80 % des réserves mondiales sont situées dans 6 pays seulement, tous extra-européens). Dans le calendrier très court qui nous sépare de ces baisses de production, il faut impérativement faire baisser rapidement et significativement notre consommation d’énergie, en Europe et en France en particulier.
Ne pas le faire serait, d’une part, prendre le risque de subir des nouveaux chocs : qui peut penser en effet à une stabilité des prix et des conditions d’approvisionnement pour le pétrole et le gaz lorsque l’offre sera devenue insuffisante par rapport à la demande ? Des chocs violents auraient évidemment des conséquences sévères pour ceux qui dans nos sociétés restent dépendants dans leur vie quotidienne d’une énergie bon marché. Entre une augmentation anticipée et accompagnée du prix de l’énergie, dont le produit resterait en France, et une succession de chocs imprévisibles et violents, qui ne profiteraient qu’aux pays producteurs et augmenteraient le chômage en Europe, est-il si difficile de faire un choix ?
D’autre part et plus prosaïquement, toute forte réduction des consommations d’énergie, qu’elle soit due à un « miracle technologique »9 ou à un autre dispositif de régulation10 devrait de toute façon s’accompagner d’un renforcement de la fiscalité. La TIPP représente aujourd’hui, avec plus de 20 milliards d’euros par an, la quatrième recette fiscale de l’État. Sa baisse, consécutive à la baisse de la consommation de pétrole, constituerait une menace grave pour les finances publiques, dans un contexte déjà tendu (il manque chaque année 20 % de recettes pour financer le budget de l’État, et c’est la différence qui augmente la dette). Une taxe de 400 euros par tonne de CO2 dans les transports pourrait permettre de compenser cette baisse. Peut-on imaginer qu’une cure d’amaigrissement de ces recettes soit souhaitable aujourd’hui alors que l’État va avoir besoin de tous ses moyens pour se préparer à tous les défis qui s’annoncent ? (retraites, changement climatique…). Encore faudrait-il évoquer les risques « d’effet-rebond » : les gains d’efficacité technologiques conduisent à une intensification des usages et à une augmentation globale de la consommation d’énergie.
Si cette nouvelle taxe semble indispensable, la principale difficulté qu’il s’agit de gérer est bien celle de la transition. L’introduction de signaux économiques ne peut avoir un effet immédiat sur les stocks d’équipements et de bâtiments. Les technologies, les comportements et les infrastructures ne sont pas encore adaptés, dans la période de transition, à ces nouveaux prix. Le doublement du prix de l’essence serait indolore si l’on disposait instantanément de voitures basse consommation et de plus de transports en commun. Mais dans la période de transition, les effets redistributifs seront significatifs, le cas échéant insupportables pour certaines catégories de la population ou certains acteurs économiques. Il faut donc disposer de ressources pour y faire face et accompagner le changement.
Dans tous les pays, les gouvernements devront dans les prochaines années faire face à de graves responsabilités. Car, rapport après rapport, le GIEC11 confirme son diagnostic : il ne nous reste plus que quelques années avant de changer de trajectoire. En France les gouvernements devront faire preuve de lucidité et de courage pour programmer une hausse du prix des énergies fossiles, en commençant dès maintenant et en visant une croissance progressive au cours des prochaines décennies. Ils fourniraient ainsi le bon signal à tous les acteurs de l’économie : celui de la nécessité d’innover pour les usages énergétiques du futur, d’investir pour le réajustement des grandes infrastructures urbaines et de transport, de modifier les comportements pour éviter les crises de ressources et d’environnement global qui menacent les sociétés modernes, et par là même chacun(e) d’entre nous.
_________________
1. Hardin G. 1968. The tragedy of the commons. Science 162 : 1243–1248
2. Pour reprendre le terme popularisé par le Millenium Assessment Report 2006.
3. Le CO2 n’est pas en lui-même un polluant toxique et dangereux (sauf cas exceptionnel quand une surconcentration élimine l’oxygène de l’air). Mais c’est le déchet de la combustion des énergies fossiles, dont seule l’accumulation dans l’atmosphère pose problème.
4. C’est entre autres l’une des recommandations majeures du rapport Stern : « Il faut donner une valeur au carbone ». C’est aussi le point de vue de très nombreux économistes du « Pigou club » dont font partie, entre autres noms prestigieux, les prix Nobel Joseph Stiglitz et Gary Becker mais aussi Alan Greenspan, l’ancien président de la banque fédérale américaine, ou le célèbre Paul Krugman. connu internationalement.
5. Mais aussi dans les autres pays du monde bien sûr.
6. Par opposition au mécanisme d’allocation gratuite.
7. C’est précisément ce chiffre qu’a retenu la commission énergie, dite commission Syrota, qui propose une augmentation plus forte (de 5 centimes par litre) pour le gazole jusqu’à égalisation des taxes (TIPP + TLCC).
8. Les dispositifs de captage et de séquestration du CO2 en sortie des centrales à charbon font l’objet de recherche et de travaux non négligeables. Mais il n’est pas acquis qu’ils puissent être industrialisés (pour les centrales neuves) avant 2030 et ils ne règlent ni le cas des centrales existantes ni bien sûr celui des émissions liées à l’usage du Coal To Liquid qui va s’accélérer dès que les tensions sur le pétrole vont s’accroître, ce qui ne saurait tarder.
9. Est-il en fait si difficile d’imaginer une généralisation d’ici dix à vingt ans de véhicules consommant 3 à 4 l/100 km ?
10. Un système alternatif, celui de la carte carbone, est en cours d’étude en Grande – Bretagne. C’est un système de quotas pour le secteur diffus.
11. Groupement intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat.