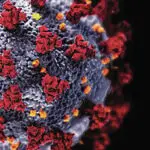RÉMINISCENCES
Notre bien-être à tout instant – on n’ose pas dire notre bonheur – est fonction de ce que nous apporte l’instant présent, de ce que nous attendons des temps à venir, et, bien sûr, de ce qui nous reste de notre passé. On peut dire, à la suite d’un de nos camarades, que notre fonction de satisfaction est, en gros, la somme, avec des pondérations qui dépendent de chacun de nous, de notre satisfaction immédiate et de toutes nos satisfactions passées et espérées (positives ou négatives, bien entendu), nanties de coefficients d’actualisation eux aussi spécifiques à chacun de nous.
La musique que nous aimons n’échappe pas à cette règle, mais avec une caractéristique unique : nous pouvons revivre indéfiniment une écoute, grâce à l’enregistrement. Et il nous prend souvent l’envie d’ignorer toute nouvelle interprétation d’une oeuvre qui nous est chère : rien ne vaudra jamais, au fond, celle qui nous a transportés un jour et que nous ne pouvons oublier.
Brahms – Liebeslieder-Walzer
Dietrich Fischer-Dieskau, Peter Schreier, Brigitte Fassbaender, Édith Mathis vous ont fait découvrir dans les années quatre-vingt les Valses des chants d’amour de Brahms : un quatuor vocal de rêve, pour une musique ineffable1. Et c’est bien de rêve qu’il s’agit : les réunions entre amis pour lesquelles ces pièces ont été conçues ont depuis longtemps disparu de la vie bourgeoise de notre vieille Europe, et les effusions sentimentales et subtiles de Brahms, amoureux, à l’époque de la composition, de la fille de ses amis Schumann, Julie, ne sont plus aujourd’hui que des évocations raffinées pour sybarites hédonistes.
Mais quel plaisir ! À l’opposé de Ravel, qui a traité la Valse comme un tourbillon mortifère d’apocalypse – c’était l’esprit du ballet qui, en définitive, comme on le sait, ne vit pas le jour – et du Debussy de la Plus que lente, pièce vénéneuse et géniale pour salons proustiens, Brahms fait de cette musique (Liebeslieder, Neue Liebeslieder, et Trois Quatuors vocaux opus 64) l’essence même de la jouissance musicale au premier degré, pour l’auditeur qui veut bien abandonner, l’espace d’un instant, avec la crise, les problèmes de la collectivité et les siens propres.
Et ces quatre chanteurs, dont chacun est, en 1983, l’année de l’enregistrement, au sommet absolu dans son domaine – lieder, opéras, cantates – atteignent ici, grâce à une science de l’expression vocale proprement inouïe, à une sorte de nirvana musical. Les accompagnateurs sont Wolfgang Sawallisch – que le métier de chef d’orchestre a doté d’un sens de l’accompagnement d’une infinie délicatesse – et Karl Engel (dans les Neue). Vous pouvez vous dire, à bon droit : on ne fera jamais mieux, et sans doute jamais aussi bien.
La 9e Symphonie de Mahler par Bernstein
Lorsque Leonard Bernstein dirige enfin pour la première fois le Berliner Philharmoniker en 1979, pour un concert au bénéfice d’Amnesty International, avec la 9e Symphonie de Mahler2, l’orchestre est, paraît-il, frappé de stupeur : Karajan, son chef en titre – volontairement absent ce jour-là, dit-on – l’a habitué à une interprétation rigoureuse, rigide et distanciée : c’est la dernière symphonie achevée de Mahler, dont on peut imaginer qu’il a abandonné la gangue de ses passions pour accéder à la sérénité. La vision de Bernstein, telle qu’il l’explique dans Mahler : his time has come, est à l’opposé : « C’est seulement après avoir connu les fours crématoires d’Auschwitz, les jungles frénétiquement bombardées du Viêtnam, après ce qui s’est passé avec la Hongrie, Suez, la baie des Cochons, le Black Power, les Gardes rouges […] C’est seulement après tout cela qu’on peut enfin écouter la musique de Mahler et comprendre qu’elle le présageait. » Et le charismatique et populaire Juif new-yorkais va, en quelque sorte, donner une leçon à l’aristocrate froid et ancien nazi Karajan : la musique n’est pas une ascèse, c’est une affaire de vie et de mort.
On sent cette tension au début de l’enregistrement, avec un orchestre quelque peu désorienté : la sérénité a fait place à la tragédie. Et peu à peu, au fil de la symphonie, tout se met en place jusqu’à l’adagio final, poignant et sublime ; et l’on peut croire, si l’on est optimiste, que les musiciens ne vont pas bien dormir le soir et qu’ils ne joueront jamais plus Mahler comme avant. Aussi, malgré de très belles et plus calmes interprétations de la 9e de Mahler, on n’oubliera jamais celle-là.
1. 1 CD Deutsche Grammophon.
2. 1 CD Deutsche Grammophon.