Un budget dans la moyenne de celui des pays de l’OCDE

La France dépense chaque année 17,7 milliards d’euros pour l’enseignement supérieur, soit 1,3 % de son PIB, plus que l’Allemagne et le Royaume-Uni, mais beaucoup moins que les États-Unis (3,0 %). Elle compte 2,2 millions d’étudiants, la dépense moyenne par étudiant s’élevant à environ 9 400 euros par an. De son côté, la recherche coûte 40 milliards d’euros par an dont plus de la moitié est financée par les entreprises.
REPÈRES
Pour séparer recherche et enseignement dans le supérieur, on a décidé conventionnellement que les enseignants-chercheurs passaient la moitié de leur temps en recherche et l’autre moitié en enseignement, une convention arbitraire qui recouvre une réalité très hétérogène (et ne parlons pas des professeurs des CHU qui recherchent, enseignent et travaillent dans des services hospitaliers).
En matière de recherche-développement, les dépenses des entreprises représentent plus de la moitié du total, la partie publique se décomposant elle-même entre ce qui relève des établissements de l’enseignement supérieur et des grands organismes. Quant à l’enseignement supérieur, il réunit les universités et les grandes écoles (qui ont tendance à se rapprocher mais restent encore très séparées), mais surtout inclut le supérieur proprement dit et ce que je préfère appeler le « postbaccalauréat » (le niveau L) qui, lorsqu’il est efficace, a recours à des pédagogies du secondaire.
Ce système est en pleine évolution, du côté des entreprises avec comme conséquence des changements de la structure productive, du côté du secteur public par l’européanisation et la mondialisation qui tendent lentement à rapprocher notre organisation de celle des grands pays étrangers. D’ailleurs, deux lois ont été votées par le Parlement : en 2005, une loi sur la recherche et en 2007, une loi sur les universités. Elles modifieront sensiblement le paysage à terme.
Venons-en maintenant aux chiffres. Les seuls facilement disponibles sont ceux établis en application de règles internationales, la comptabilité publique française reposant sur des bases qui facilitent le contrôle, mais sont presque inutilisables pour la gestion. Les données citées proviennent de l’État de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, édité par le Ministère et du dernier livre de Futuris publié en 20071.
Le financement de l’enseignement supérieur
La DIE (Dépense intermédiaire d’éducation) s’élève en euros 2006 à 121 milliards environ, la part pour le supérieur représentant 17,7 milliards. La comparaison internationale n’est disponible que pour 2004. Elle montre que la France dépense 1,3 % de son PIB pour l’enseignement supérieur, soit sensiblement la moyenne de l’OCDE (1,4 %), plus que l’Allemagne et le Royaume-Uni, mais beaucoup moins que les pays nordiques, la Corée du Sud et surtout les États-Unis (3,0 %).
Une grande part de financement public

Plus de la moitié des dépenses concernent le personnel enseignant.
Au sein de l’OCDE, la répartition de l’effort entre financement public et financement privé s’étage entre la Grèce où le financement privé est quasi nul et la Corée du Sud où le financement privé dépasse largement le financement public. Les États-Unis et le Japon sont les deux grands pays où le financement privé est plus important que le public. Avec un financement public de 84,0 % et un financement privé de 16,0 %, le financement public français est de 9 points supérieur à la moyenne de l’OCDE (75,7 %). Il est très proche de la structure allemande, mais avec une part publique un peu plus forte qu’en Italie, Espagne et Royaume-Uni. Dans la partie privée, les ménages d’une part, les entreprises et les Chambres consulaires d’autre part comptent chacun pour environ la moitié.
Une explosion des effectifs
En euros constants, la dépense par étudiant a crû de 33% depuis 1980
Une fois fixé l’ordre de grandeur des dépenses, il est naturel de le rapporter aux effectifs du supérieur. Ceux-ci ont explosé, notamment entre 1990 et 1995 avec près de 600 000 étudiants supplémentaires. Néanmoins, en euros constants, la dépense par étudiant qui s’est élevée à 9 370 euros en 2006 a crû de 33 % de 1980 à 2006. Ce montant place la France dans la moyenne de l’OCDE au 14e rang.
À ces données globales, j’ajouterai quelques éléments plus spécifiques qui sont nécessaires pour comprendre la structure des financements :
• sur l’ensemble des dépenses, 53 % concernent les dépenses de personnel enseignant et 18 % les dépenses de personnel non enseignant, le fonctionnement représentant 19 % et le « capital » (un terme bien ambigu) 19 % ;
• le nombre d’inscrits dans l’enseignement supérieur, chiffre de valeur très relative pour les universités (hors IUT), est égal pour 2006–2007 à 2,254 millions. Chiffre qui ne croît plus depuis plusieurs années et a récemment diminué. Sur ce total, les universités (hors IUT) scolarisent 1,285 million et les autres formations un peu moins de 1 million, dont 76 000 pour les classes préparatoires et les grandes écoles ;
• à la rentrée 2006, plus de 500 000 étudiants, soit 30 % de la population de l’année, ont bénéficié d’une aide financière directe sous forme de bourses, mais la France se situe bien au-dessous de la moyenne OCDE quant au montant total des bourses ;
• enfin, la dépense moyenne par étudiant oscille en 2006 entre 7 840 euros à l’université, hors IUT, et 13 940 dans l’ensemble des classes préparatoires-grandes écoles.
Le maillon faible
Ces éléments – et dans le paragraphe qui suit, je m’exprimerai à titre personnel – ne me paraissent pas en contradiction avec le diagnostic suivant assez généralement partagé :
• le maillon faible de l’enseignement supérieur français est constitué par le premier cycle (hors IUT) où les techniques pédagogiques sont très éloignées de celles du secondaire pour convenir à une partie des inscrits ;
• l’éparpillement sur le territoire d’universités en général petites et traitées de manière trop homogène les conduit à assumer des tâches souvent à la limite de leurs moyens financiers (aussi le regroupement actuel dans le cadre de PRES constitue une évolution favorable) ;
• si, comme certains le demandent, les frais d’inscription à l’université doivent être relevés, une refonte profonde du système des bourses est indispensable ;
• les réformes récentes offrent des perspectives favorables, mais leur impact ne pourra être jugé que dans les prochaines années.
Le financement de la recherche
REPÈRES
En points de PIB, le pourcentage de la DIRD, qui était descendu à 2,15 % en 2000 (et même à 2,13%en 2005), est remonté à 2,20 en 2007, l’augmentation provenant principalement de la partie publique (de 0,81 à 0,84).
Les dons des ménages constituent un apport faible, mais sont précieux par leur signification sociale
Abordons maintenant le financement de la recherche-développement. La DIRD (Dépense intérieure de recherche-développement) est l’équivalent de la DIE. On lui adjoint naturellement, comme en comptabilité nationale, la DNRD (Dépense nationale de recherche-développement). Tandis que la première couvre l’ensemble des travaux exécutés sur le sol français, la seconde porte sur les activités financées par des institutions françaises. La différence représente évidemment le solde des flux financiers avec l’étranger dans ce domaine.
Pour commencer, je me limiterai aux chiffres de la DIRD. Elle se monte en 2007 (estimation de Futuris) à 40,82 milliards d’euros 2007, 15,56 de DIRD publique et 25,26 de DIRD des entreprises, soit respectivement 38,12 et 61,88 %.
Le rôle croissant des régions

La dépense intérieure de recherche-développement dépasse les 40 milliards d’euros.
Si l’on regarde d’un peu plus près la partie publique (DIRDA et DNRDA) les éléments majeurs à connaître sont les suivants.
Pour le financement (DNRDA), le montant de 19,09 milliards en 2007 provient principalement de l’État (89,74 %), puis des programmes intergouvernementaux (4,70 %), de l’Union européenne (3,69 %) et enfin des régions et collectivités territoriales (1,87 %) dont le pourcentage a doublé depuis 2000 et qui jouent un rôle croissant.
Pour l’exécution (DIRDA), le montant de 15,56 milliards en 2007 provient de ressources budgétaires récurrentes (11,54), de financements publics sur projet (1,65), de commandes publiques de RD (1,47), de contrats des entreprises (0,74) et de financement d’institutions sans but lucratif (0,17). On constate à quel point les dons des ménages constituent un apport faible, même s’ils sont précieux par leur signification sociale et leur facilité d’emploi.
En comparaison internationale, la DIRD française est en chiffre 2005 dans la moyenne de l’OCDE, mais au-dessous de l’Allemagne (2,46 %), des États-Unis (2,62 %), du Japon (3,33 %) et, en Europe, de la Finlande et de la Suède (chiffres 2005).
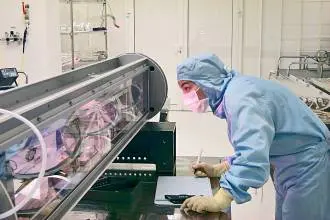
Donner aux laboratoires une plus grande liberté de gestion.
Pour la même année, la part de la DIRD exécutée par les entreprises est en France de 63 % contre 37 % pour les administrations, soit le même pourcentage qu’au Royaume-Uni, mais moins qu’en Allemagne (69 %), aux États-Unis (70 %) et au Japon (76 %).
Le tableau indique comment se décompose la DIRDA entre les différents acteurs publics. Il faut rappeler que le chiffre de l’enseignement supérieur résulte de la convention apportant à la recherche 50 % du temps des enseignants-chercheurs.
Il n’est guère possible d’aller au-delà, dans le cadre de cet article, mais depuis quelques années, les travaux du Ministère, de l’OST et de Futuris éclairent des questions comme les suivantes : pour la DIRD, comment se répartit la recherche par discipline, par branche industrielle ou par domaine technologique ?
Pour la DIRDA, comment se distribuent les ressources par financement récurrent et financement par projet ainsi que par objectif (production de connaissances, appui à l’innovation industrielle, défense, grands projets…) ?
Au niveau national, le pilotage de l’ensemble laisse à désirer ainsi que la définition des choix stratégiques. Émettre des avis sur ces sujets est la mission confiée au HCST (le Haut Conseil de la science et de la technologie) créé par la loi de 2005. Cette action venue d’en haut doit aller de pair avec la mise en place des mesures envisagées pour donner aux laboratoires une plus grande liberté de gestion et faciliter la collaboration entre le secteur public et les entreprises.
_________________________
1. J. Lesourne et Denis Randet, La Recherche et l’Innovation en France, Futuris 2007, Odile Jacob, 2007.
2. Établissement public à caractère scientifique et technologique.
3. Établissement public à caractère industriel et commercial.


