Un diplôme pour la gloire ?

Suivons donc le parcours d’un ingénieur français immigrant ou expatrié arrivant au Québec et souhaitant y exercer officiellement sa profession. En règle générale, et à la surprise des Français, le Québec ne reconnaît pas, en droit ou en fait, les diplômes français. En droit, c’était le cas des diplômes des Grandes Écoles avant la signature d’un accord en mai 2000. La situation était alors la suivante, l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), qui gère la profession, demandait un curriculum vitae, une spécialité et imposait un certain nombre d’examens techniques au candidat. En plus de frais fixes (500 $), il y avait des frais par examen (150 $), ce qui en soi est déjà une incitation à allonger la procédure. Il fallait ensuite réussir un examen » professionnel » sur les réglementations québécoises et l’éthique de la profession, un examen de français si nécessaire puis effectuer, sous le titre d’ingénieur stagiaire, un an de stage quels que soient l’âge et l’expérience professionnelle. Les ingénieurs des grands pays anglo-saxons dont les diplômes étaient eux déjà reconnus étaient dispensés des examens techniques.
L’OIQ explique en effet que sa fonction principale est d’assurer la protection du public et que » sa première préoccupation consiste à bien vérifier la compétence des individus qui demandent à être admis dans ses rangs « . Cette vérification s’applique donc à toutes les branches de la profession, le génie civil bien sûr, et elle incluait en 1998 les » spécialités » gestion de contrats et administration générale !
Ne nous y trompons pas, l’existence d’un ordre professionnel n’empêche pas le Québec d’avoir des catastrophes industrielles. Il suffit d’avoir vécu au Québec lors de la tempête de verglas de janvier 1998, pour se rendre compte des résultats d’une conception déficiente des réseaux de distribution électrique.
Comme on va le voir, rien n’a vraiment changé après mai 2000 et l’accès à l’exercice de la profession d’ingénieur est resté difficile au Québec. En fait ce n’est pas un cas particulier, l’accès à toute profession est difficile au Québec. Donc, avant d’aller plus loin, il y a un paradoxe apparent qu’il faut expliquer. On peut se demander pourquoi le Québec, un pays qui a tant besoin d’immigrants, surtout francophones, et les recherche activement, fait tout pour leur rendre la vie difficile (d’ailleurs une statistique récente montre qu’après sept ans 50 % des immigrants français sont déjà repartis). De fait le recours aux immigrants est une nécessité économique pour un pays trois fois plus grand que la France, n’ayant que 7,5 millions d’habitants et un taux de natalité bien inférieur à deux.
Le problème est que le Québec sélectionne ses immigrants et les choisit de préférence éduqués et avec un minimum de moyens financiers. Les Québécois, eux, veulent bien de l’argent des immigrants mais bien sûr pas de la concurrence que ces immigrants leur créent. Toutes les professions sont donc organisées pour faire face à cette concurrence et c’est d’autant plus vrai pour une profession comme la profession d’ingénieur qui n’a pas, et d’ailleurs n’a nulle part en Amérique du Nord, le prestige et le type de recrutement qu’elle a en France. En France c’est l’inverse, d’une part nous n’avons pas, pas encore en tout cas, recours à une immigration organisée et éduquée et d’autre part les ingénieurs, vu leur recrutement élitiste, n’ont jamais craint la concurrence étrangère. Complexe de supériorité ou péché d’orgueil, il n’y a pas d’ordre des ingénieurs en France : à cause de la méthode de recrutement justement, seul le diplôme est protégé.
La vraie mission de l’Ordre des ingénieurs du Québec est donc de protéger les membres de l’Ordre, essentiellement les natifs, des immigrants. En cela son rôle n’est pas différent d’un syndicat professionnel, si ce n’est que ses pouvoirs sont beaucoup plus étendus, même sur le vocabulaire.
La grammaire québécoise distingue trois types de noms, le nom commun, le nom propre et une nouvelle classe, le nom approprié au sens ancien du terme. C’est le cas du mot ingénieur dont l’usage exclusif a été concédé à l’OIQ. Son usage, dans un document écrit ou même dans un courriel, est soumis à poursuite ; mieux, on peut être condamné pour avoir été appelé ingénieur par un autre ! (arrêt Boulet, Cour du Québec, 25 juin 2003 et arrêt Boudrias, Cour du Québec, 9 septembre 2003). Bien entendu le terme » d’ingénieur système » est hors la loi et dûment poursuivi. L’OIQ attaque tous azimuts, même Microsoft n’y échappe pas avec ses ingénieurs certifiés.
En effet Microsoft a été condamné au Québec pour l’usage du mot ingénieur. La responsable du Conseil canadien des ingénieurs (CCI) a déclaré que c’était une bonne chose de ne pas confondre les ingénieurs canadiens dont la formation prenait sept ans d’université avec un ingénieur certifié Microsoft (Montréal Gazette, 8 avril 2004). Bien entendu personne dans la profession ne s’y serait laissé prendre. Et pourquoi sept ans pour un polytechnicien québécois contre six pour un français ? Probablement parce que l’origine des temps est prise en classe de seconde ! Le marketing est vraiment tout un art.
Le Canada, comme le savent les Italiens, est le pays du jambon de Parme. La loi canadienne interdit aux Italiens de vendre leur jambon de Parme au Canada, ce terme étant réservé à un produit d’origine canadienne. C’est l’usage de la loi contre le bon sens ! Il en est de même pour les ingénieurs, parce que l’OIQ décide qui peut utiliser le nom, il n’est ni nécessaire ni surtout suffisant d’avoir un diplôme : utiliser une carte de visite avec un titre étranger reconnu par le CCI, par exemple » Ingénieur diplômé de l’X » (où il faut bien sûr remplacer X par son école préférée), vous expose à des poursuites judiciaires coûteuses aux résultats sans appel ; réussir, à l’usure, les examens de l’Ordre sans aucun diplôme ne pose par contre aucun problème.
Dans ce cas, mieux vaut par contre être québécois, car une anecdote en dit long sur les examens en question. L’un de mes amis, ingénieur d’origine étrangère, titulaire d’un Ph. D., enseigne dans une université québécoise. Pour devenir ingénieur, au sens québécois du terme, il a dû passer les examens de l’OIQ et a initialement échoué à l’examen d’un des cours qu’il enseignait. Bien sûr, l’OIQ a rapidement donné satisfaction à sa réclamation, mais cet incident et le fait d’être juge et partie font planer un doute sur le rôle que l’OIQ attribue à ces examens : sélection ou protection ? Il a finalement fallu près de dix ans à ce professeur pour valider son diplôme.
La valeur du diplôme et sa reconnaissance font partie des clés du problème. Après des années de refus la France a fini par s’aligner sur le système anglo-saxon de licence, maîtrise, doctorat (If you can’t beat them join them). Les diplômes d’ingénieur valent maintenant un master ? En Europe peut-être, mais la loi n’est pas vraiment rétroactive, il faudra donc plus de trente ans, une génération professionnelle, pour que tous les ingénieurs français en activité aient un M. Sc. Il y a un autre problème : d’une certaine manière nous nous sommes décerné un titre de M. Sc. comme certains chefs d’État se nomment empereurs. Il n’y a pas eu de modification majeure au système d’enseignement : quelle équivalence allons-nous obtenir outre-Atlantique ? En 1998, l’université anglophone de Concordia au Québec, qui n’a pas dans le classement des universités canadiennes le même rang que l’X dans le classement de nos grandes écoles, n’accordait pour les diplômes de l’École polytechnique et de l’ENSTA, soit six ans d’études supérieures (et quelles études !), que deux ans d’une licence de science. Penser qu’elle va accorder d’un coup l’équivalent de cinq ans est probablement illusoire. Aux USA les polytechniciens obtiennent rarement plus qu’une licence. Vraisemblablement, le diplôme ne sera reconnu que sous condition d’une ou deux années de propédeutique, ce qui reviendra à ne pas le reconnaître. Au Québec peut-être nous accorderont-ils ce qu’ils appellent une maîtrise française (il faut un DEA pour prétendre à l’équivalent d’un M. Sc.).
La reconnaissance formelle du diplôme passe donc probablement par un accord international. Or, depuis mai 2000, les choses ont changé, un arrêté du ministre de l’Éducation nationale reconnaît les diplômes d’ingénieurs canadiens. On pourrait donc croire qu’une barrière s’est donc abaissée puisque ce type d’accord est soumis à réciprocité. De fait il n’en est rien, on croit d’ailleurs rêver quand on lit sur l’arrêté du 26 mai 2000 la référence à un accord de reconnaissance réciproque sur l’exercice de la profession d’ingénieur signé entre la Commission des titres d’ingénieur (CTI) et le CCI et son bureau d’accréditation (BCAPI). Les Français qui ont négocié cet accord ignorent manifestement le sens du mot réciprocité.
À la Sorbonne en novembre 2000, René-Paul Martin de la CTI déclarait : » On peut ajouter d’autres enjeux. Par exemple, combien de postes clés de décision seront occupés par des ingénieurs à la française parmi les premiers groupes industriels dans le monde ? » puis » L’internationalisation des professions est devenue une réalité. » On se demande alors comment après une telle analyse il a pu clamer comme un succès la signature de cet accord avec le Canada sous le titre : La CTI cherche à faciliter l’exercice du métier d’ingénieur dans d’autres pays. (La phrase est soulignée dans le texte, mais celui-ci se trouve sur le site du CCI, pas sur celui du CTI :).
Les spécialistes du commerce international savent combien les barrières non tarifaires sont un obstacle à la libre circulation des biens et services. Ils savent aussi que c’est un combat permanent ; sans vigilance, dès que l’une est démantelée une autre apparaît. De manière similaire, la non-reconnaissance des diplômes étrangers et la séparation diplôme – droit d’exercer la profession peuvent être considérées comme des barrières non tarifaires à la mobilité professionnelle internationale. La protection de la profession d’ingénieur au Canada et au Québec passe donc par une multiplication des obstacles. Ainsi la signature de l’accord avec le Canada a déclenché presque simultanément la modification de la loi du Québec sur les ingénieurs pour limiter au maximum l’accès à l’Ordre des ingénieurs étrangers et spécialement des ingénieurs formés en France. Il ne s’agit pas seulement de Français. Au Québec, une majorité d’immigrants francophones viennent maintenant d’Afrique du Nord et beaucoup d’entre eux sont formés en France puisque le Québec donne la priorité aux immigrants diplômés. Pour les autres ingénieurs étrangers, la protection la plus efficace vient du très pratique examen de français.
L’une des modifications aux conditions vues plus haut a consisté à changer la dénomination d’ingénieur stagiaire en ingénieur junior. Le changement est cosmétique pour un jeune diplômé, il est moins innocent pour les ingénieurs étrangers puisque cela revient à annuler leur expérience professionnelle : après dix ans de métier peut-on encore être ingénieur junior ?
Une autre modification concerne le délai de stage qui peut maintenant aller de un à trois ans. Le minimum pour un ingénieur étranger est d’un an car il lui faut toujours une année minimale d’expérience canadienne. Trois ans si l’ingénieur étranger a obtenu son diplôme depuis plus de cinq ans et n’est pas considéré comme ayant exercé pendant cette période ; de plus dans ce cas il peut se voir imposer des examens techniques même avec un diplôme reconnu : c’est le cas d’un ingénieur qui aurait arrêté d’exercer pour faire un doctorat.
Alors, est-ce un renforcement de la protection du public ? Pour en juger, notons que la règle ne s’applique pas à une ingénieure québécoise qui aurait par contre pris cinq ans de congé pour élever ses enfants et pris soin de dûment acquitter ses cotisations annuelles à l’Ordre. Donc même avec vingt ans d’expérience, les ingénieurs français, formés en cinq ans ou plus, doivent être mis sous tutelle par des ingénieurs locaux, formés en quatre ans ou moins et pas nécessairement plus expérimentés. Les ingénieurs canadiens d’Alcan ou de Bombardier n’ont, eux, comme seule contrainte à leur arrivée en France que de faire imprimer leur carte de visite… Bien sûr les ingénieurs de Péchiney, maintenant Alcan, sont les vaincus de la guerre économique, mais est-ce bien à la France de leur appliquer le vae victis ?
Dans le préambule de l’accord cité plus haut, on lit : la mobilité des ingénieurs diplômés professionnels entre les deux pays est d’un intérêt mutuel, et dans son premier paragraphe : les diplômés d’établissements d’enseignement habilités par la CTI se voient reconnaître les mêmes conditions d’admission aux ordres professionnels que les diplômés d’universités reconnues par le BCAPI, y incluant l’évaluation des acquis et de l’expérience conduisant à l’obtention du droit de pratique professionnelle. Clairement le but atteint par les Québécois a été d’obtenir la mobilité des ingénieurs québécois vers la France, en évitant l’inverse, et l’accord signé ne vaut guère plus que le papier qui le supporte.
Il n’y a que très peu d’exemples d’accords internationaux qui entérinent, surtout formellement, une non-réciprocité entre la manière dont deux pays traitent mutuellement leurs ressortissants. L’accord sur les ingénieurs signé avec le Canada est de ceux-là. C’est une reconnaissance par la France, en fait et en droit, de l’insuffisance de la formation de cinq ans ou plus qu’elle donne à ses ingénieurs.
De fait on peut penser, comme je l’ai entendu dire par un responsable des Affaires étrangères, un universitaire, que c’est très bien ainsi, la France souhaitant plutôt attirer des ingénieurs étrangers qu’exporter les siens. C’est une position à très courte vue si l’on veut vraiment que nos ingénieurs se retrouvent en fin de carrière à des postes clés dans les grandes multinationales. S’il y a plusieurs candidats potentiels de valeurs à peu près équivalentes, on sait bien qu’alors, dans ce type de décision, tout compte. L’appartenance à l’Ordre, le droit d’exercice de la profession, même si l’on ne s’en sert plus directement au niveau de direction, n’est sûrement pas négligeable. Entre un Canadien qui aura le droit d’exercer en France et un Français qui aura, même à quarante-cinq ans, le titre d’ingénieur junior au Canada on voit vers où penchera la balance.
De plus, le fait d’appartenir à un ordre des ingénieurs est en soi un moyen inégalable d’intégration dans une société étrangère. C’est aussi une source d’informations économiques, tout à fait intéressante pour un responsable d’entreprise. Évidemment un ingénieur français dans un poste décisionnel, même s’il n’a pas besoin de se faire reconnaître comme ingénieur pour exercer ses fonctions, serait en temps normal incité à s’inscrire à l’Ordre des ingénieurs. Au Québec, il est difficile pour un ingénieur expérimenté ayant des fonctions de direction d’accepter simultanément d’être un junior sous tutelle et donc, de barrière à l’emploi pour les immigrants, les règles de l’OIQ sont aussi des barrières à l’efficacité pour les expatriés. Le Conseil national des ingénieurs et scientifiques de France, qui est ce que nous avons de plus proche d’un ordre des ingénieurs, une version très light, sans sucre ni caféine, accepte les ingénieurs français titulaires d’un diplôme reconnu par la CTI et les titulaires d’un diplôme étranger sans autre condition. Certes, il y a aussi une catégorie ingénieur junior mais elle est pour les élèves-ingénieurs !
N’en déplaise aux Québécois, l’application par le Québec de l’accord avec le Canada est un exemple presque caricatural de la manière anglo-saxonne de respecter les accords de réciprocité. La structure girondine du pouvoir en Amérique du Nord et l’usage systématique de la démultiplication des autorités entre organismes nationaux, ici le CCI et les ordres d’ingénieurs provinciaux, rendent toujours les négociations délicates surtout si les négociateurs français ne comprennent pas que leurs interlocuteurs n’hésitent jamais à en user voire à en abuser. Cela doit donc nous servir de guide pour les négociations du même type comme celui de l’Accord de Washington :
(http://www.washingtonaccord.org/).
Celui-ci est un accord de reconnaissance de diplômes à l’exclusion du droit d’exercice de la profession, la signature d’un tel accord par la France nous priverait à jamais de la possibilité de négocier un droit d’exercer.
Ayant travaillé en Argentine, pays où tout s’achète, même certains diplômes d’ingénieur, j’avais demandé à l’un de mes collaborateurs pourquoi l’Ordre des ingénieurs argentins n’acceptait pas les titres d’ingénieurs français. Il me répondit avec un éclat de rire que, puisque eux pouvaient travailler en France sans difficulté, ils n’avaient aucune raison de nous l’accorder. Vu de cette manière, les Canadiens peuvent évidemment clamer que l’accord de mai 2000 ne leur apporte pas grand-chose puisque de toute façon ils avaient déjà le droit d’exercer en France, de fait ils ont gagné la possibilité de remplacer le titre d’ingénieur de l’École polytechnique de Montréal par ingénieur diplômé de l’École polytechnique de Montréal. Ils ont surtout gagné la possibilité de négocier dans des conditions beaucoup plus favorables une reconnaissance européenne de leurs diplômes. L’accord dit aussi que chaque partie reconnaît la qualité des ingénieurs formés dans le cadre des programmes habilités par la CTI et accrédités par le BCAPI du CCI : ils pourront arguer que leur licence est reconnue équivalente à notre nouveau M. Sc.
À l’inverse au Canada, exploitant l’incohérence de notre politique, on pourra nous objecter que notre M. Sc. ne vaut qu’une licence ! La première chose à faire serait donc de dénoncer l’accord franco-canadien puisqu’il n’apporte rien et puisque les Canadiens du Québec ne le respectent pas et en ont unilatéralement modifié les termes. Gageons que nos diplomates reculeront à l’idée de faire de la peine aux Québécois et d’ailleurs, il faut être vraiment naïf pour croire que les anciens élèves de l’ENA qui peuplent le ministère des Affaires étrangères, ou les universitaires qui sont au ministère de l’Éducation nationale, deux ministères qui ont un pouvoir décisionnel dans la signature de ce type d’accord, ont vraiment à cœur de se soucier du sort des anciens élèves des Grandes Écoles d’ingénieurs.
Au moins il ne faudrait pas le renouveler, signé pour six ans en 1999, il suffirait de ne rien faire, une solution passive qui aurait sûrement plus de faveur dans les administrations. Elle aurait d’autant plus de chances d’être adoptée que les associations d’anciens élèves voudraient bien jouer un rôle de lobby pour la profession, rôle que manifestement la Commission du titre d’ingénieur n’a pas ou mal joué.
Ce qui précède montre que ce n’est pas suffisant ; pour négocier, il faut avoir quelque chose à offrir et si nous ne dissocions pas reconnaissance du diplôme et exercice de la profession, nous n’aurons jamais cette monnaie d’échange qui pourrait faciliter notre mobilité professionnelle.
Nous pourrions mettre en avant la sécurité du public : en France, un ingénieur de Péchiney qui commettrait une faute professionnelle entraînant des blessures passera au tribunal correctionnel. Une condamnation pénale, même à une simple amende, lui interdira l’accès en Amérique du Nord. Pour la même faute, un ingénieur québécois de chez Alcan aurait, lui, un casier disciplinaire et n’aura aucune difficulté à continuer d’exercer en France… chez Péchiney ! L’exemple peut paraître tiré par les cheveux, mais n’oublions pas que si la situation était inverse, les ingénieurs québécois auraient déjà utilisé l’argument pour demander et obtenir une modification des textes en leur faveur.
Surtout le problème que pose aux ingénieurs français l’existence d’un ordre des ingénieurs n’est pas spécifique au Québec ; la création d’un ordre des ingénieurs aurait sans doute des relents pétainistes, mais clairement les Québécois nous montrent la voie à suivre : ils ont entrepris la modification de leur loi sur les ingénieurs dès la signature de l’accord de 1999 pour rendre l’accès à la profession plus difficile. La loi sur les ingénieurs en France n’a pas subi de modification majeure depuis 1934 ! Qui peut dire qu’elle reste adaptée au monde actuel ?
Une solution tout aussi efficace et plus simple, sans inconvénient au niveau européen, serait une modification de la loi de 1934. Celle-ci interdirait l’exercice en France de la profession d’ingénieur, par les diplômés étrangers et la mention même de leur diplôme, sauf s’il y a, soit accord de stricte réciprocité soit traitement non discriminatoire entre ingénieurs locaux et étrangers. Il faut noter qu’obtenir réciprocité ou non-discrimination sont deux objectifs de négociation différents mais acceptables. Cette interdiction serait, comme au Québec, protection du public oblige, applicable à tous les domaines techniques, génie civil, mais aussi logiciel et management. Par contre, la mise sous tutelle d’un ingénieur étranger expérimenté par un ingénieur français est une solution inefficace et ridicule. D’ailleurs, il ne faut pas s’y tromper, le but n’est pas d’avoir comme les Québécois un outil juridique protectionniste contre les invasions barbares ; le but d’un tel amendement à la loi de 1934 est clairement de forger une arme offensive permettant d’obtenir pour les ingénieurs français une participation à la compétition internationale avec des règles identiques à celles qu’on applique aux autres ingénieurs.
Notons que les accords de doubles diplômes entre les écoles d’ingénieurs françaises et les universités québécoises sont aussi des accords de dupes ; avec un diplôme français et québécois, un Québécois aura un accès direct à l’Europe, un marché de 300 millions d’habitants, un Français aura un document sans valeur et deux diplômes dont il n’aura pas le droit de faire état au Canada, au lieu d’un ! Le marché canadien représente, lui, 30 millions d’habitants ; dans ce cas un accord équilibré ne serait pas nécessairement un accord de réciprocité si l’on tenait réellement compte de la valeur de ce que la reconnaissance du diplôme apporte à chaque partie comme marché potentiel. Si déséquilibre il y avait, il devrait être en notre faveur, sûrement pas l’inverse. Les écoles négocient souvent directement ce type d’accord parce que c’est bon pour leur marketing, sans voir qu’elles ont une responsabilité vis-à-vis de leurs élèves qui s’étend bien après la délivrance du diplôme. Sans séparation entre diplôme et droit d’exercice, l’interdiction de la délivrance de doubles diplômes avec les pays ayant un ordre professionnel s’impose.
Alors quelle est la valeur juridique de nos diplômes ? À l’expérience, ce qu’il en reste lorsque, transplantés à l’étranger, on leur enlève tout l’environnement culturel et relationnel sur lequel nous nous reposons sans même nous en rendre compte, leur covolume, covaleur si l’on veut, est pratiquement nul. Un diplôme pour la gloire en somme. Quelles qu’en soient les raisons, la France a tort d’ouvrir ses frontières aux ingénieurs étrangers en dépréciant les siens. Quand on se compare à la moyenne des ingénieurs étrangers, et nous avons tous l’occasion d’en rencontrer beaucoup au cours d’une carrière, on voit bien que tant le mode de sélection que la formation scientifique que nous avons reçue ne sont rien de moins qu’exceptionnels. C’est une consolation, mais elle est bien maigre puisque si, comme les chasseurs de têtes, on fait un parallèle entre ingénieur et produit, on ne peut ignorer que les cimetières technologiques sont pleins de produits techniquement supérieurs mais n’ayant jamais réussi à dominer le marché faute d’un support juridique ou marketing suffisant.

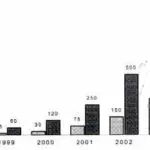

Commentaire
Ajouter un commentaire
utilité des diplômes officiels
Il est clair que les diplômes officiels sont devenus nettement insuffisants, mais la question se pose également : vont-ils devenir inutiles ? Ma réponse est : » Probablement oui ! ». J’en ai fait l’expérience en fondant il y a 20 ans SCHOLA NOVA, une école indépendante d’humanités gréco-latines, qui a, précisément, refusé d’être reconnue par l’État pour préserver la qualité et la liberté de ses programmes.
Si, au début, cela a limité fortement le nombre d’inscriptions (les parents craignant pour le « diplôme » de leurs enfants), la réputation de l’école et les résultats à l’université sont tellemnt supérieurs, que non seulement les parents prennent « le risque » quand leurs enfants sont doués (ce qui fait une augmentation chez nous des bons élèves et une disparition (non voulue) des moins forts), mais même les universités accordent certains privilèges (dispenses de certains cours etc.) à ceux qui sortent de Schola Nova.
Donc, finalement, notre diplôme qui n’a officiellement aucune valeur étatique, devient par le fait même un laisser-passer presque partout, et la réputation augmente d’année en année. J’en conclus que ce qui est vrai pour SCHOLA NOVA doit certainement le devenir pour d’autres… Stéphane Feye Schola Nova – Humanités Gréco-Latines et Artistiques
http://www.scholanova.be
http://www.concertschola.be  ;
http://www.liberte-scolaire.com/…/schola-nova